Les coups de soleil pendant l’enfance sont dangereux. Les échecs du début de la vie sont irréversibles par la suite. Néanmoins, il n’est jamais trop tard pour commencer à se protéger du soleil.
Une grande cohorte de femmes norvégiennes, 102 397 femmes au total entre 1991 et 1997 et 70 081 autres entre 2003 et 2006, a servi de base à un suivi total de 25 ans. L’âge de participation se situait dans une fourchette de 34 à 70 ans. Un questionnaire a été envoyé à intervalles réguliers. L’étude a débuté par une enquête rétrospective sur le nombre moyen de coups de soleil par an pendant l’enfance, suivie d’une enquête prospective sur l’évolution de la situation. Un éventuel diagnostic de mélanome faisait également partie du suivi (l’étude était rattachée à un registre du cancer). Cinq modèles ont été identifiés sur la base du nombre de coups de soleil annuels à l’âge de 0-9, 10-19, 20-29 et 30-39 ans :
- Groupe 1 : pas de coups de soleil (19 500)
- Groupe 2 : quelques coups de soleil dans l’enfance et l’adolescence, puis augmentation chez les jeunes adultes (31 784)
- Groupe 3 : environ un coup de soleil par an dans l’enfance et l’adolescence, puis diminution ou absence de coups de soleil à l’âge adulte (21 399)
- Groupe 4 : toujours environ un coup de soleil par an (49 322)
- Groupe 5 : toujours environ deux ou trois coups de soleil par an (5875).
Dans un modèle multivariable contrôlant l’âge, la cohorte de naissance, la couleur des cheveux, le lieu de résidence, l’exposition au soleil et la durée du suivi, une tendance claire a été observée dans les cinq groupes : le risque d’incidence a augmenté de manière constante par rapport au groupe de référence 1. Le groupe 2 présentait déjà une augmentation de 40% du risque de mélanome, le groupe 3 une augmentation de 73%. Pour les groupes 4 et 5, le risque a été multiplié par plus de deux.
Les résultats soulignent la pertinence des coups de soleil dans l’enfance pour le développement du mélanome. Le fait que le groupe 3 ait encore augmenté son risque par rapport au groupe 2, alors qu’ils avaient probablement subi le même nombre de coups de soleil au cours de leur vie, renforce l’hypothèse d’une sensibilité particulière aux lésions cutanées dues au soleil pendant l’enfance. Ce n’est pas nouveau. La saisie rétrospective des coups de soleil comporte en outre toujours un facteur d’incertitude : un adulte se souvient-il vraiment de son enfance de manière suffisamment fiable pour pouvoir tirer des conclusions sur la fréquence moyenne des coups de soleil par an ? Il est peu probable que les parents soient une source d’information plus adéquate.
Un autre résultat de l’étude, que l’on ne découvre qu’en y regardant de plus près, semble donc plus passionnant que la nouvelle preuve de la sensibilité de ce groupe d’âge aux dommages causés par les UV : la différence entre les groupes 3 et 4. Tous deux ont eu à peu près le même nombre de coups de soleil dans l’enfance. Ce risque ne peut plus être compensé. Il semble toutefois qu’il ne soit jamais trop tard pour commencer à se protéger du soleil, car si la fréquence des coups de soleil diminue avec l’âge, on se retrouve en fin de compte dans une meilleure situation en termes de risques que les personnes qui continuent à vivre comme dans leur enfance et leur jeunesse.
Les femmes : Meilleur pronostic, mais est-ce vrai à tous les stades ?
Les femmes atteintes de mélanome ont un meilleur pronostic de survie, c’est bien connu. Mais est-ce vraiment le cas à tous les stades de la maladie et tout au long de la vie ? Et que se passe-t-il si l’on intègre d’autres variables pronostiques dans le calcul ? Une nouvelle étude américaine s’est penchée sur ces questions. Comme souvent, la base de données SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) de 2010 à 2014 a servi de référence. Plus de 16 000 patients atteints de mélanome cutané ont été identifiés, dont environ 9000 au stade II, 5000 au stade III et 3000 au stade IV. L’âge médian était de 64 ans.
Alors qu’il n’y avait une différence significative de survie à 5 ans spécifique au cancer entre les femmes et les hommes de tous âges qu’au stade IV, les femmes de moins de 45 ans étaient également supérieures aux hommes du même âge aux stades II et III. Cela n’a toutefois pas été le cas dans les années qui ont suivi. Si l’on comparait les jeunes femmes aux hommes plus âgés, le pronostic était meilleur à tous les stades. Dans l’analyse multivariable, le sexe féminin était responsable d’une réduction du risque de mortalité d’environ 20 pour cent, indépendamment des autres facteurs.
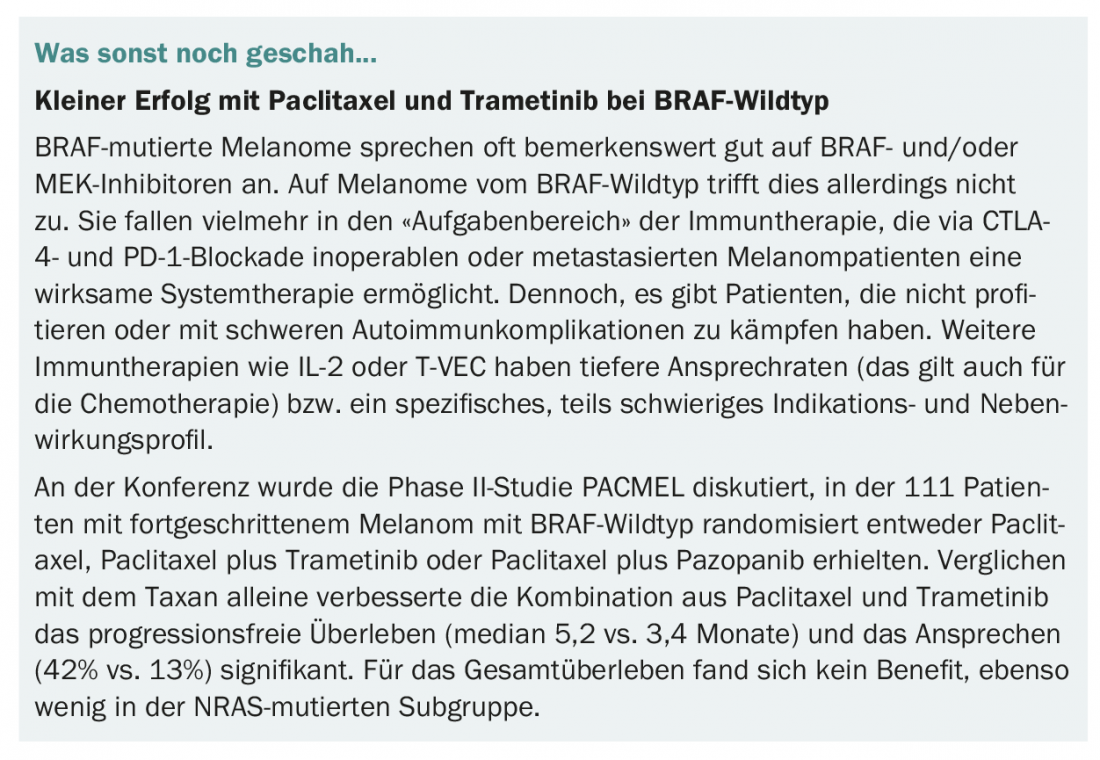
Les femmes survivent donc plus longtemps que les hommes, même à l’époque des thérapies modernes contre le mélanome. Selon l’étude, la plus grande différence de survie au mélanome se situe entre les femmes de moins de 45 ans et les hommes d’au moins 60 ans. Une approche différente de la santé et des risques personnels ne peut pas être responsable à elle seule de la différence entre les sexes. Selon les auteurs de l’étude, il est important de collecter davantage d’informations sur le sujet, car elles pourraient renseigner sur les mécanismes hôte-tumeur possibles, responsables par exemple de l’agressivité biologique et de la réponse au traitement.
Prévention sur mesure
Un essai contrôlé randomisé mené dans des cabinets de médecins généralistes australiens a également alimenté les discussions du congrès. 272 patients de tous âges, en majorité des femmes, ont rempli dans la salle d’attente avant le rendez-vous un questionnaire basé sur le web qui calculait le risque individuel de mélanome à partir de différentes déclarations personnelles sur les facteurs de risque connus. Les participants ont ensuite été répartis au hasard en deux groupes : L’un a reçu du matériel de prévention personnalisé basé sur son risque personnel, l’autre du matériel produit de manière générique. Le matériel d’information personnalisé donnait notamment des indications sur mesure concernant le risque estimé sur la durée de vie (via un pictogramme de 100 personnes), le risque relatif et la catégorie de risque.
Et en effet, après six semaines de suivi, des effets positifs (bien que mineurs) ont été observés. L’exposition au soleil, la protection solaire et les mesures de dépistage ont à nouveau été demandées comme critères d’évaluation et comparées au début de l’étude. Les données de 174 personnes présentant un risque moyen et de 11 personnes présentant un risque élevé ont pu être analysées. Certes, il n’y avait pas de différence dans les critères d’évaluation mentionnés pour tous les groupes. Cependant, en ne considérant que le groupe à risque moyen de mélanome, des améliorations statistiquement significatives ont été observées dans le comportement de protection solaire (p=0,04) et dans l’utilisation de lunettes de soleil (p=0,05). Le programme basé sur le web a été jugé facile d’accès par la grande majorité du groupe d’intervention, et le matériel individualisé distribué a été jugé facile à comprendre et utile.
L’étude est trop courte à plusieurs égards : d’une part, la période d’observation de six semaines est très limitée et ne peut guère être utilisée comme indicateur de prévention durable. Ce n’est qu’en Australie, où l’exposition aux UV est constamment élevée, qu’une période d’étude aussi courte peut offrir suffisamment de possibilités de s’exposer au soleil (et de se protéger). D’autre part, l’ampleur des effets était faible, bien que significative : sur une échelle de 1 à 5, le comportement en matière de protection solaire a changé de 0,23 et l’utilisation de lunettes de soleil de 0,43.
Néanmoins, l’orientation semble judicieuse : il est possible de créer et de communiquer une prévention personnalisée de manière simple et peu coûteuse. Celle-ci est bien acceptée par le groupe cible. Les campagnes de prévention au niveau de la société, par exemple dans les lieux publics, sont facilement noyées dans le flot général d’informations ou manquent de pertinence personnelle.
Source : 9e Congrès mondial sur le mélanome, 18-21 octobre 2017, Brisbane
InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE 2017 ; 5(6) : 31-32











