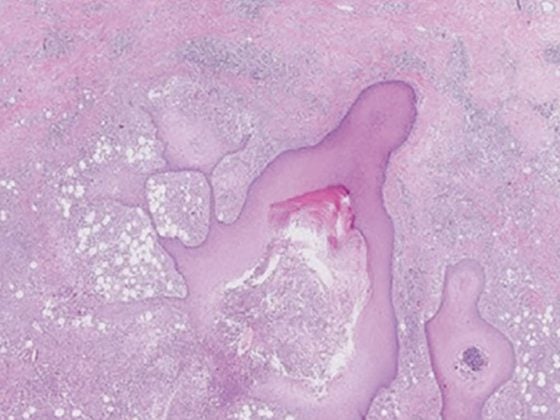Dans la plupart des cas, la sclérose en plaques évolue par poussées et peut évoluer vers un stade chronique progressif au fil du temps. La gestion du traitement dépend non seulement des circonstances individuelles, mais aussi de l’efficacité, de la sécurité et de la tolérance du traitement. Entre-temps, des agents établis ont été développés pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes.
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie inflammatoire du système nerveux. En Suisse, on estime qu’environ 15 000 personnes sont concernées. Cela signifie qu’environ une personne sur 560. habitants souffre de SEP. Chez 80% des personnes atteintes, les premiers symptômes apparaissent entre 20 et 40 ans. La SEP est donc la maladie neurologique la plus fréquemment diagnostiquée à cette période de la vie [1]. Les causes exactes de la SEP restent inconnues. On suppose qu’il existe une interaction entre une prédisposition génétique et une influence considérable des facteurs environnementaux. Il s’agit par exemple de certains virus en tant qu’agents infectieux, d’une carence en vitamine D ou de particularités géographiques.
L’objectif de la recherche est et reste de pouvoir un jour guérir la maladie. En attendant, la neurodégénérescence, entre autres, est étudiée de plus près [2,3]. Elle est en grande partie responsable du développement de handicaps, car elle entraîne une transsection axonale ainsi qu’une perte de neurones. Une neurodégénérescence croissante, qui commence très probablement plus tôt qu’on ne le pensait jusqu’à présent, semble être une cause essentielle de la progression de la maladie. La recherche de biomarqueurs, comme la protéine neurofilament light, qui détecte les lésions axonales ou neuronales en général et peut être utilisée pour mieux évaluer le pronostic de chaque patient, va en outre dans le sens d’une thérapie personnalisée [4,5]. Plus récemment, le rôle central des astrocytes dans les processus de la SEP a été étudié [6]. Un groupe de chercheurs de Bâle a pu montrer que le taux sanguin d’un composant cellulaire appelé “Glial fibrillary acidic protein” (GFAP) augmente lorsque les astrocytes sont activés ou davantage détruits. Des taux sanguins élevés de GFAP pourraient donc être associés à la fois à la progression actuelle et future de la SEP.
Gestion précoce de la thérapie
Le traitement est personnalisé et adapté aux besoins de la personne concernée. Plus la thérapie peut être initiée tôt, mieux c’est. Plusieurs options de traitement efficaces sont désormais disponibles et permettent souvent de ralentir considérablement la progression de la maladie. En principe, la gestion du traitement repose sur le modèle des quatre piliers, à savoir la prévention des poussées, le traitement aigu des poussées, le traitement symptomatique et le traitement de réadaptation. L’objectif du traitement est de réduire l’ampleur des réactions inflammatoires, de stabiliser les limitations fonctionnelles ainsi que d’améliorer les symptômes associés.
Pendant les poussées aiguës de SEP, on utilise généralement de fortes doses de cortisone pour réduire l’inflammation. Si les symptômes ne régressent pas suffisamment, le traitement à la cortisone est répété à une dose plus élevée. Si cela ne donne pas de résultats, une séparation du plasma est effectuée [7]. Pour prévenir les poussées, on a recours, entre autres, aux interférons bêta ou à l’acétate de glatiramère dans les formes légères et modérées. Depuis 2013/14, le tériflunomide et le fumarate de diméthyle (DMF) sont également autorisés comme option de traitement pour les patients atteints de SEP rémittente. Les deux substances ont principalement des propriétés anti-inflammatoires, mais agissent différemment. Le DMF a maintenant été transformé en fumarate de diroximel. Les deux substances actives sont des promédicaments qui sont transformés in vivo en métabolite actif, le fumarate de monométhyle. La manière dont ce métabolite agit exactement dans la SEP n’a pas encore été détectée en détail. On pense que le fumarate de monométhyle renforce l’action de la protéine Nrf2. La production accrue d’antioxydants qui en résulte semble aider à contrôler l’activité du système immunitaire et à réduire les lésions du cerveau et de la moelle épinière dans la SEP [8]. Le développement ultérieur marque des points surtout en ce qui concerne le profil de tolérance gastro-intestinale.
Chez les patients dont l’évolution est (très) active (c’est-à-dire de nombreux épisodes de poussée graves en peu de temps et/ou une IRM (très) active) ou qui ne répondent pas suffisamment aux immunothérapies de base, des médicaments de l’escalade thérapeutique sont utilisés. Il s’agit par exemple des thérapies par perfusion avec l’anticorps monoclonal Natalizumab. De même, le fingolimod est autorisé comme traitement d’escalade. Pour le traitement de la SEP rémittente, on peut en outre utiliser l’alemtuzumab ou des traitements oraux de courte durée comme les comprimés de cladribine. Dans de rares cas et uniquement en tant qu’alternative, des immunosuppresseurs tels que ceux utilisés dans le cadre d’un cancer (par exemple la mitoxantrone ou le cyclophosphamide) peuvent également être envisagés [7].
Littérature :
- www.multiplesklerose.ch/de/ueber-ms/multiple-sklerose (dernier accès le 24.01.2024)
- Ziemssen T, Derfuss T, de Stefano N, et al.: Optimizing treatment success in multiple sclerosis. J Neurol 2016; 263: 1053–1065.
- De Stefano N, Airas L, Grigoriadis N, et al.: Clinical relevance of brain volume measures in multiple sclerosis. CNS Drugs 2014; 28: 147–156.
- Barro C, Benkert P, Disanto G, et al.: Serum neurofilament as a predictor of disease worsening and brain and spinal cord atrophy in multiple sclerosis. Brain 2018; 141(8): 2382–2391.
- Benkert P, Meier S, Schaedelin S, et al.: Serum neurofilament light chain for individual prognostication of disease activity in people with multiple sclerosis: a retrospective modelling and validation study. Lancet Neurology 2022; 21(3): 246–257.
- Meier S, Willemse EAJ, Schaedelin S, et al.: Serum Glial Fibrillary Acidic Protein Compared With Neurofilament Light Chain as a Biomarker for Disease Progression in Multiple Sclerosis. JAMA Neurology 2023; 80(3): 287–297.
- www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/neurologie/erkrankungen/multiple-sklerose-ms/therapie (dernier accès le 24.01.2024)
- www.pharmazeutische-zeitung.de/fumarat-der-naechsten-generation-130969 (dernier accès le 24.01.2024).
InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2024; 22(1): 24