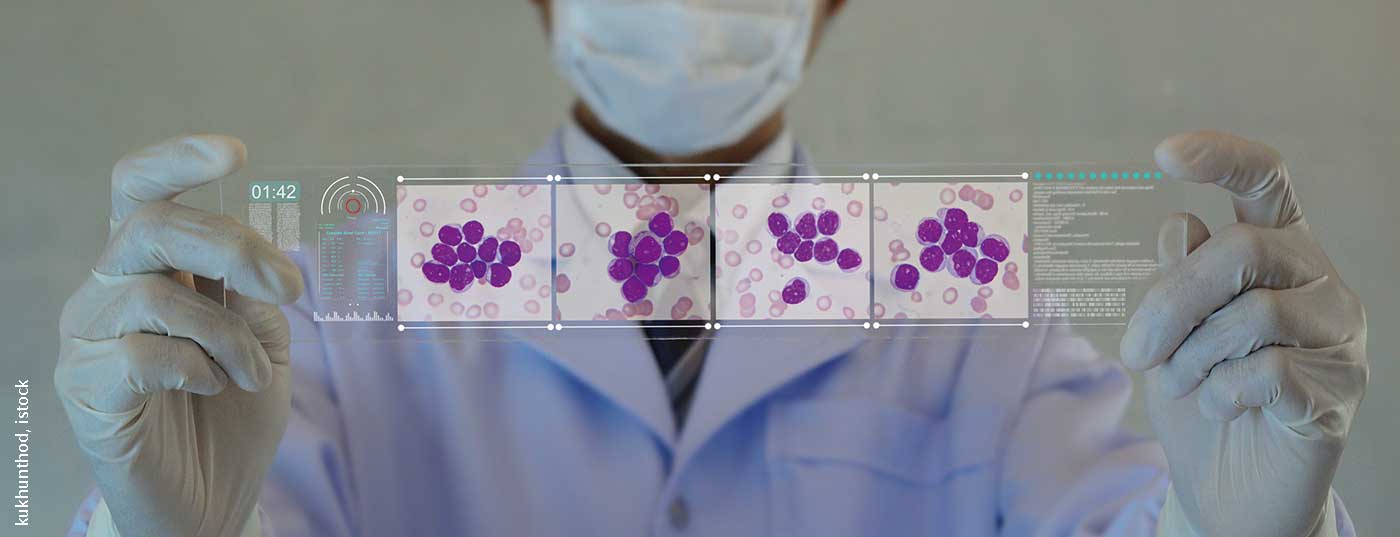La compréhension des maladies myéloïdes, telles que la leucémie myéloïde aiguë (LMA) et les syndromes myélodysplasiques (SMD), devient de plus en plus concrète grâce à une recherche intensive. Les résultats d’études récentes ont montré qu’il y a beaucoup de mouvement dans le domaine des maladies myéloïdes. Les thérapies immunologiques font désormais leur entrée dans l’arsenal des options de traitement.
Les approches immunothérapeutiques telles que la thérapie par cellules CAR-T, les inhibiteurs de points de contrôle et les anticorps ouvrent un nouveau chapitre dans le traitement des maladies myéloïdes. La LMA est principalement une maladie des adultes âgés. Cependant, les traitements standard de faible intensité couramment utilisés jusqu’à présent, tels que l’azacitidine (AZA) ou la décitabine, n’ont eu qu’une efficacité limitée. Cependant, les patients atteints de LAM qui ne peuvent pas bénéficier d’un traitement intensif ont un pronostic défavorable. Une étude de phase III a donc été menée pour évaluer plus précisément l’association de l’AZA avec le vénétoclax (VEN), un inhibiteur de BCL-2. Ont été inclus 431 patients avec un premier diagnostic de LAM qui ne pouvaient pas recevoir de traitement intensif en raison de leur âge ≥75 ans ou de comorbidités. Les patients ont été randomisés dans un rapport 2:1 pour recevoir soit AZA+VEN, soit AZA+placebo (PBO). Avec un suivi médian de 20,5 mois, le bras AZA+VEN a montré une survie globale médiane (mOS) de 14,7 mois contre 9,6 mois pour le bras AZA+PBO. Des rémissions complètes, ou des rémissions complètes avec récupération hématologique incomplète (CRi), ont été obtenues dans 66% contre 28% après 1,3/2,8 mois.
Cibler la LAM
Une autre avancée a été examinée de plus près avec l’association de l’AZA et de l’inhibiteur de l’IDH2 (isocitrate déshydrogénase 2), l’énasidenib (ENA), dans une étude de phase II. ENA est déjà approuvé aux États-Unis pour le traitement des patients atteints de LMA en rechute ou réfractaire lorsqu’une mutation pilote du gène IDH2 a été détectée, et a également démontré son efficacité en monothérapie chez les patients âgés chez qui une LMA avec mutation IDH2 a été diagnostiquée pour la première fois. Dans la présente étude portant sur 101 patients, l’association ENA+AZA a marqué des points par rapport à la monothérapie par AZA en termes de réponse et de taux de RC de manière significative (53% contre 12%). La durée de la réponse est prolongée à 24,1 mois sous traitement combiné contre 12,1 mois sous monothérapie. La survie médiane sans événement (mEFS) était également plus élevée avec l’ENA+AZA (17,2 mois) qu’avec l’AZA en monothérapie (10,8 mois). Cependant, aucune amélioration de la survie globale (OS) n’a été démontrée. Les experts ont émis l’hypothèse que ces résultats encourageants pourraient permettre d’envisager l’utilisation de thérapies combinées ciblées pour les patients LAM en bonne santé, mais aussi dans le cadre de concepts de triples combinaisons comme ENA+VEN+AZA pour les patients plus âgés.
Traitement curatif de la LAM
Malgré tous ces développements, le traitement immunologique par allogreffe de cellules souches (SCT) reste la seule possibilité de traitement curatif pour les patients atteints de LMA présentant un profil de risque intermédiaire ou élevé, ou pour les récidives. Cependant, jusqu’à présent, le manque d’antigènes cibles appropriés a empêché l’établissement d’un traitement par cellules CAR-T dans la LAM. Dans une étude de phase I, l’antigène CLL1 (human C-type lectin-like molecule-1), exprimé dans les cellules souches leucémiques (LSC), et CD33 (Siglec-3 ; sialic acid-binding Ig-like lectin 3), un antigène largement exprimé dans le myélome, ont donc été utilisés pour produire des cellules CAR-T bispécifiques. Utilisé chez les patients atteints de LAM récidivante ou réfractaire, il a permis d’obtenir une négativité de la MRD (MRD = maladie résiduelle minimale) chez 7 patients sur 9 après 4 semaines. 6 patients ont été soumis à une TCS allogénique au cours de l’étude. Un signe encourageant qui montre que les thérapies CAR-T cell peuvent également trouver leur place dans les maladies myéloïdes.
Source : EHA 2020
Littérature complémentaire :
- https://library.ehaweb.org/eha/2020/eha25th/303390 (dernier accès le 11.9.2020)
- https://library.ehaweb.org/eha/2020/eha25th/294959 (dernier accès le 11.9.2020)
- https://library.ehaweb.org/eha/2020/eha25th/294969 (dernier accès le 11.9.2020)
InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE 2020 ; 8(4) : 29 (publié le 22.9.20, ahead of print)