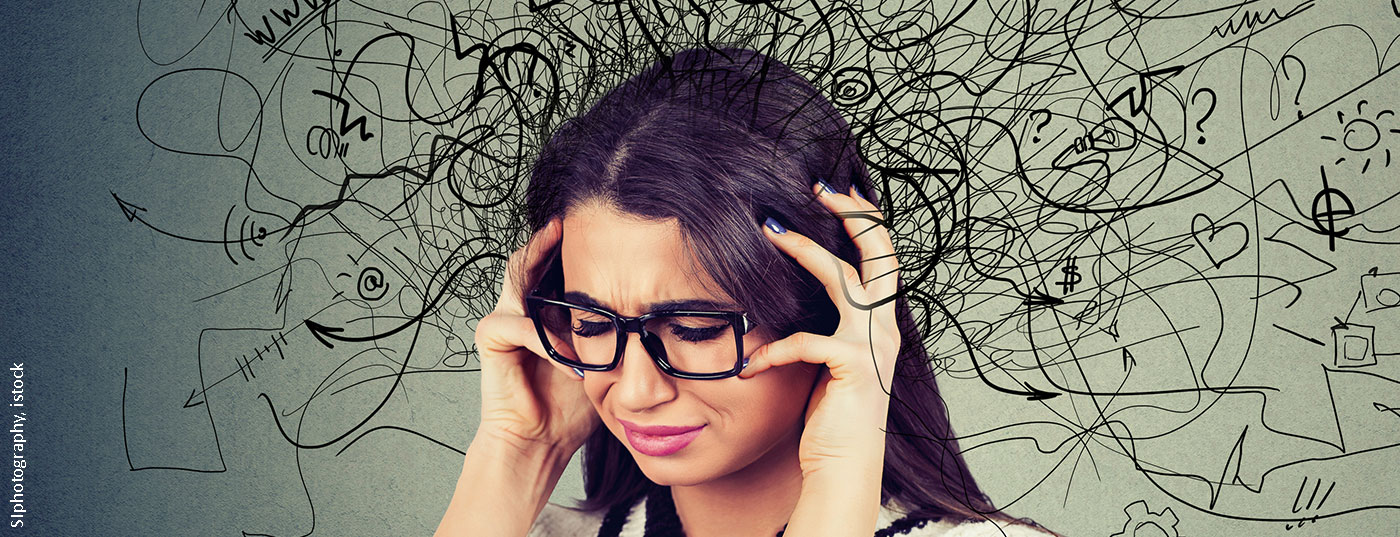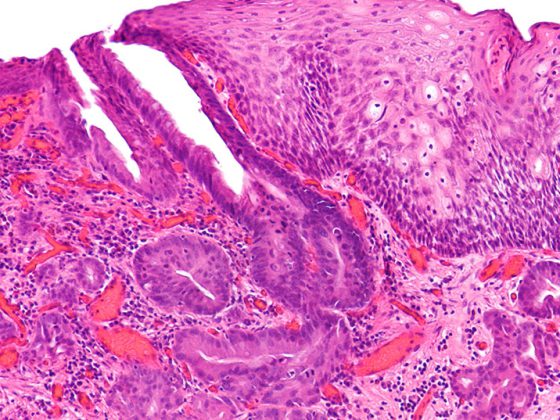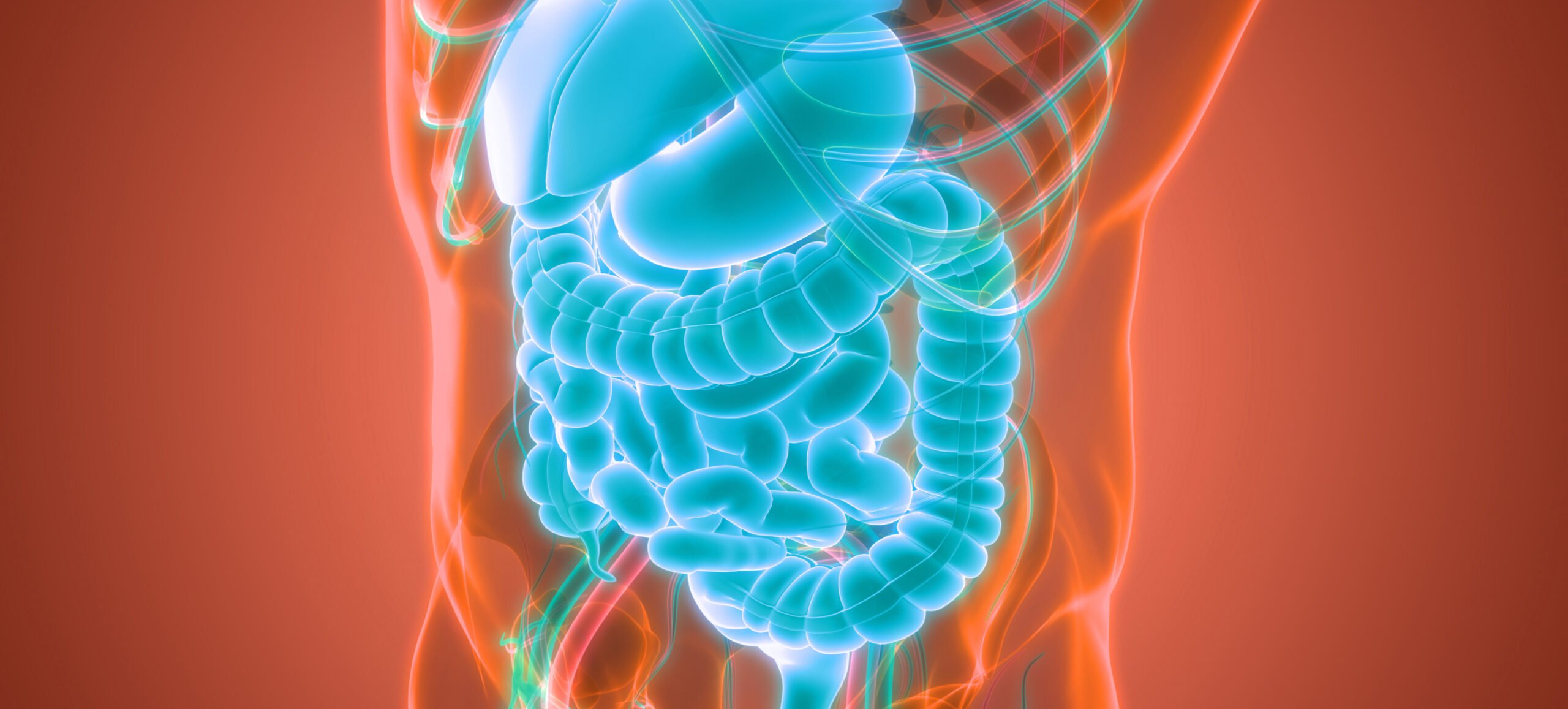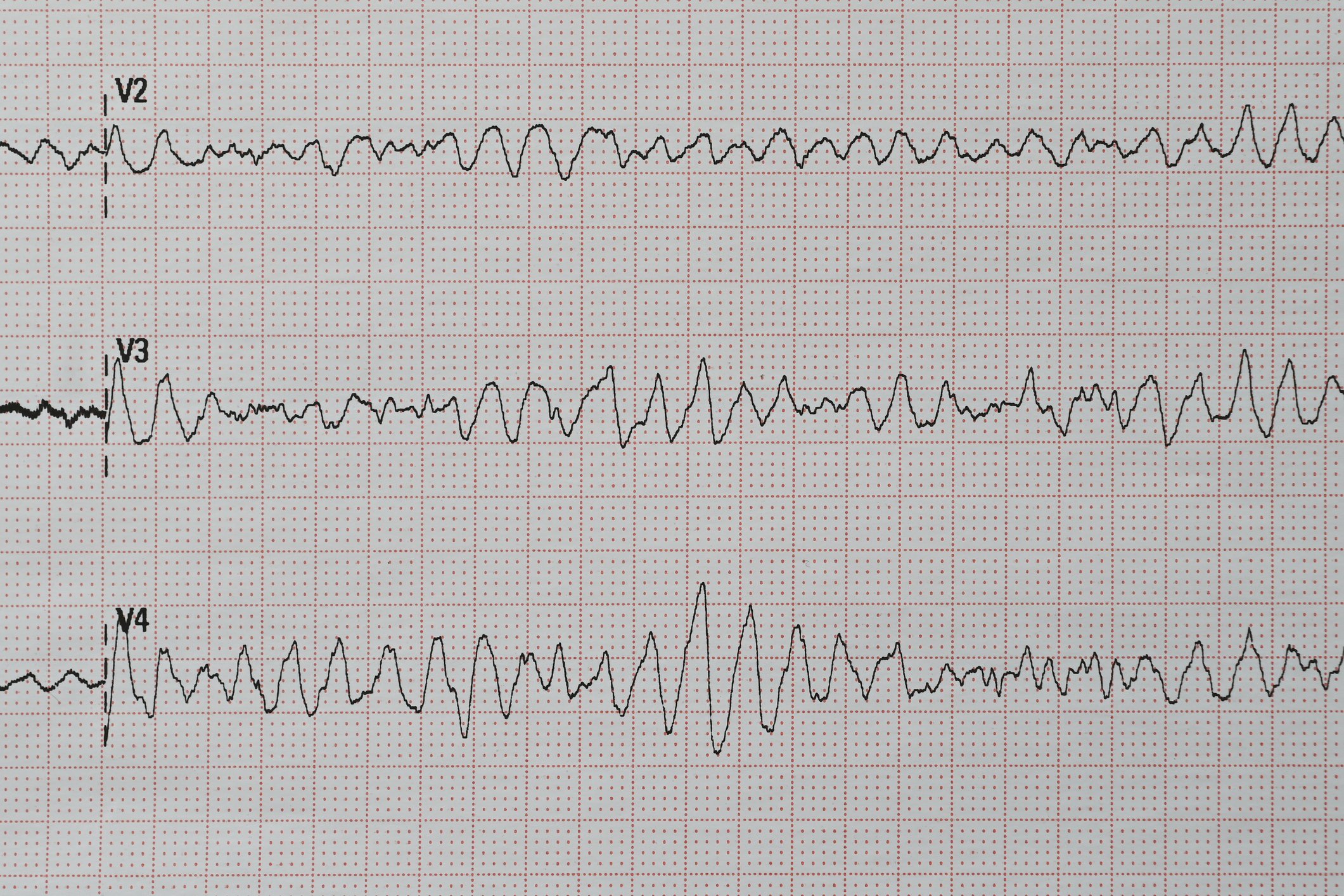Le TDAH peut être bien traité. Les meilleures preuves d’efficacité existent pour une thérapie multimodale. Cependant, le diagnostic est souvent rendu difficile par une large variabilité des symptômes. Parmi d’autres facteurs, les fluctuations hormonales peuvent également influencer les symptômes et les stratégies d’adaptation.
De nombreux patients s’adressent à leur médecin généraliste ou à leur psychiatre pour obtenir des informations sur l’évaluation ou le traitement d’un trouble du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH). La large variabilité des symptômes rend souvent le diagnostic difficile. De plus, chez les patientes, les fluctuations hormonales et les attentes interculturelles peuvent avoir une influence supplémentaire sur l’expression des symptômes et la gestion de la maladie.
Les sexes diffèrent également en ce qui concerne l’évolution, le développement de comorbidités et le traitement. Cet article a pour but de donner un aperçu de ces spécificités. Pour des raisons de lisibilité, seule la forme masculine est parfois utilisée dans l’article.
Symptômes et épidémiologie du TDAH
Le trouble psychiatrique TDAH fait partie des troubles du développement neuronal. Le diagnostic est posé lorsqu’un certain nombre des trois symptômes clés (hyperactivité, impulsivité et troubles de l’attention), mais aussi des critères secondaires tels que les fluctuations émotionnelles et l’altération des fonctions exécutives, peuvent être mis en évidence avec une gravité pertinente pour la vie quotidienne. On part d’un modèle de troubles multicausaux avec des facteurs épigénétiques, prénataux et psychosociaux. L’influence des transporteurs de retour de la dopamine très actifs (principalement dans le cortex préfrontal et le système limbique) et le manque de dopamine qui en résulte dans la fente synaptique ont été bien étudiés [1]. On trouve des taux de prévalence d’un peu moins de trois pour cent chez les adultes dans le monde entier, et le diagnostic est quatre fois plus souvent posé chez les garçons [2].
On suppose que chez les filles, le TDAH a tendance à passer inaperçu, car les systèmes de diagnostic courants (CIM-10) interrogent les symptômes qui apparaissent plus clairement chez les garçons (comme l’hyperactivité), et que chez les filles, les symptômes se manifestent différemment ou ne se démasquent que plus tard. Pour les enfants et les adolescents atteints de TDAH, il existe quelques méta-analyses qui se concentrent sur les différences entre les sexes [3]. Ceux-ci ont montré de manière concordante que les patients TDAH de sexe féminin présentaient moins de symptômes primaires (hyperactivité, inattention et impulsivité) et moins de problèmes d’externalisation que les patients de sexe masculin. De plus, l’évaluation du TDAH chez les filles par rapport aux garçons révèle un biais d’appréciation important. Les médecins diagnostiquent plus facilement le TDAH chez les garçons, ce qui signifie que de nombreuses femmes atteintes ne sont probablement pas diagnostiquées [4,5]. Ces phénomènes de différence entre les sexes sont également discutés en ce qui concerne d’éventuelles erreurs de diagnostic, puisque seulement 6,6% des filles, contre 21,8% des garçons, sont diagnostiquées faussement positives avec le TDAH en raison d’erreurs de jugement diagnostique. De plus, les diagnostics faussement positifs (16,7%) étaient dans l’ensemble significativement plus fréquents que les diagnostics faussement négatifs (7%) [6]. Le DSM-IV a créé pour la première fois des sous-groupes avec des symptômes d’inattention prédominants, et une enquête selon le DSM-IV a révélé un rapport plus équilibré entre les sexes, avec une prévalence de 3,2% chez les femmes et de 5,4% chez les hommes [7]. En cas de comorbidité de troubles du développement intellectuel, la prévalence ponctuelle est nettement plus élevée, avec une moyenne de 12% [8]. Il est intéressant de noter que la répartition par sexe est alors à peu près la même [9]. D’autres syndromes congénitaux sont également très souvent associés au TDAH, par exemple la trisomie 21 (syndrome de Down, 34-44%). [10]le syndrome de l’X fragile (40-49%) [11]le syndrome de Williams (65%) [12]l’embryopathie alcoolique (ETCAF, 51%) [13]le syndrome 22q12 (34%) [14] et la dystrophie musculaire de Duchenne [15]. Le TDAH est souvent présent chez les autistes, une personne sur deux répond également aux critères diagnostiques du DSM pour le TDAH [16]. Au cours de l’évolution, la symptomatologie peut être totalement ou partiellement rémittente ; on distingue de rares rémissions totales, de fréquentes rémissions partielles et de très rares évolutions persistantes sans diminution de l’expression des symptômes. La plupart des adultes souffrent d’au moins une partie des symptômes tout au long de leur vie, ce qui peut entraîner de graves répercussions dans tous les domaines de la vie. Chez les hommes en particulier, la prévalence du TDAH diminue progressivement tout au long de la vie. Chez les femmes, les patients présentant des comorbidités et les personnes souffrant de troubles du développement intellectuel, les symptômes du TDAH persistent plus souvent et de manière plus importante [17,18]. Des relations familiales difficiles et de faibles compétences sociales réduisent également le taux de rémission [19]. Le meilleur facteur prédictif de rémission à l’âge adulte semble être un QI élevé et un bon environnement psychosocial [20].
Dans une étude, Biederman fait la différence entre les diagnostics actuels et les diagnostics en cours de vie. Alors que les diagnostics en cours de vie montraient que les hommes présentaient davantage de troubles liés à la consommation de substances et de troubles dissociatifs de la personnalité, et les femmes davantage de troubles paniques, une seule différence a été constatée pour les diagnostics actuels. Les hommes atteints de TDAH avaient des taux plus élevés de troubles liés à l’utilisation de substances que les femmes atteintes de TDAH et parfois plus de troubles comportementaux comorbides dans l’enfance [21].
A l’âge adulte, on diagnostique généralement des troubles ou des accentuations de la personnalité, des abus de substances, des troubles affectifs, des troubles anxieux, des troubles du sommeil et des tics. Chez l’enfant, on trouve surtout des troubles oppositionnels du comportement, des troubles de l’attachement, des troubles du tic, de l’anxiété et de l’affectivité [22]. Chez les filles et les femmes, le diagnostic de TDAH est souvent posé après l’apparition de comorbidités.
Une étude longitudinale sur des femmes atteintes de TDAH montre une rémission après 11 ans chez seulement 23% des participantes. Les troubles de la personnalité, la dépression, les troubles bipolaires et les troubles anxieux ont continué à augmenter pendant toute la période. Dans l’ensemble, la plupart des femmes ont subi des préjudices importants dans le domaine de la formation et du travail [23]. Les femmes atteintes de TDAH sont cinq fois plus susceptibles d’être diagnostiquées avec une dépression majeure que les femmes sans TDAH [24]. Ottonen a montré dans une grande étude que les femmes souffrant de TDAH présentaient globalement plus de comorbidités psychiatriques que les hommes. La comparaison entre les sexes a montré que certains troubles comorbides sont moins fréquents chez les femmes (dyslexie, délinquance, comportement oppositionnel) et que d’autres sont plus fréquents (anxiété, troubles affectifs, troubles alimentaires, abus de substances) [25]. Il n’existe pas encore de preuves suffisantes pour déterminer si cela est dû à des facteurs externes ou internes. On se demande si un diagnostic et un traitement précoces chez les patients masculins réduisent le développement de troubles comorbides. Une autre explication pourrait être que les femmes souffrant de formes légères de TDAH ne sont pas diagnostiquées et que les cas graves, davantage corrélés à des comorbidités, sont plus souvent diagnostiqués chez les femmes. Les patients diagnostiqués tardivement et ceux souffrant de maladies psychiatriques concomitantes sont particulièrement vulnérables [26].
L’idée d’étudier le TDAH en fonction du sexe n’est pas nouvelle, Nadau a publié en 1995 en tant qu’éditeur le livre “A comprehensive guide to Attention Defizit Disorder in Adults”, qui contenait déjà un chapitre “Considérations spéciales sur les symptômes chez les femmes”, et a également développé des questionnaires spéciaux pour les femmes [27]. Toutefois, l’évaluation diagnostique continue d’être effectuée de la même manière pour les hommes et les femmes. Johanna Krause indique dans son livre “ADHS im Erwachsenenalter” (TDAH à l’âge adulte) que si une mère a des enfants atteints de TDAH, il ne faut pas oublier que sa mère pourrait également souffrir de TDAH [28]. Dans une étude contrôlée en double aveugle portant sur des mères et des enfants concernés, le style éducatif des mères traitées au méthylphénidate s’est amélioré de manière significative par rapport au groupe placebo, elles étaient plus cohérentes et moins enclines à punir physiquement [29]. Les patientes apprécient les recommandations sur la littérature spécifique au genre [27,30,31]. Les symptômes suivants semblent plutôt spécifiques aux femmes :
- Apparition (ou visibilité) tardive des symptômes
- Auto-accusation, faible estime de soi
- Tristesse accrue/anxiété sans fondement
- Résolution des conflits internes (en cas de stress, “imploser au lieu d’exploser”)
- Les difficultés sont niées ; il y a un désir de ne pas se faire remarquer.
- Tendance à des comportements oraux en cas de stress : sucer son pouce, se ronger les ongles, manger de manière excessive (parfois avec vomissements), fumer
- Renforcement grave à la puberté
- Expérience de la douleur plus intense, hypersensibilité aux stimuli
- Blocage et retrait des exigences
- Syndrome prémenstruel prononcé
- Réactions violentes aux hormones administrées
Diagnostic chez les filles et les femmes
On trouve des différences dans les critères de diagnostic dans la CIM (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes) et le DSM (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), dans lequel on trouve une subdivision en sous-types. On peut distinguer deux sous-types : Dans le type combiné, les femmes semblent éloquentes et sûres d’elles, hypersociales, très occupées et charismatiques malgré une vie chaotique. Dans le cas du type inattentif (qui est le type le plus fréquent chez les femmes), celles-ci semblent plutôt en retrait, voire isolées socialement, elles semblent timides et se découragent rapidement. La rêverie entraîne la procrastination et le retard par rapport aux opportunités professionnelles. De l’extérieur, ils sont perçus comme léthargiques et passifs malgré leurs bonnes intentions. En outre, plus le QI est élevé, plus les symptômes sont difficiles à détecter, car une bonne façade masque la cause sous-jacente et les femmes souffrant de TDAH sont passées maîtres dans l’apprentissage de tactiques d’évitement et de stratégies d’adaptation. Ces patients sont parfois compulsifs, méticuleux et chroniquement épuisés, car ils consacrent toute leur énergie à la gestion de la vie quotidienne. Ces patientes indiquent souvent qu’elles essaient de se conformer à un modèle traditionnel et aux attentes de rôle qui en découlent. Il est bien connu que les symptômes du TDAH qui sont plutôt considérés comme typiques chez les garçons (forte activité motrice, être bruyant, se heurter, agir de manière impulsive) sont plus rapidement perçus comme inappropriés et dérangeants chez les filles et sont plus tôt structurés et régulés de l’extérieur. De ce fait également, ils sont souvent moins visibles ou ne le sont que plus tard.
Malgré de nombreuses études épigénétiques, aucun biomarqueur du TDAH n’a encore été trouvé, de sorte que le diagnostic reste purement clinique [32]. En cas de suspicion de cette maladie, le diagnostic se fait par le biais d’un entretien standardisé avec une anamnèse détaillée et également une anamnèse externe (chez les patients mineurs, si possible également avec les parents), et une enquête rétrospective des symptômes depuis l’enfance (Wender Utah Rating Scale, WURS-K) et l’examen d’anciens documents (par ex. bulletins scolaires) [33]. L’échelle Brown ADD et l’échelle Conners’ Adult ADHD Rating Scale (CAARS) peuvent être utilisées comme questionnaires [34,35]. Les analyses comportementales et les essais de traitement par méthylphénidate ne sont pas obligatoires, mais peuvent fournir des indications diagnostiques précieuses dans certains cas. Il est également possible que l’utilisation des caractéristiques enregistrées dans l’EEG (“diagnostic classifiers”) puisse aider le processus de diagnostic [36]. Les catalogues de symptômes spécialement créés pour les femmes (par exemple l’échelle d’auto-évaluation du TDAH pour les femmes de K. Nadeau et P. Quinn) se sont révélés utiles [27]. Bien qu’ils ne servent pas à établir un diagnostic selon la CIM ou le DSM, ils peuvent être remis aux femmes dans le cabinet de leur médecin généraliste afin d’évaluer le degré d’intensité des symptômes typiques . Il en résulte souvent une prise de conscience surprenante de soi-même et l’affirmation “je pensais qu’ils écrivaient sur moi”.
Hormones féminines et TDAH
Avec l’entrée dans la puberté (changement hormonal), les symptômes s’intensifient et se modifient en partie, car les hormones sexuelles féminines, l’œstrogène et la progestérone, interagissent avec les neurotransmetteurs dopamine et sérotonine.
Les situations de bouleversements hormonaux (ménarche, cycle, grossesse, ménopause) sont pour chaque femme un processus qui consomme de l’énergie et qui peut s’accompagner d’une altération de l’état psychique [37]. Les femmes atteintes de TDAH semblent présenter des fluctuations hormonales plus importantes ou réagir de manière plus sensible, plus violente et plus problématique à ces fluctuations. Les œstrogènes et les progestatifs ont une forte influence sur l’activité neuronale du SNC, ils modulent la synthèse, la sécrétion, la liaison aux récepteurs et la recapture des neurotransmetteurs. Les œstrogènes ont généralement un effet activateur sur le SNC, tandis que les progestatifs ont un effet modérateur. Ils ont un effet positif sur l’humeur et le bien-être, probablement en renforçant l’activité de la sérotonine et de la dopamine. En conséquence, ils peuvent entraîner une modification des symptômes du TDAH, mais aussi des effets des psychotropes associés aux systèmes noradrénergique et dopaminergique. Les endorphines (qui sont à leur tour stimulées par les œstrogènes) inhibent par exemple la sécrétion de noradrénaline et de dopamine. C’est pourquoi une baisse de la concentration d’œstrogènes (prémenstruelle, post-partum, ménopause) peut entraîner une augmentation rebondissante de la dopamine et de la noradrénaline et, par conséquent, une excitabilité et une irritabilité accrues du SNC. Une carence en œstrogènes peut entraîner une altération des systèmes cholinergiques, dopaminergiques et sérotoninergiques et une perte des connexions synaptiques, indépendamment du TDAH. Il peut en résulter une baisse des performances cognitives. L’influence des œstrogènes sur le système dopaminergique se produit principalement au niveau de l’hypothalamus. Il existe des récepteurs d’œstrogènes dans le système limbique qui ont une fonction de “neuromodulateurs”. Ils modulent la sensibilité et le nombre des récepteurs de la dopamine. On voit ici un lien étroit avec l’hypothèse de neuroprotection, que l’on connaît également pour d’autres maladies mentales. L’influence hormonale se manifeste dans les différentes situations comme suit [37]:
Ménarche et cycle :
- Un nombre supérieur à la moyenne de filles et de femmes souffrant de TDAH ont un syndrome prémenstruel important et prolongé.
- Il existe souvent des changements cycliques importants de l’humeur et de l’état d’esprit.
- Il existe un risque plus élevé que la moyenne d’activité sexuelle et de grossesse précoces, ainsi que de maladies sexuellement transmissibles (MST).
- De plus, le risque d’avoir des relations changeantes, insatisfaisantes et de courte durée ou de subir des violences sexuelles est plus élevé.
Puberté et adolescence : la maturation préfrontale joue un rôle crucial dans la puberté, mais aussi dans les symptômes du TDAH. Des fluctuations et des problèmes hormonaux surviennent
- en agissant de manière planifiée et anticipative,
- en reconnaissant les conséquences d’une prise de risque accrue,
- dans la perception de ses propres sentiments et de ceux des autres,
- dans la perception des récompenses (c’est-à-dire que les adolescentes devraient faire des choses plus dangereuses pour ressentir le même frisson) avec moins de possibilités de report des récompenses.
Grossesse, maternité :
- On observe souvent une diminution des symptômes du TDAH en raison de l’augmentation du taux d’œstrogènes ou de l’absence de fluctuations hormonales cycliques.
- Changements hormonaux post-partum et changements graves dus à la vie avec un enfant, avec augmentation des symptômes du TDAH.
- De plus, le TDAH est généralement héréditaire ; avoir un enfant qui souffre également du TDAH représente un défi supplémentaire pour la mère.
Ménopause : entrée dans la ménopause et fin de la fertilité.
- La baisse de la production naturelle d’œstrogènes augmente les symptômes du TDAH, qui sont souvent confondus avec les symptômes de la ménopause.
- Influence négative sur les fonctions cognitives.
Thérapie pour les filles et les femmes
Le TDAH se traite généralement bien de manière multimodale (médicaments, psychoéducation, psychothérapie, etc.). Dans les lignes directrices S3, le traitement du TDAH se distingue selon le degré de gravité. En cas de gravité légère, le traitement doit être essentiellement psychosocial ; en cas de gravité moyenne, une intervention psychosociale et/ou pharmacologique intensifiée doit être proposée après une psychoéducation en fonction des conditions de vie concrètes ; en cas de forme sévère, la pharmacothérapie est au premier plan [38,39]. L’effet des différents médicaments contre le TDAH a été bien étudié chez les femmes et les hommes, chez les enfants et les adultes, et montre des effets importants et de bons taux de réponse.
Une étude de synthèse a inclus 133 études portant sur un total de 14 346 enfants et adolescents et 10 296 adultes et a évalué l’efficacité et la sécurité d’un traitement de 12 semaines par les amphétamines, l’atomoxétine, le bupropion, la clonidine, la guanfacine, le méthylphénidate et le modafinil, les uns par rapport aux autres ou par rapport à un placebo. Les auteurs considèrent le méthylphénidate chez les enfants et les adolescents, ainsi que les amphétamines chez les adultes, comme le traitement de choix dans le traitement de première ligne du TDAH. En outre, les résultats de l’analyse de réseau démontrent l’importance d’une surveillance attentive des changements de poids corporel et de pression artérielle pour tous les médicaments utilisés dans le traitement du TDAH [40].
Étant donné que de fortes variations liées au cycle menstruel et le syndrome prémenstruel peuvent survenir en cas de TDAH, les patientes doivent être informées de ce phénomène et de la possibilité d’un traitement hormonal. Bien entendu, les femmes qui ne souffrent pas de TDAH peuvent également bénéficier d’un soutien hormonal. Chez tous les patients, toujours en évaluant les risques que comporte l’administration d’hormones (par exemple en ce qui concerne l’augmentation du risque thromboembolique). Une attention particulière doit être accordée aux interactions possibles en cas de combinaison de différents médicaments (par exemple, stimulants et œstrogènes). Il est recommandé d’utiliser des préparations à longue durée d’action qui maintiennent des taux d’hormones aussi constants que possible. Les hormones orales (“pilule contraceptive”) utilisées à des fins contraceptives peuvent être prises de manière continue, en accord avec le gynécologue, ou d’autres méthodes de substitution telles que les anneaux hormonaux, les injections de dépôt ou les implants hormonaux peuvent être choisies. D’une part, cela minimise les sautes d’humeur et, d’autre part, les difficultés cognitives font que de nombreux patients ont du mal à penser à la prise quotidienne des comprimés.
En général, il n’y a guère de contre-indications à la combinaison de médicaments contre le TDAH et de préparations hormonales ; des contrôles réguliers des paramètres vitaux et des valeurs de laboratoire sont recommandés pour les deux préparations. Lors d’un nouveau traitement médicamenteux, il convient de prêter une attention particulière aux changements d’humeur. La plupart du temps, on observe une nette stabilisation de l’humeur, mais il est rare que l’on doive envisager une préparation alternative en cas de baisse de l’humeur, ce qui est plutôt attribué aux progestatifs contenus dans les préparations combinées. Les cliniciens rapportent que les femmes atteintes de TDAH sont plus susceptibles de souffrir de la forme la plus grave du trouble dysphorique prémenstruel (PMDS), qui se caractérise par un état dépressif, un sentiment de désespoir, une labilité affective, une colère persistante, un sentiment d’accablement, de la fatigue et de l’anxiété. Pendant ces phases, les femmes concernées ont particulièrement du mal à compenser les symptômes. Il est décrit que, dans ce cas également, la prise de suppléments d’œstrogènes peut soulager la souffrance [30].
En cas de grossesse ou d’allaitement, il est déconseillé de prendre des médicaments contre le TDAH afin d’éviter de nuire à l’embryon. Dans ce domaine, les études sont peu nombreuses. Une étude portant sur 3082 mères a identifié un total de 11 femmes qui avaient pris du méthylphénidate. Aucune anomalie n’a été observée chez leurs enfants. Seul l’abus de stimulants (par exemple la prise de méthylphénidate par voie intraveineuse) a été démontré comme un risque de malformation fœtale. Une autre étude montre une augmentation du taux d’avortement spontané et parfois une diminution de l’index d’Apgar postnatal [41,42].
Or, malgré les nombreuses possibilités de contraception, une grossesse peut survenir à l’insu des patientes atteintes de TDAH alors qu’elles prennent encore des stimulants. Dans ce cas, il convient de demander l’avis de spécialistes, en particulier si un traitement médicamenteux doit être poursuivi dans certains cas.
Résumé
Le TDAH est presque aussi fréquent chez les femmes que chez les hommes. Les symptômes peuvent toutefois se présenter différemment ou n’apparaître qu’à l’adolescence, et il existe des différences dans le développement des comorbidités, de sorte que les femmes sont parfois diagnostiquées moins souvent ou plus tard. Le diagnostic est établi cliniquement selon la CIM ou le DSM, des questionnaires supplémentaires pour les femmes facilitent un diagnostic tenant compte du sexe. Les hormones sexuelles féminines ont une influence décisive sur les symptômes, en particulier les variations du taux d’hormones et une réaction psychique accrue semblent jouer un rôle. Il est important d’informer les patientes et leur entourage à ce sujet. En cas de souhait de substitution hormonale, que ce soit pour la contraception, la ménopause ou la stabilisation de l’humeur, il convient d’envisager des préparations conduisant à des taux d’hormones constants (préparations à long terme) et d’éviter les pauses médicamenteuses, même avec la “pilule contraceptive”. Pendant la grossesse, les symptômes du TDAH s’atténuent souvent et il n’est généralement pas nécessaire de prendre des médicaments. Une influence positive des hormones (naturellement présentes ou substituées) sur les symptômes du TDAH, mais aussi sur l’effet des médicaments contre le TDAH, a été démontrée. Une éducation sexuelle précoce, y compris sur les maladies sexuellement transmissibles (MST), la contraception et les centres de conseil appropriés, est souhaitable. En tant que médecin, il faut penser à évaluer et à traiter le TDAH, en particulier chez les femmes qui essaient de se montrer adaptées et “normales”, mais qui sont confrontées à des difficultés diverses dans la vie, qui font état de réactions excessives aux variations hormonales ou qui ont des enfants atteints de TDAH.
Messages Take-Home
- Les femmes sont moins souvent et plus tardivement diagnostiquées avec le TDAH, et elles consultent souvent pour des problèmes liés à une comorbidité.
- Chez les mères d’enfants atteints de TDAH, il faut également penser à faire un bilan en raison de la forte composante génétique.
- Les grossesses précoces et non désirées ainsi que les maladies sexuellement transmissibles sont plus fréquentes en raison de comportements sexuels à risque.
- Une thérapie hormonale, en plus de son indication réelle (contraception, déficit hormonal), peut également conduire à une amélioration significative des symptômes du TDAH, car ceux-ci sont souvent renforcés par les fluctuations hormonales.
- Le TDAH peut être bien traité, le traitement doit être multimodal si possible.
Littérature :
- Thapar A, Cooper M : Trouble du déficit de l’attention. Lancet 2016 ; 387 : 1240-1250.
- Fayyad J, Sampson NA, Hwang I, et al : The descriptive epidemiology of DSM -IV Adult ADHD in the World Health Organisation World Mental Health Surveys. Atten Deficit Hyperact Disord 2017 ; 9 : 47-56.
- Gaub M, Carlson CL : Gender differences in ADHD : a meta-analysis and critical review. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1997 ; 36 : 1036-1045.
- Gershon J : A meta-analytic review of gender differences in ADHD. J Attent Disord. 2002 ; 5 : 143-154
- Kessler RC, Adler L, Barkley R et al. The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States : results from the National Comorbidity Survey Replication. A, J Psychiatry 2006 ; 163 : 716-723.
- Bruchmüller K1, Margraf J, et al. : Is ADHD diagnosed in accord with diagnostic criteria ? Surdiagnostic et influence du sexe du client sur le diagnostic. J Consult Clin Psychol. 2012 Feb ; 80(1) : 128-138.
- Polanczyk G, de Lima MS, Horta BL, et al :. The worldwide prevalence of ADHD : a systematic review and metaregression analysis. Am J Psychiatry 2007 ; 164 : 942-948.
- Faraone SV, Ghirardi L, Kuja-Halkola R, et al. : La co-agrégation familiale du trouble déficit de l’attention/hyperactivité et du handicap intellectuel : une étude familiale basée sur un registre. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2017 ; 56 : 167-174.e1
- Pearson DA, Yaffee LS, Loveland KA, Lewis KR : Comparaison de l’attention soutenue et sélective chez les enfants souffrant de retard mental avec et sans trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention. Am J Ment Retard 1996 ; 100 : 592-607.
- Naerland T, Bakke KA, et al : Age and gender-related differences in emotional and behavioural problems and autistic features in children and adolescents with Down syndrome : a survey-based study of 674 individuals. J Intellect Disabil Res 2017 ; 61(6) : 594-603.
- Young S, Absoud M, Blackburn C, et al : Guidelines for identification and treatment of individuals with attention deficit/hyperactivity disorder and associated fetal alcohol spectrum disorders based on expert consensus. BMC Psychiatry 2016 ; 16 : 324.
- Leyfer OT, Woodruff-Borden J, Klein-Tasman BP, et al : Prevalence of psychiatric disorders in 4 to 16-years-olds with Williams syndrome. Am J Med Genet B Neuropsychatr Genet 2006 ; 141B(6) : 615-622.
- Landgren M, Svensson L, et al. : Exposition prénatale à l’alcool et troubles neurodéveloppementaux chez les enfants adoptés en Europe de l’Est. Pédiatrie 2010 ; 125 : 1178-1185.
- Niklasson L, Rasmussen P, Oskarsdottir S, Gillberg C : Autisme, ADHD, retard mental et problèmes de comportement chez 100 individus atteints du syndrome de délétion 22q11. Res Dev Disabil 2009 ; 30(4) : 763-773.
- Pane M, Lombardo ME, Alfieri P, et al : Attention deficit hyperactivity disorder and cognitive function in Duchenne muscular dystrophy : phenotype-genotype correlation. J Pediatr 2012 ; 161 : 705-709.
- Sinzig J, Walter D, Doepfner M : Attention deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents with autism spectrum disorder : symptom or syndrome ? J Atten Disord 2009 ; 13 : 117-126
- Xenitidis K, Paliokosta E, Rose E, et al : Présentation des symptômes de l’ADHD et trajectoire chez les adultes atteints de troubles intellectuels légers et borderline. J Intellect Disabil Res 2010 ; 54 : 668-677.
- Neece CL, Baker BL, et al : Attention-deficit/hyperactivity disorder among children with and without intellectual disability : an examination across time. J Intellect Disabil Res 2011 ; 55 : 623-635.
- Pearson DA, Lachar D, et al. : Patterns of behavioural adjustment and maladjustment in mental retardation : comparison of children with and without ADHD. Am J Ment Retard 2000 ; 105 : 236-251
- Lambert NM, Hartsought CS, Sassone D, Sandoval J : Persistance des symptômes d’hyperactivité de l’enfance à l’adolescence et résultats associés. Am J Orthopsychiatry 1987 ; 57 : 22-32.
- Biederman J, Faraone SV, Monuteaux MC, et al. : Gender effects on attention-deficit/hyperactivity disorder in adults, revised. Biol Psychiatry. 2004 ; 55 : 692-700.
- Jensen CM, et al : Comorbid mental disorders in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder in a large nationwide study. Atten Deficit Hyperact Disord 2015 ; 7 : 27-38.
- Biederman J, Petty CR, et al : Adult psychiatric outcomes of girls with attention deficit hyperactivity disorder : 11-year follow-up in a longitudinal case-control study. Am J Psychiat 2010c ; 167 : 409-417.
- Quin PO : Attention-deficit/hyperactivity disorder and its comorbidities in women and girls : an evolving picture. Curt Psychiatry Rep 2008 ; 10 : 419-423.
- Ottonen, et al : Sex differentes in comorbidity Patterns of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Child and Idol Psych 2018 ; Vol 58, Issue 4, 412-422.
- Sun S, Kuja-Halkola R, Faraone SV, et al : Association of Psychiatric Comorbidity With the Risk of Premature Death Among Children and Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. JAMA Psychiatrie. Publié en ligne le 07 août 2019. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.1944.
- Nadau K : Suis-je différent ? Filles et femmes souffrant de TDA. Juvemus-Selbstverlag, Coblence 2001.
- Krause J, Krause KH : TDAH à l’âge adulte. Éditions Schattauer, Stuttgart-New York 2005, 113.
- Chronis-Tuscano A, Seymour KE, et al. : Efficacité du système oral à libération osmotique, (OROS) méthylphénidate pour les mères souffrant de troubles du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) : rapport préliminaire des effets sur les symptômes du TDAH et le parentage. J Clin Psychiatry 2008 ; 69 : 1938-1947.
- Solden S : “Die Chaosprinzessin”, Munich, Forchheim : BH-AH 1999
- Ryffel-Rawak D : Le TDAH chez les femmes – à la merci des émotions. Huber, Berne 2004, ISBN 3-456-84121-3.
- Walton E, Pingault JB, Cecil CA, et al : Epigenetic profiling of ADHD symptoms trajectories : a prospective, methylome-wide study. Mol Psychiatry 2017 ; 22 : 250-256.
- WURS, Ward MF, Wender PH, Reimherr FW : The Wender Utah rating scale : an aid in the retrospective diagnosis of childhood attention deficit hyperactivity disorder. Am J Psychiatry 1993 ; 150 : 885-890.
- Brown TE. Échelles Brown Attention – Deficit Disorder pour enfants et adolescents (BrownADDScales). San Antonio, TX : Psychological Corp 2001.
- Christiansen H, Kis B, et al : Validation française des échelles d’évaluation Conners Adult ADHD Rating Scales (CAARS) 2 : fiabilité, validité, sensibilité diagnostique et spécificité. Eur Psychiatry 2011 ; 27 : 321-328.
- Helgadóttir H, Gudmundsson ÓÓ, Baldursson G, et al. : L’électroencéphalographie comme outil clinique pour le diagnostic et le suivi du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité : une étude transversale. BMJ Open 2015 ; 5 : e005500
- Hormones sexuelles et psyché : bases, symptômes, maladies, thérapie, Herbert Kuhl, Georg Thieme Verlag 2002.
- Banaschewski T (coordinateur du guide), Hohmann S, Millenet S, et al. : version longue du guide interdisciplinaire basé sur les preuves et le consensus (S3) “Trouble du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte” 2018 ; numéro de registre AWMF 028-045. www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/028-045l_S3_ADHS_2018-06.pdf Cortese S, Adamo
- N Del Giovane C, et al : Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults : a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry 2018.
- Arnett A, Stein M : Refining treatment choices for ADHD. Lancet Psychiatry 2018 ; 30295-30299.
- Centre de pharmacovigilance et de conseil en toxicologie embryonnaire. Méthylphénidate. www.embryotox.de/methylphenidat.html (consulté le 14.10.2019)
- Bro SP, Kjaersgaard MI, Parner ET et al. Résultats défavorables de la grossesse après exposition au méthylphénidate ou à l’atomoxétine pendant la grossesse. Clinical epidemiology 2015 ; 7 : 139-147.
HAUSARZT PRAXIS 2019 ; 14(12) : xx-xx