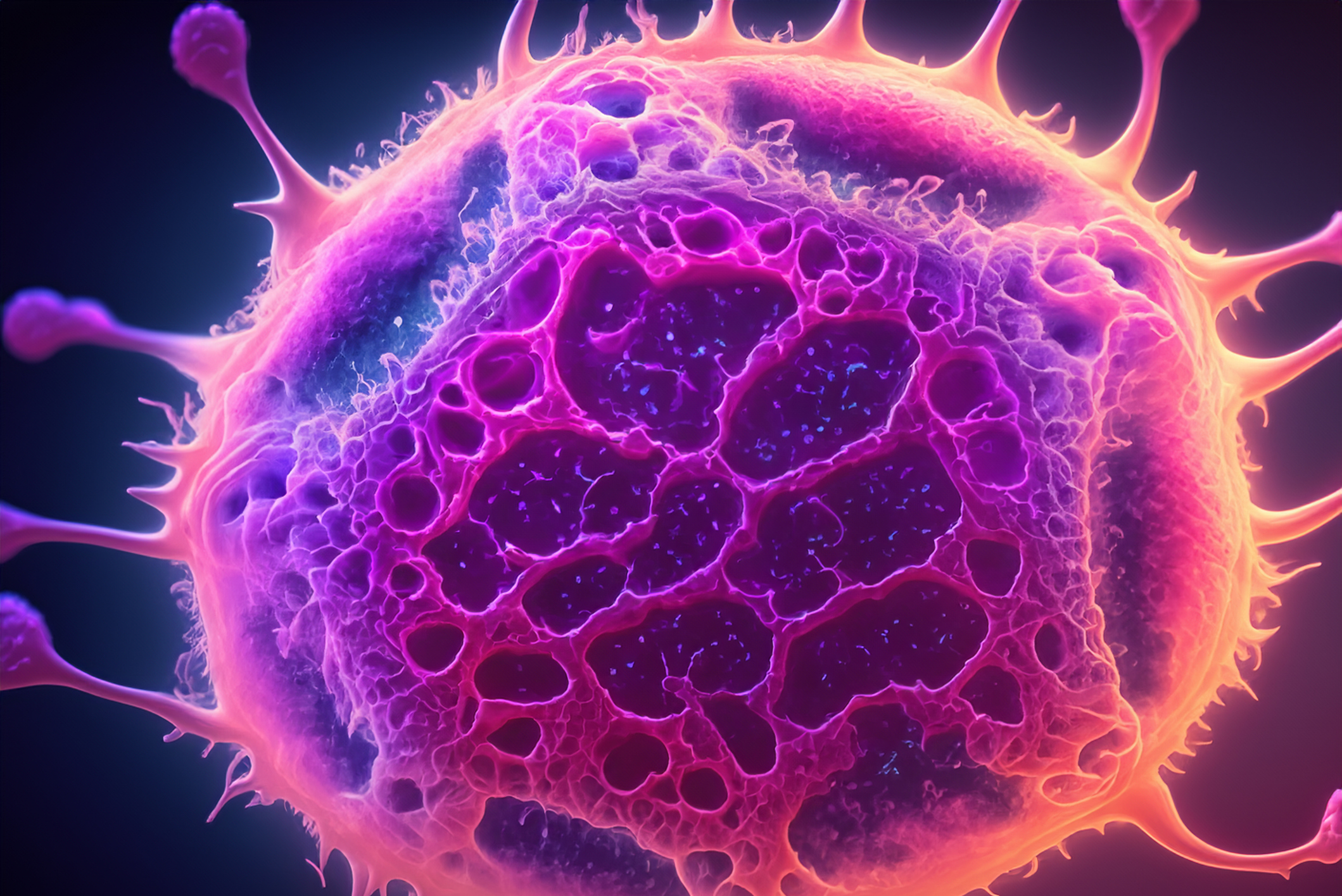Au 18e siècle, Christian Kerner a émis l’hypothèse que les effets d’un certain poison, le botulinum, pouvaient être utilisés pour traiter les crampes et la production excessive de sueur et de salive dans l’organisme. L’hypothèse de Kerner s’est vérifiée environ deux siècles plus tard grâce à l’utilisation du botulisme dans la dermatologie esthétique moderne.
Une digression historique permet d’expliquer comment la toxine contenue dans la saucisse fumée s’est transformée en substance active miracle dans la médecine esthétique.
Il était une fois…
Le premier cas de botulisme est apparu en 1735. En 1793, 13 paysans de Wildbad, en Allemagne, ont partagé un gros boudin fumé non cuit et sont tombés gravement malades, six d’entre eux en sont morts. Lors d’un mariage en 1895, toujours dans le sud de l’Allemagne, du jambon salé non cuit a été servi à la musique de danse au lieu du délicieux repas de mariage. 34 musiciens se sont empoisonnés, trois d’entre eux ont été tués ! Au début du 20e siècle, le botulisme a fait des ravages aux États-Unis, détruisant la quasi-totalité de l’industrie de la conserve (“can-disease”) de produits alimentaires, ce qui a conduit au développement de technologies de lutte contre le botulisme dans les conserves.
Dans le sud de l’Allemagne, la tradition à cette époque était de fumer la charcuterie plutôt que de la cuire. En 1817, le Dr Justinus Christian Kerner (1786-1862), poète romantique et médecin officiel du Bade-Wurtemberg, a décrit dans les “Tübinger Blätter für Naturwissenschaften und Arzneykunde” les effets d’un certain poison présent dans les saucisses avariées, fumées mais non cuites. Kerner notait déjà à l’époque que cette toxine pourrait servir ultérieurement de “formidable médicament pour traiter les spasmes et réduire l’excès de salive, de larmes et de sueur”. Cependant, Kerner n’avait pas vraiment d’idée sur la cause de cette intoxication, car à cette époque, la bactérie n’avait pas encore été découverte. Celui-ci n’a été démontré que 20 ans plus tard, lorsque le chimiste Louis Pasteur (1822-1895) a mis en évidence la fermentation microbienne du vin, prouvant ainsi l’existence des micro-organismes. Rechercher une cause vivante à une maladie était loin d’être une pratique courante du vivant de Kerner. La foi en l’alchimie, qui a été remplacée plus tard par la chimie et la pharmacologie, était presque sans limite. Ainsi, Kerner a d’abord soupçonné la nourriture malsaine des porcs engraissés d’être à l’origine des saucisses avariées, puis des coups de foudre potentiels sur les points de fumage des saucisses.
L’observation qu’après un certain temps post-mortem, une sorte de couche de cire se forme autour des cadavres et que la même couche de graisse se forme de la même manière pour les saucisses et les jambons, l’a finalement conduit à la théorie des acides gras. Il publia en 1822 un long traité intitulé “Das Fettgift oder die Fettsäure und ihre Wirkung auf den thierischen Organismus, ein Beytrag zur Untersuchung des Stoffes in beschädigen Würsten giftig werden” (Le poison gras ou l’acide gras et son effet sur l’organisme animal, contribution à l’étude de la substance qui devient toxique dans les saucisses avariées). En raison de ses travaux dans ce domaine, on appelait alors le botulisme la “maladie de Kerner”. En 1882, Robert Koch (1843-1910) a découvert le bacille de la tuberculose, ce qui lui a valu le prix Nobel de médecine en 1905. Les conséquences découlant des travaux de Pasteur et de Koch, et plus généralement de la bactériologie, ont été révolutionnaires. Pour la première fois dans l’histoire de la médecine, les causes de nombreuses maladies étaient connues, jetant ainsi les bases d’une thérapie causale.
En 1897, Pierre Marie van Ermengem (1851-1932), un élève de Robert Koch, a pu isoler l’agent pathogène responsable du botulisme, réfutant ainsi la théorie des acides gras de Kerner. Il a appelé cette bactérie Bacillus botulinus (du latin botulus, saucisse), qui est aujourd’hui appelée Clostridium botulinum (notez que c’est pour cette raison que la substance active connue aujourd’hui s’appelle “Botulinum” et non “Botulinus”).
Un poison apprend à marcher
En 1905, Tchitchikine a reconnu que la toxine formée était une neurotoxine et en 1919 (donc après la Première Guerre mondiale), les premières mesures quantitatives ont été effectuées par Burke. Mais en principe, la recherche sur le botulisme est restée longtemps calme, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Craignant l’utilisation d’armes chimiques, le chercheur Eduard Schantz s’est intéressé de près à la structure de la protéine pour le compte de l’armée américaine. Ses travaux étaient toutefois soumis au secret le plus absolu. En 1949, Burgen a pu montrer que l’effet de la toxine botulique n’était pas dû à un blocage postsynaptique, comme on le pensait jusqu’alors, mais à une inhibition présynaptique de l’acétylcholine (chimiodénervation). Cette découverte a ouvert la voie à des bases théoriques ultérieures pour l’application clinique du botulisme.
Sans la vision, l’engagement et la persévérance face aux nombreux échecs de deux scientifiques, le développement du médicament Botulinum n’aurait jamais été possible. Le Dr Alan Scott, ophtalmologue à San Francisco, a cherché à la fin des années 1960 une méthode de traitement alternative à l’opération du strabisme, qui était courante à l’époque. Ce moteur l’a mis en contact avec Ed Schantz, qui s’est par la suite montré responsable de la production de la toxine. Grâce à de nombreux essais et à d’autres développements, Scott a pu publier, huit ans après sa première idée, l’application du botulisme chez l’homme sous le titre “Botulinum toxin injection of eyes muscles to correct strabismus”. De nombreuses autres indications ont suivi, majoritairement dans le domaine neurologique comme le blépharospasme, le torticolis, le pied bot, le spasme hémifacial, mais aussi dans d’autres domaines comme la gastroentérologie (achalasie, fissure anale), l’oto-rhino-laryngologie, la gynécologie ou l’urologie. On pouvait affirmer : “ubi musculus, ibi botulinum” (là où il y a un muscle, il y a du botulinum). L’idée audacieuse du médecin officiel, le Dr Justinus Kerner, était devenue réalité : Le poison n’était plus un poison, mais un médicament très efficace.
L’hyperhidrose, précurseur de la dermatologie esthétique
Jean Carruthers était une jeune interne d’Alan Scott et traitait des patients atteints de blépharospasme avec du Botulinum dans sa clinique ophtalmologique. Elle a constaté que les patients souhaitaient de plus en plus faire traiter la partie non malade de leur visage, car les ridules gênantes du côté traité avaient disparu. De plus, les patients ont été séduits par leur nouvelle expression faciale détendue. Avec son époux, Alastair, un dermatologue de Vancouver, au Canada, Carruthers a développé en 1995 une nouvelle indication du traitement par botuline : l’indication esthétique pour le traitement des rides d’expression. Il est intéressant de noter dans ce contexte que, malgré l’approbation de la FDA pour le blépharospasme depuis 1985, Scott n’a pas pu imposer son médicament breveté sous le nom d’Occulinum® à l’époque en raison du manque d’intérêt. Le médicament de la société Allergan (qui, soit dit en passant, ne fabriquait à l’époque que des produits ophtalmologiques), désormais appelé Botox®, a progressivement gagné en notoriété, bien que l’on ne puisse en aucun cas parler de percée au milieu des années 1990. L’étape révolutionnaire dans le développement de la dermatologie esthétique, à savoir la découverte que les rides pouvaient être traitées “de manière conservatrice” à l’aide d’un médicament et que l’on pouvait ainsi renoncer aux liftings chirurgicaux coûteux, se faisait encore attendre. La clientèle pour cette indication était tout simplement trop restreinte à l’époque.
La notoriété du Botox® s’est accrue avec la nouvelle indication de l’hyperhidrose. Bushara a fait état pour la première fois en 1996 d’une thérapie possible dans le traitement de l’hyperhidrose focale. Il a découvert, en fait de manière plus incidente, que les patients qu’il examinait pour un syndrome hémifacial transpiraient moins dans la zone traitée. Il a publié ses résultats sous le titre : “Botulinum Toxin : a possible new treatment for axillary hyperhidrosis”. Cette nouvelle indication a rencontré une population de patients au potentiel incommensurable, si l’on considère que 1 à 3% de la population totale souffre d’hyperhidrose focale, le chiffre noir estimé étant plutôt de 8 à 10%.
En Suisse, l’auteur de cet article a traité pour la première fois en 1997 un patient avec du Botox® dans l’indication de l’hyperhidrose focale (fig. 1). La demande qui s’en est suivie a été si écrasante qu’en peu de temps, la première “consultation hyperhidrose” de Suisse a été mise en place à la clinique dermatologique de l’hôpital universitaire de Zurich.

Fig. 1 : Le traitement de l’hyperhidrose focale par le botulisme est extrêmement efficace. Cette nouvelle forme de traitement, apparue à la fin des années 1990, a permis de traiter un nombre de patients sans précédent dans le monde. De nos jours, le traitement de l’hyperhidrose peut être considéré comme un précurseur de l’établissement de la dermatologie esthétique.
Dans d’autres pays d’Europe, ainsi qu’aux États-Unis et au Canada, la demande était tout aussi élevée et un très grand nombre de patients ont ainsi été traités en très peu de temps par le Botulinum avec un succès extrême, sans qu’il n’y ait jamais eu d’effets secondaires ou de complications notables. Grâce à d’autres rapports scientifiques, principalement dans le domaine de l’hyperhidrose, le nombre de traitements esthétiques au Botox® en dermatologie a finalement augmenté (fig. 2).

Fig. 2 : Avec plus de 5 millions de traitements au Botox® rien qu’aux États-Unis en 2011, le Botulinum est de loin l’agent de chirurgie esthétique le plus utilisé. Cela représente une augmentation de 123% au cours des 10 dernières années ! A titre de comparaison, les interventions esthétiques avec fillers (injections d’acide hyaluronique) sont loin derrière, avec 1,9 million d’interventions.
Selon les statistiques de l'”American Society for Aesthetic Plastic Surgery” (ASAPS), 5 670 788 patients ont été traités avec du Botulinum dans l’indication de la thérapie des rides rien qu’aux États-Unis en 2011. Ce chiffre correspond à une augmentation de 5% par rapport à l’année précédente. Les chiffres de 2012 ne sont pas encore publiés, mais une chose est sûre : la tendance est à la hausse !