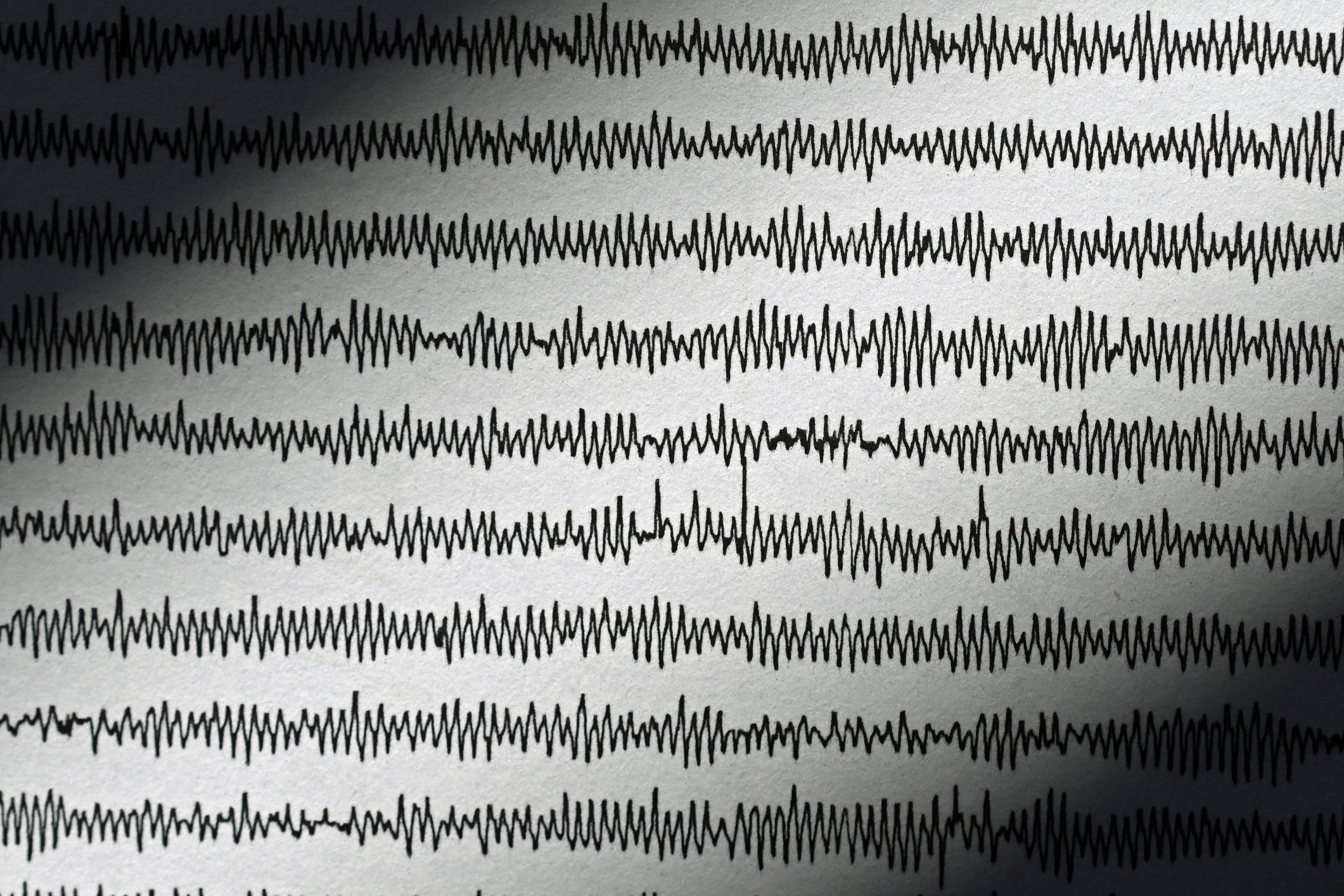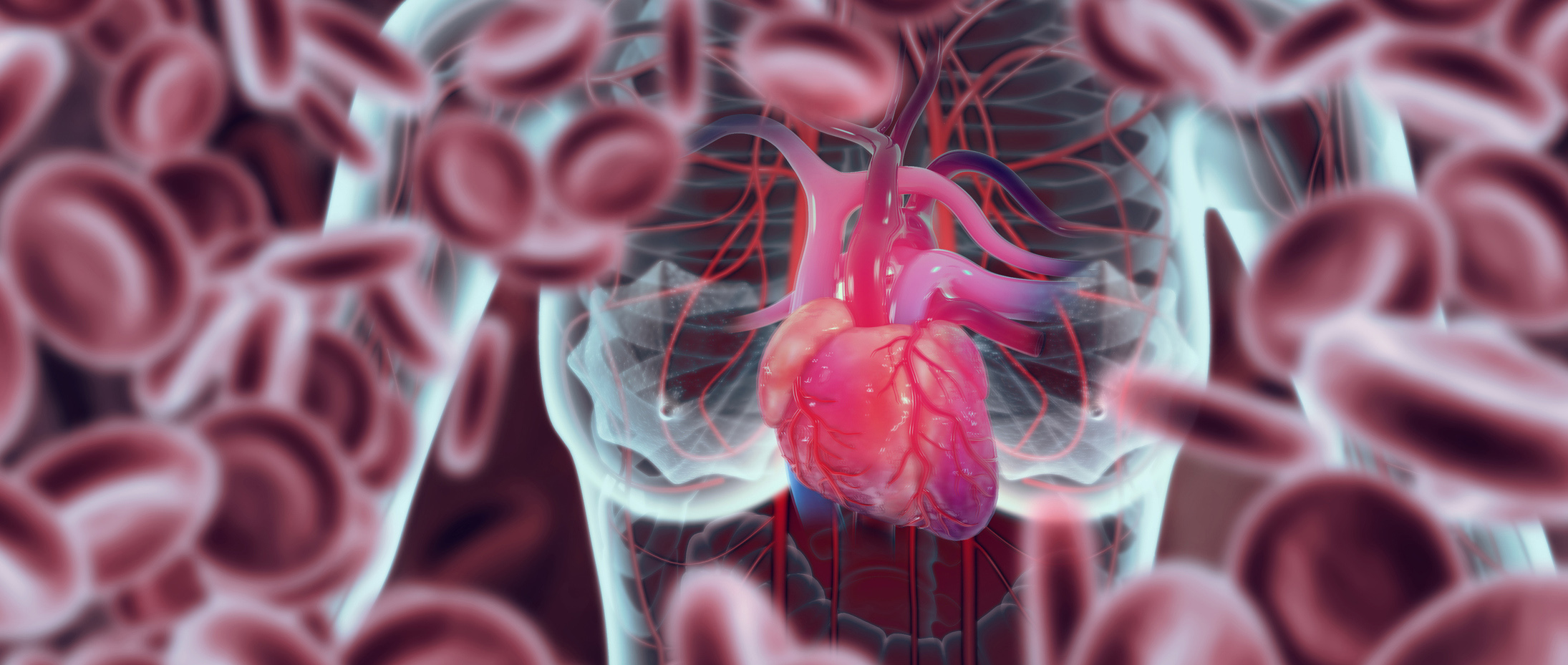La maladie d’Alzheimer est la forme la plus courante de maladie neurodégénérative chez les personnes de plus de 65 ans et se caractérise par une démence progressive. L’objectif de la recherche actuelle sur la maladie d’Alzheimer est de détecter ces troubles à un stade précoce et de développer des approches thérapeutiques modifiant la maladie en conséquence. Les premières possibilités prometteuses existent.
Si l’on regarde de plus près l’évolution clinique de la maladie d’Alzheimer, le symptôme précoce classique est décrit comme un trouble de la mémoire à court terme et de l’apprentissage. Il existe également un lien avec la détérioration cognitive liée à l’âge, ce qui rend difficile la classification des symptômes précoces indifférents dans le processus de la maladie. Au fur et à mesure de l’évolution, les plaintes deviennent plus concrètes et passent par des troubles épisodiques de la mémoire autobiographique et une perturbation de la pensée visuo-spatiale, puis par des troubles du langage et enfin par des troubles moteurs et végétatifs.
La cascade physiopathologique de la maladie commence souvent 10 à 15 ans avant que les patients ne se présentent pour la première fois. Des biomarqueurs dans le liquide céphalorachidien ou différentes techniques d’imagerie peuvent fournir des informations sur le statut de la maladie d’Alzheimer et la présence d’un éventuel sous-type. Une étude récente a montré une atrophie asymétrique focale droite dans la région temporo-pariétale chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer (MA), qui avaient une fonction visuospatiale moins bonne que les patients symptomatiques de la MA. Les différents sous-types s’expliquent probablement aussi par le fait que la neurodégénérescence s’attaque à différentes zones et se manifeste à certains endroits vulnérables.
Focus sur les biomarqueurs
Les deux principaux biomarqueurs analysés dans le cadre du diagnostic du LCR sont des taux réduits de protéines bêta-amyloïdes et des taux élevés de protéines tau. On constate cependant régulièrement que les deux protéines varient indépendamment l’une de l’autre et ne présentent pas toujours des valeurs anormales dès le diagnostic. C’est pourquoi, dans le cas de la maladie d’Alzheimer en particulier, tous les patients ne se trouvent pas dans le quadrant du diagnostic de base. Néanmoins, l’analyse du LCR reste l’un des points forts dans le diagnostic de la maladie d’Alzheimer en raison de ses biomarqueurs clairs. Cependant, comme elle est précédée d’une procédure assez invasive, des recherches sont menées depuis des années sur l’analyse du plasma sanguin. Une toute nouvelle technique a été mise au point, qui permet de détecter dans le sang de minuscules quantités d’un fragment de protéine associé à la maladie d’Alzheimer. Ils ont également cherché à savoir si la protéine Phospo-tau 217 pouvait également refléter le stade exact de la maladie.
Un traitement efficace commence tôt
Avec l’amélioration du diagnostic précoce, la fenêtre thérapeutique se déplace de plus en plus vers le domaine préclinique. L’accent est mis sur la prévention de la maladie d’Alzheimer pour les personnes présentant un risque élevé. En outre, plusieurs études sur des agents modificateurs de la maladie sont en cours et leur issue est attendue avec impatience. Un exemple est le traitement à base d’anticorps avec la substance active aducanumab. La première analyse n’a pas montré d’effets significatifs, mais la seconde analyse a montré des effets positifs sur une période plus longue, en particulier avec un dosage élevé. En attendant l’utilisation des nouvelles molécules, il reste à protéger les réserves cognitives à l’aide de facteurs liés au mode de vie et à la réduction des facteurs de risque. L’OMS a publié des lignes directrices à ce sujet, avec des conseils concrets sur le comportement des patients, qui fournissent des conseils fondés sur des données probantes en matière d’exercice, de nutrition et de facteurs sociaux.
Source : DGN 2020
InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2021 ; 19(1) : 34 (publié le 2.2.21, ahead of print)