Les examens médicaux des pilotes et des candidats pilotes en Suisse sont régis par les directives de l’AESA (Agence européenne de la sécurité aérienne) ; il s’agit d’une législation européenne [1–3]. La décision concernant l’aptitude au vol incombe aux médecins aéronautiques (Aeromedical Examiner, AME), qui prennent la décision en collaboration avec les experts et la section de médecine aéronautique de l’OFAC (Office fédéral de l’aviation civile). Outre l’aptitude au vol sans restriction et l’inaptitude au vol, il existe également des catégories d’aptitude au vol avec restriction, dont les deux principales sont : “operational multi-pilot limitation” (OML) pour les pilotes de classe 1 et “operational safety pilot limitation” (OSL) pour les pilotes de classe 2 [1,2]. Depuis juin 2012, les pilotes sous anticoagulation avec des antagonistes de la vitamine K et, depuis peu, ceux qui utilisent des NOAC (nouveaux anticoagulants oraux) peuvent désormais être déclarés aptes à voler avec une limitation OML ou OSL, si certaines conditions sont remplies [3].
L’aviation est strictement réglementée à tous les niveaux, y compris celui des licences des pilotes. Pour pouvoir exercer son activité de pilote, un pilote doit être titulaire d’une licence de pilote et d’un certificat médical valide (appelé “certificat médical”).
Conditions générales de médecine aéronautique
En Suisse, l’aviation est régie par les dispositions de l’AESA (fig. 1), qui est une agence de l’UE. La Suisse est membre de l’AESA. La législation de l’AESA est reprise 1:1 par la Suisse. Les règlements médicaux de l’EASA ont été créés il y a quelques années seulement et sont en vigueur en Suisse depuis le 01.06.2012, ils ont remplacé les anciens règlements médicaux des JAA (Joint Aviation Authorities, JAA) [1–4].
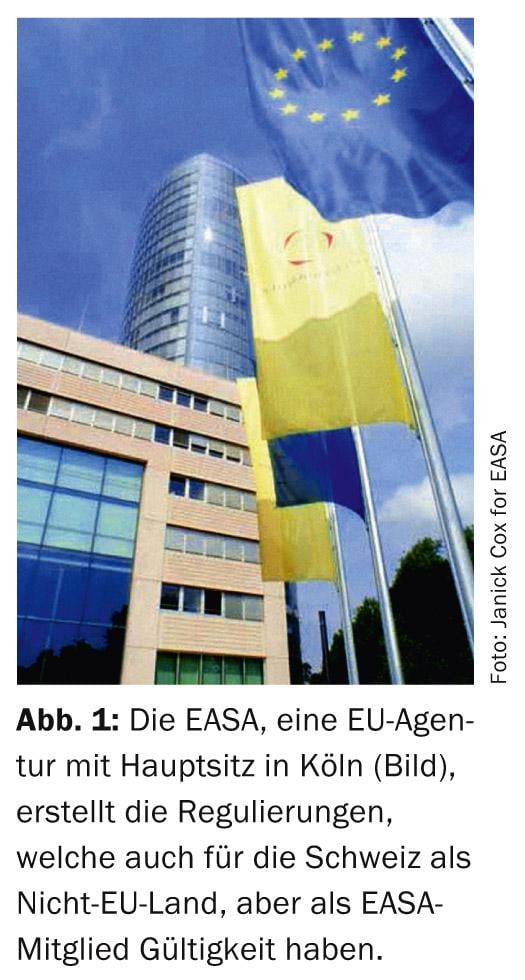
Les pilotes doivent se soumettre à des examens médicaux réguliers, effectués par des médecins aéronautiques (AME) désignés par l’OFAC. Le service de médecine aéronautique de l’OFAC est dirigé par le médecin-chef de l’OFAC. Il nomme également, si nécessaire, des experts qui seront consultés en fonction du cas médical en question. Par exemple, il y a actuellement cinq experts en cardiologie à l’OFAC.
Différentes catégories médicales
Il existe différentes catégories de licences de pilote et, en conséquence, différents Medicals [1,2]. Le médical de classe 1 est requis pour le vol professionnel, par exemple pour un pilote de SWISS (illustration 2). Les certificats médicaux de classe 2 et LAPL (Light Aircraft Pilot Licence, LAPL) sont des certificats médicaux pour le vol non professionnel, ce qui ne concerne pas seulement les pilotes de vol à moteur privé, mais aussi les pilotes de planeur et les aérostiers. La plupart des pilotes de vol motorisé sont titulaires d’un certificat médical de classe 2. Les pilotes de classe 1 doivent passer un examen médical annuel, ou semestriel s’ils sont âgés de plus de 60 ans. Les pilotes de classe 2 et de LAPL ne doivent passer un examen médical que tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans, puis tous les deux ans de 40 à 50 ans, ensuite tous les ans pour les pilotes de classe 2 et tous les deux ans pour les pilotes de LAPL.

Les pilotes et la maladie coronarienne
Après un événement coronarien (infarctus aigu du myocarde et/ou PTCA/stenting ou pontage AC), le pilote est inapte au vol pendant six mois avec un médical de classe 1 et un médical de classe 2. C’était le cas pour les règlements médicaux des JAA et c’est également le cas selon les règlements médicaux actuels de l’EASA [3,4]. L’idéal est que l’expert cardiologue de l’OFAC soit impliqué assez rapidement (en lui transmettant les rapports correspondants), de sorte que les jalons pour la récupération de l’aptitude au vol puissent être posés suffisamment tôt. Six mois après l’événement coronarien, un bilan doit être effectué par un cardiologue. Celle-ci peut être effectuée auprès d’un expert en cardiologie de l’OFAC, mais ce n’est pas obligatoire. En plus des examens habituels tels que l’échocardiographie et l’épreuve d’effort conventionnelle, un autre examen doit être effectué pour exclure une ischémie coronarienne liée à l’effort dans les cas de statut après PTCA/stenting, soit un examen SPECT de perfusion myocardique, une échocardiographie de stress ou une IRM.
En présence d’une fonction ventriculaire gauche nettement réduite ou d’une ischémie coronarienne liée à l’effort, l’aptitude au vol n’est pas donnée. Si les résultats sont bons, le pilote de classe 2 peut être déclaré apte à voler sans restriction, mais il devra subir des examens cardiologiques de contrôle réguliers, en général une fois par an. Les pilotes de classe 1 peuvent être déclarés aptes au vol avec l’obligation d’une “limitation opérationnelle multipilote” (OML) s’ils ont une bonne évaluation de leur situation cardiologique. Cela signifie qu’en tant que professionnels, ils ne peuvent voler que dans un cockpit de deux personnes. Cela ne pose aucun problème à un pilote de ligne, car il ne vole jamais seul. Mais c’est un problème pour les pilotes d’hélicoptères professionnels. Cette limite OML peut signifier la fin de la carrière de pilote professionnel pour un tel pilote. Nous essayons actuellement d’obtenir de l’EASA que la réglementation soit modifiée de manière à ce que l’évaluation des pilotes de classe 1 souffrant de maladies coronariennes soit abordée de manière plus différenciée. L’objectif serait que ceux qui se trouvent dans une catégorie de risque coronaire faible puissent être déclarés aptes à voler sans restriction, comme les pilotes de classe 2. D’autre part, l’aptitude au vol des pilotes de classe 2 qui ont des antécédents coronariens très chargés (par exemple, de nombreux stents sur les artères coronaires principales) doit être évaluée. Entre la décision d’une aptitude au vol sans restriction et celle d’une inaptitude au vol, il existe encore la possibilité, pour les pilotes de classe 2, de prononcer l’aptitude au vol avec l’obligation d’une “limitation du pilote en matière de sécurité opérationnelle” (OSL). Dans ce cas, le pilote ne peut voler qu’avec un pilote de sécurité.
Les pilotes et l’anticoagulation
Parmi les requêtes médicales des JAA, les pilotes sous anticoagulation étaient inaptes au vol [4]. Cela a conduit, par exemple, à l’utilisation de bioprothèses pour des pilotes plus jeunes lors d’une opération de remplacement de la valve aortique, sans quoi il n’aurait plus été possible de piloter des avions. Avec le soutien d’autres médecins aéronautiques étrangers, nous avons profité de la phase de consultation en vue de l’élaboration des règlements médicaux de l’EASA et avons soumis à l’EASA la proposition selon laquelle une aptitude au vol avec limitation OML ou OSL peut être prononcée pour les pilotes sous anticoagulation si le risque de la maladie sous-jacente à l’anticoagulation n’est pas très important en soi. La proposition a été acceptée et le texte a été intégré 1:1 dans les règlements médicaux de l’EASA en vigueur [3]. L’anticoagulation par antagonistes de la vitamine K doit alors être bien contrôlée. En ce qui concerne les NOAC, l’EASA a été très réticente et a considéré jusqu’en novembre 2013 que les NOAC ne pouvaient pas être utilisés chez les pilotes, même si cela n’était pas explicitement interdit par les règlements médicaux de l’EASA. En Suisse, nous avons accepté la prise de NOAC par les pilotes depuis l’été 2012. Nous avons également fait pression sur l’EASA et obtenu que les NOAC puissent être acceptés à l’avenir (avec limitation OML ou OSL).
Pilotes souffrant d’autres maladies cardiaques
Les règlements médicaux de l’EASA contiennent parfois des instructions détaillées sur la manière de procéder en cas d’événement cardiaque, parfois seulement un cadre général. Un exemple de prescription détaillée a été donné ci-dessus sous Maladie coronarienne. D’un autre côté, il est bon que le régulateur n’ait pas essayé de tout régler en détail, par exemple dans le cas des arythmies. La décision concernant l’aptitude au vol est alors laissée au médecin de l’aviation ou à l’expert correspondant. Toute décision concernant l’aptitude au vol doit en principe être accompagnée d’une stratification des risques. Dans ce contexte, la règle dite de 1% ou de 2% a fait ses preuves. La règle de 1% (pour les pilotes de classe 1) stipule que le risque annuel d’une “sudden incapacitation” (événement au cours duquel le pilote ne peut plus assurer la fonction de pilotage – par exemple décès, collapsus, crise d’épilepsie, etc. Il en va de même pour la règle des 2% que l’on applique aux pilotes privés. Prenons un exemple en cardiologie, la cardiomyopathie obstructive hypertrophique (COH). Une fois le diagnostic posé, le cardiologue procède à une stratification du risque. L’implantation d’un DAI (défibrillateur implantable) est recommandée aux patients qui se trouvent dans une catégorie de risque élevé, mais pas aux autres. De même, nous avons pu déclarer certains patients atteints d’HOCM à faible risque aptes à prendre l’avion, ce qui n’avait pas été possible pour les patients appartenant à une catégorie de risque plus élevée.
En résumé, les décisions relatives à l’aptitude au vol des personnes souffrant de problèmes cardiaques doivent généralement être prises au cas par cas. Pour les pilotes présentant des états cardiaques anormaux récemment apparus, on essaie bien entendu de trouver de bonnes solutions, en mettant en balance la préservation de l’aptitude au vol (l’intérêt du pilote) et l’aspect sécurité – surtout dans l’aviation professionnelle.
Dr. med. René Maire
Dr. med. Severin Muff
Littérature :
- Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; 20.02.2008 (“Règlement de base”).
- Règles de mise en œuvre : Règlement de la Commission (UE) n° 1178/2011 ; 03.11.2011.
- EASA : Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to (EU) No 1178/2011, Part-MED1, Initial issue : 15.12.2011.
- Exigences communes de l’aviation, JAR-FCL3, Licence d’équipage de conduite (médicale) ; 01.12.2006.
CARDIOVASC 2015 ; 14(1) : 27-30











