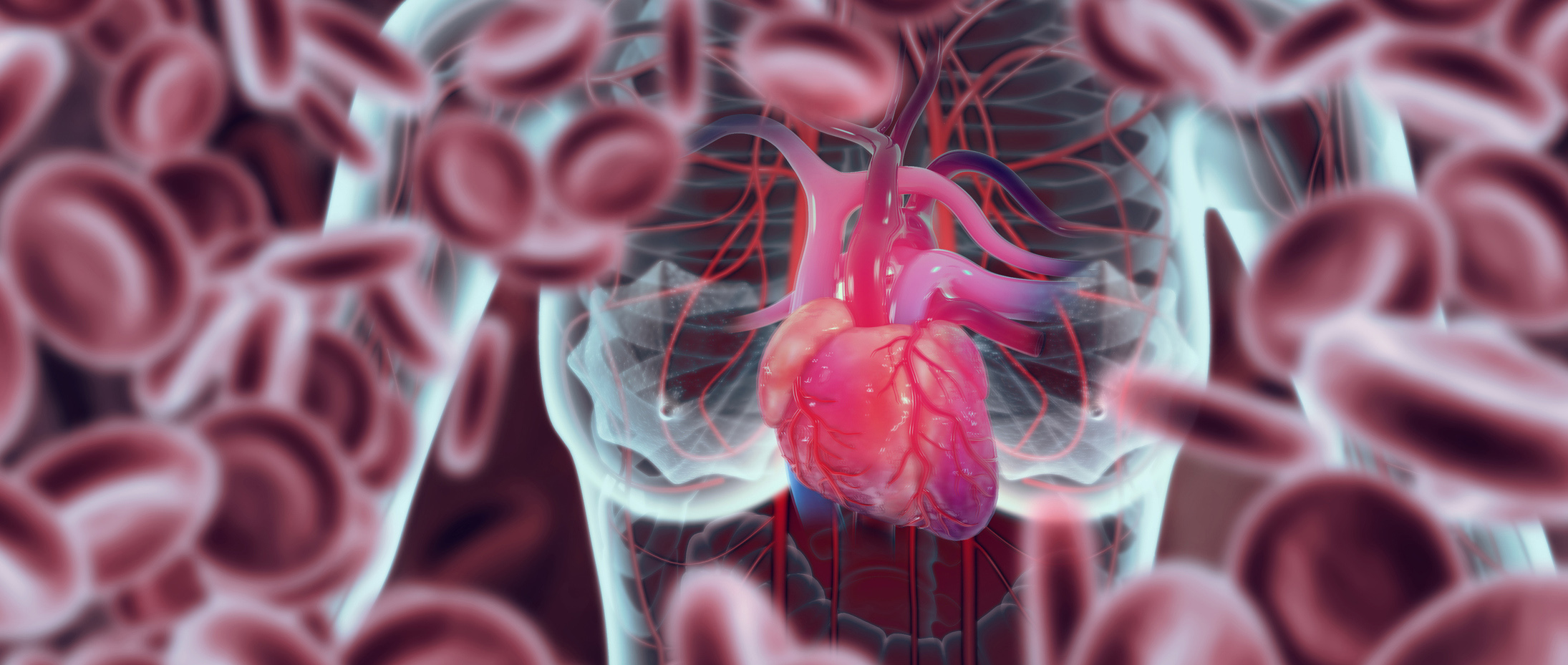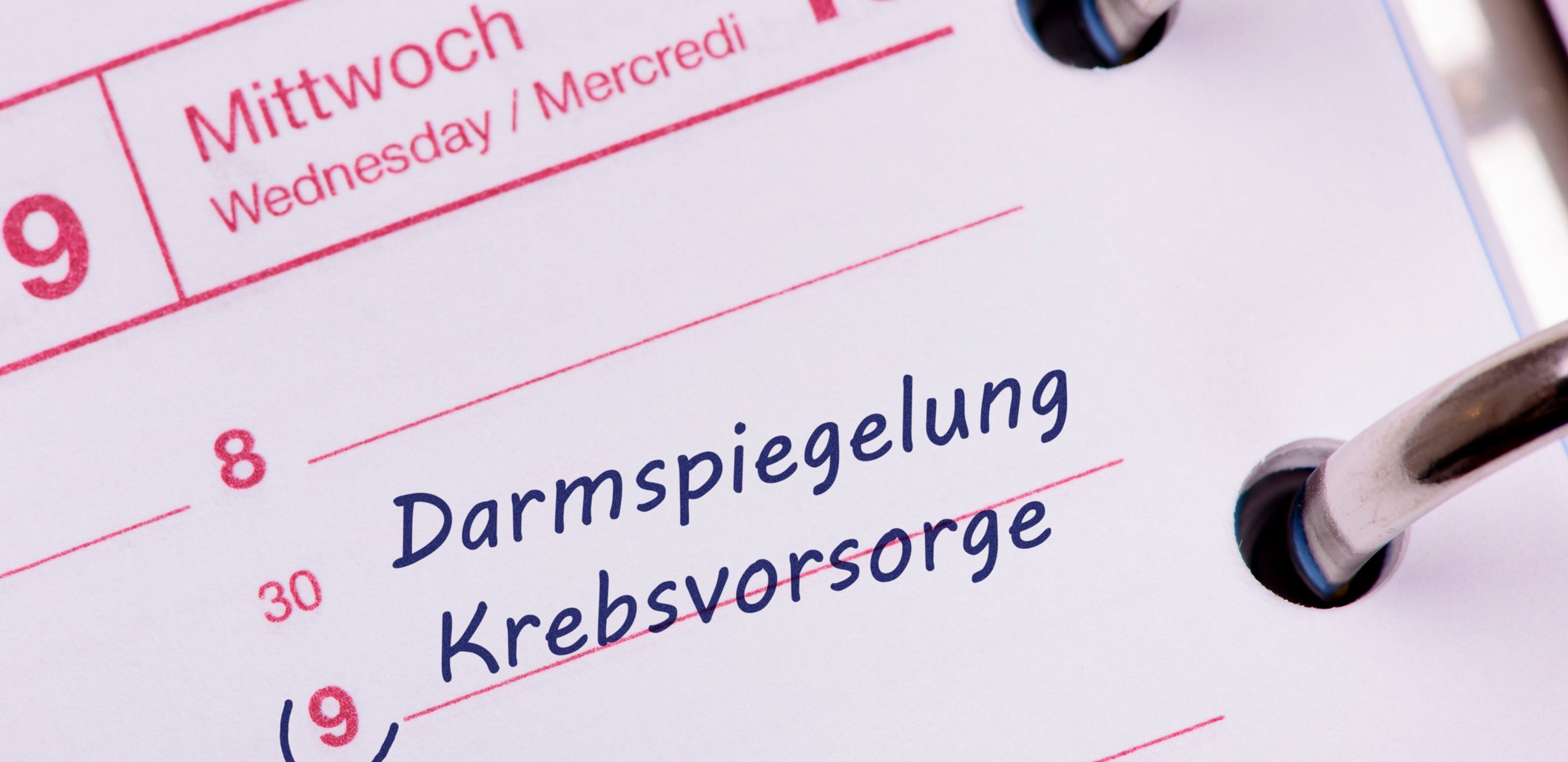Le taux de prévalence sur la vie entière tant pour les troubles bipolaire-I que bipolaire-II est d’environ 1%. Au moins 1% de la population remplit les critères diagnostiques pour un des nouveaux troubles bipolaires sous le seuil diagnostique du trouble bipolaire-II selon le DSM-5. Les troubles bipolaires s’accompagnent souvent de troubles psychiatriques comorbides et de maladies somatiques, induisant ainsi un taux de mortalité élevé. L’évolution des troubles bipolaires est souvent défavorable, caractérisée par une première manifestation souvent avant l’âge de 18 ans et un haut risque de rémissions incomplètes, de récidives et de suicides. Le trouble bipolaire-I montre une agrégation familiale spécifique; le risque de développer un tel trouble est au moins trois fois plus élevé pour un membre de la famille d’un patient bipolaire que pour un membre de la famille d’un sujet sain.
Les troubles bipolaires sont caractérisés par une fluctuation anormale de l’humeur avec l’apparition d’épisodes maniaques ou hypomaniaques. Un épisode maniaque peut s’accompagner de symptômes psychotiques et entraîne toujours une altération du fonctionnement, alors que l’épisode hypomaniaque modifie le fonctionnement sans entraîner une altération significative.
Le trouble bipolaire-I est caractérisé par l’apparition d’épisodes maniaques. Cependant, la large majorité des patients atteints de ce trouble connaissent aussi des épisodes dépressifs, alors que le trouble bipolaire-II se définit par l’apparition d’épisodes hypomaniaques et dépressifs. La cyclothymie est caractérisée par l’alternance, pendant au moins deux ans,
de symptômes hypomaniaques et dépressifs sans que les critères d’un épisode dépressif ne soient réunis.
Durant les trois dernières décennies, de nombreuses études épidémiologiques basées sur une méthodologie rigoureuse ont focalisé sur les troubles bipolaires. Ces études ont largement bénéficié de l’introduction des nouvelles systèmes de classifications qui définissaient les troubles psychiatriques de façon algorithmique ainsi que des entretiens diagnostiques structurés. Outre les troubles bipolaire-I, bipolaire-II et cyclothymique, le DSM-5, qui est paru en 2013, propose également des critères pour les syndromes bipolaires en dessous du seuil des troubles bipolaires traditionnels.
Les études transversales
Les études transversales conduites dans la population générale de nombreux pays ont mis en évidence des taux de prévalence sur la vie entière d’environ 1% tant pour les troubles bipolaire-I que bipolaire-II, indépendamment du pays [1]. Le trouble bipolaire-I affecte d’une manière égale les femmes et les hommes, alors que le trouble bipolaire-II est plus prévalent chez les femmes [1].
Le début de ces troubles se situe souvent durant l’adolescence ou au début de l’âge adulte. Les études ont également montré que 2,1 à 4,7% de la population présentent des troubles bipolaires en dessous du seuil du trouble bipolaire-II [2]. Ces études ont démontré que ces troubles ont un impact clinique significatif, ce qui explique leur inclusion dans le DSM-5. Une étude récente (PsyCoLaus), portant sur un échantillon aléatoire de plus de 3700 sujets âgés de 35 à 66 ans résidant à Lausanne, a mis en évidence qu’environ 1% de la population remplit les critères diagnostiques pour un de ces nouveaux troubles bipolaires selon le DSM-5 [2]. Il est cependant probable que les études transversales sous-estiment considérablement la prévalence sur la vie entière de ces troubles bipolaires de symptomatologie atténuée, car les études longitudinales telle que l’étude de Cohorte de Zurich avec six investigations de suivi [3] ont établi des taux de prévalence sur la vie entière allant jusqu’à 11,8% pour ces troubles.
Les troubles bipolaires sont souvent accompagnés par d’autres pathologies psychiatriques tels que les troubles anxieux, les troubles liés à l’utilisation de substances psycho-actives et les troubles de la personnalité. Ils sont également associés à un taux de mortalité élevé. Une vaste étude prospective basée sur le registre nationale de la Suède incluant plus de six millions de sujets a confirmé une espérance de vie raccourcie de plus de neuf ans des patients bipolaires et un taux de mortalité pour toutes raisons confondues augmenté d’un facteur deux chez ces patients [4]. Parmi les causes de décès des sujets bipolaires on trouve principalement le suicide (risque huit à dix fois plus élevé), mais également les maladies cardiovasculaires, le diabète, des maladies respiratoires et les accidents.
Les études de cohortes longitudinales
Les études de suivi portant sur les sujets bipolaires ne s’étendent en général que sur des périodes relativement courtes, seules deux études dépassent cinq ans selon la revue de Goodwin et Jamison [1]. Ces études soulignent l’évolution défavorable des troubles bipolaires. Bien que le premier épisode maniaque ou mixte mène en général à une rémission syndromique voir symptomatique selon deux études américaines [5,6], la moitié des patients n’atteignent déjà plus le niveau fonctionnel prémorbide. Avec chaque nouvel épisode, le risque d’une rémission incomplète augmente [7]. Après le premier épisode, des symptômes résiduels (en général des symptômes dépressifs) sont présents et affectent les patients près de la moitié du temps [8].
Une des rares études documentant l’évolution des patients sur plus de dix ans aux USA relève que les trois-quarts des patients récidivent dans les 15 ans, dont deux-tiers souffrent de rechutes multiples [9]. L’étude clinique de Zurich, qui a suivi des patients pendant près de 50 ans, a démontré que seulement 16% des patients bipolaires atteignent une guérison (cinq ans sans récidive) [10].
L’évolution du trouble bipolaire-II a été moins fréquemment étudiée, mais la recherche existante suggère que le pronostic de ce trouble ne se distingue que peu de celui du trouble bipolaire-I [1]. Les études qui s’intéressent aux facteurs déterminant l’évolution des troubles bipolaires ont mis en évidence l’impact négatif des affections comorbides, de l’abus physique ou sexuel durant l’enfance, de la présence de symptômes résiduels et du nombre d’épisodes précédents [1].
Les études d’épidémiologie génétique
Les études comparant des jumeaux monozygotes et dizygotes suggérent un rôle important des facteurs génétiques dans l’étiologie des troubles bipolaires. Les études familiales montrent également que les parents, les enfants et la fratrie d’un patient bipolaire-I ont un risque élevé de présenter le même trouble. Ce risque, qui se situe entre 2,3 à 10%, est au moins trois fois plus élevé chez les membres de familles de patients bipolaires que parmi les membres de familles témoins. De même, il semble que les apparentés de patients bipolaires aient un risque plus grand de développer un trouble dépressif majeur que les membres de familles de sujets contrôles.
Cependant, deux études récentes, une menée aux USA [11] et l’autre menée en Suisse romande [12] ont mis en évidence que l’agrégation familiale du trouble bipolaire-I est entièrement indépendante de celle du trouble dépressif majeur, suggérant ainsi une étiologie spécifique à chaque type de trouble. Quant au trouble bipolaire-II, son agrégation familiale est moins évidente et il semble plutôt prédisposer les membres de la famille à un trouble dépressif plutôt qu’à un trouble bipolaire [11,12]. Plusieurs études ont également investigué les enfants de patients bipolaires. Ces dernières ont montré que les enfants des patients bipolaires souffrent déjà, avant l’âge de 18 ans, de troubles de l’humeur et de troubles anxieux plus souvent que des enfants de sujets témoins [13]. Le suivi de ces enfants dans des études aux USA, au Canada, au Pays-bas et en Suisse permettra d’objectiver un éventuel lien entre ces symptômes précoces et le développement plus tard d’un trouble bipolaire. Ces études pourront également identifier de façon prospective des facteurs environnementaux impliqués dans le développement de cette maladie.
L’avenir de la recherche sur l’épidémiologie des troubles bipolaires
Afin d’étudier des mécanismes impliqués dans la pathogénèse des troubles psychiatriques, les études épidémiologiques récentes tentent de dépasser les investigations traditionnelles qui se focalisaient essentiellement sur les manifestations psychopathologiques. Outre l’évaluation neurocognitive, ces études incluent désormais des mesures biologiques comme les marqueurs inflammatoires, le fonctionnement de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien ainsi que l’imagerie par résonance magnétique (IRM), l’EEG et l’investigation de l’activité physique enregistrée à l’aide d’un actimètre (permettant de quantifier les mouvements corporels pendant plusieurs jours).
Une étude familiale évaluant la performance neurocognitive chez des patients bipolaires et chez les membres de leur famille a pu montrer que certains déficits cognitifs repérés chez les patients sont également manifestés chez leurs apparentés et pourraient éventuellement être des marqueurs précoces de ces troubles [14]. De même, une étude familiale incluant une investigation par IRM suggère que certaines altérations structurelles cérébrales seraient détectables chez les membres de familles des patients bipolaires et pourraient avoir un lien avec la prédisposition à ce trouble [15].
Prof. Dr méd. Martin Preisig
Dr méd. Sylfa Fassassi
Dr Caroline Vandeleur
Bibliographie:
- Goodwin FK, Jamison KR: Manic-Depressive Illness: Bipolar Disorders and Recurrent Depression. New York: Oxford University Press 2007.
- Fassassi S, et al. : Prevalence and correlates of DSM-5 bipolar spectrum disorders and hyperthymic personality in the community. J Affect Dis 2014. DOI: 10.1016/j.jad.2014.06.004.
- Angst J, et al.: Toward a re-definition of subthreshold bipolarity: epidemiology and proposed criteria for bipolar-II, minor bipolar disorders and hypomania. J Affect Disord 2003; 73(1–2): 133–146.
- Crump C, et al.: Comorbidities and mortality in bipolar disorder: a Swedish national cohort study. JAMA Psychiatry 2013; 70(9): 931–939.
- Strakowski SM, et al.: Effects of co-occurring alcohol abuse on the course of bipolar disorder following a first hospitalization for mania. Arch Gen Psychiatry 2005; 62(8): 851–858.
- Tohen M, et al.: The McLean-Harvard First-Episode Mania Study: prediction of recovery and first recurrence. Am J Psychiatry 2003; 160(12): 2099–2107.
- Goldberg JF, Harrow M: Consistency of remission and outcome in bipolar and unipolar mood disorders: a 10-year prospective follow-up. J Affect Disord 2004; 81(2): 123–131.
- Judd LL, et al.: The long-term natural history of the weekly symptomatic status of bipolar I disorder. Arch Gen Psychiatry 2002; 59(6): 530–537.
- Gitlin MJ, et al.: Relapse and impairment in bipolar disorder. Am J Psychiatry 1995; 152(11): 1635–1640.
- Angst J, Preisig M: Outcome of a clinical cohort of unipolar, bipolar and schizoaffective patients. Results of a prospective study from 1959 to 1985. Schweiz Arch Neurol Psychiatr 1995; 146(1): 17–23.
- Merikangas KR, et al.: Independence of familial transmission of mania and depression: results of the NIMH family study of affective spectrum disorders. Mol Psychiatry 2014; 19(2): 214–219.
- Vandeleur CL, et al.: Specificity of psychosis, mania and major depression in a contemporary family study. Mol Psychiatry 2014; 19(2): 209–213.
- Vandeleur C, et al.: Mental disorders in offspring of parents with bipolar and major depressive disorders. Bipolar Disord 2012; 14(6): 641–653.
- Glahn DC, et al.: Neurocognitive endophenotypes for bipolar disorder identified in multiplex multigenerational families. Arch Gen Psychiatry 2010; 67(2): 168–177.
- Kempton MJ, et al.: Dissociable brain structural changes associated with predisposition, resilience, and disease expression in bipolar disorder. J Neurosci 2009; 29(35): 10863–10868.
InFo Neurologie & Psychiatrie 2014; 12(5): 4–6