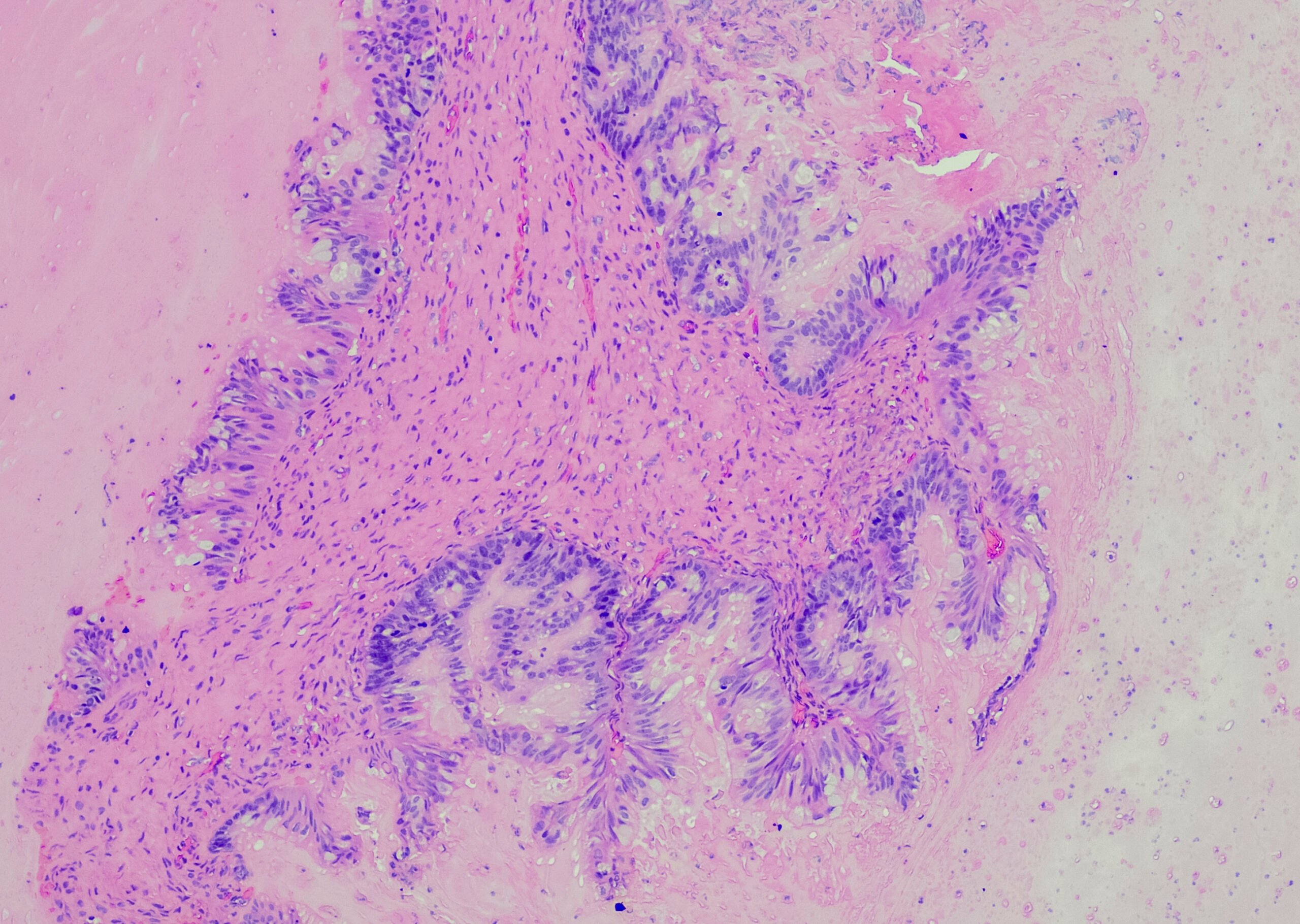Une analyse publiée dans le British Medical Journal portant sur plus de 160 000 participants à une enquête sur la santé en Angleterre et en Écosse trouve un lien entre la mortalité par cancer et le stress. Même si l’on tient compte des facteurs de risque classiques dans le calcul, le risque de mourir d’un cancer est parfois multiplié par quatre chez les personnes stressées psychologiquement. Un signal clair que le stress n’a pas seulement des effets cardiovasculaires négatifs.
(ag) Les données d’un total de 163 363 femmes et hommes âgés d’au moins 16 ans (46 ans en moyenne) ont été analysées ou regroupées. L’étude s’est basée sur 16 études de cohorte prospectives menées entre 1994 et 2008 (pour la plupart en Angleterre). Les personnes avaient rempli chaque année des scores de stress basés sur les douze questions du General Health Questionnaire (GHQ-12) et avaient accepté que leur dossier médical soit utilisé à des fins de recherche. Le GHQ-12 est un outil largement utilisé pour une telle mesure et se compose de plusieurs questions telles que :
- Avez-vous moins dormi ces dernières semaines à cause de soucis ?
- Ou : Avez-vous ressenti un manque de confiance en vous au cours des dernières semaines ?
Les réponses “non, pas du tout” et “pas plus que d’habitude” ont obtenu un score de 0 et les réponses “plus que d’habitude” et “beaucoup plus que d’habitude” ont obtenu un score de 1.
L’analyse des données anglaises ne portait pas sur l’incidence du cancer, mais sur la mortalité. On a donc cherché à savoir si le stress psychologique (symptômes anxieux et dépressifs) augmentait les chances de mourir d’un cancer – plutôt que d’un autre décès – indépendamment d’autres facteurs. Seules les trois études écossaises avaient également relevé la première apparition ou le diagnostic d’une telle maladie, c’est-à-dire les incidences.
Association de risque claire
Au total, 16 267 décès sont survenus, dont un peu plus d’un quart en raison d’un cancer. La durée moyenne d’observation était d’environ neuf ans. D’autres facteurs tels que l’âge, l’éducation, l’IMC, la consommation d’alcool et de tabac ont été pris en compte dans l’analyse multivariée et les résultats ont été les suivants : par rapport aux personnes dont le niveau de stress GHQ-12 était inférieur à 7, celles qui avaient 7 unités possibles ou plus (ce groupe a été défini par les chercheurs comme “hautement symptomatique”) avaient un niveau de stress plus élevé :
- 26% de risque supplémentaire de mourir d’un cancer quelconque (IC 95% 1,11-1,42)
- 84% de risque en plus de mourir d’un cancer colorectal
- risque augmenté d’un facteur 2,42,
- de mourir d’un cancer de la prostate
- risque multiplié par 2,76,
- mourir d’un cancer du pancréas
- risque augmenté d’un facteur 2,59,
- mourir d’un cancer de l’œsophage
- risque augmenté d’un facteur 3,86,
- de mourir d’une leucémie.
Pour le cancer de la prostate et le cancer colorectal, on a même observé une “relation dose-effet” : le risque augmentait progressivement à chaque augmentation sur l’échelle du stress.
Avons-nous oublié quelque chose ?
D’autres facteurs potentiellement confondants pour la mortalité par cancer, tels que la privation (pas d’accès à un traitement médical de qualité), n’ont pas été inclus dans toutes les études mentionnées, et les chercheurs n’ont donc pu procéder ici qu’à une analyse de sous-groupe. Cependant, cela n’a guère modifié le résultat de l’analyse principale, c’est-à-dire le lien entre le stress et la mortalité par cancer.
En outre, on a examiné s’il ne pouvait pas y avoir une causalité inverse : Des personnes dont le cancer n’avait pas été diagnostiqué ont-elles été incluses dans l’étude alors qu’elles ressentaient déjà certains effets du cancer, comme la fatigue ou même la douleur, et qu’elles ressentaient donc du stress ou confondaient ces effets avec des symptômes de stress ? Cette possibilité a été exclue en excluant d’une autre analyse de sous-groupe les personnes décédées d’un cancer cinq ans après l’inclusion dans l’étude, mais cela n’a pas non plus eu d’influence sur le résultat.
Incidence accrue
Les trois études écossaises ont montré que l’incidence du cancer était également plus élevée dans le groupe “hautement symptomatique” avec un score de stress de 7 à 12, soit 16%. Les auteurs notent toutefois que les associations sont plus faibles ici, notamment en raison du petit nombre de cas.
Le stress n’a pas seulement des effets cardiovasculaires
Ces dernières années, le lien entre la santé mentale et la santé physique a fait parler de lui, notamment en ce qui concerne les facteurs de risque cardiovasculaires. Le stress n’augmente pas seulement la pression artérielle, mais a des effets négatifs bien plus importants sur notre système cardiovasculaire : les facteurs de risque psychosociaux tels que le stress émotionnel aigu ou le stress social chronique, les affects négatifs, certains facteurs de personnalité et les états de fatigue entraînent des augmentations du risque de maladie coronarienne (MC) comparables à celles des paramètres établis (parmi lesquels le tabagisme, le diabète, l’obésité, la passivité). Selon une méta-analyse [1], les crises de colère multiplient par près de cinq le risque d’infarctus du myocarde/de SCA. L’intervalle de temps critique est de deux heures après un tel accès de colère. Il semble qu’il y ait là aussi une relation dose-effet : plus il y a de problèmes, plus le risque est élevé.
En revanche, peu d’études se sont penchées sur l’association entre le stress et le cancer. Les résultats de cette étude indiquent que le stress peut avoir une influence défavorable sur le cancer, voire le faire apparaître, par le biais de multiples mécanismes immunologiques, inflammatoires et hormonaux. On sait que les personnes stressées remplissent également plus souvent d’autres profils de risque : Elles sont plus nombreuses à fumer, à être en surpoids et à avoir un mode de vie globalement moins sain (alimentation irrégulière et malsaine, peu de sport, consommation d’alcool). Certains de ces facteurs ont toutefois pu être contrôlés dans l’étude, sans que le résultat ne soit modifié de manière significative.
Et maintenant ?
Les associations et les directions causales entre le stress, le mode de vie et le risque de cancer restent très complexes – l’étude montre donc en premier lieu qu’il vaut la peine de les explorer plus en détail. Il n’est pas (encore) possible d’en déduire des efforts de prévention concrets : Faut-il également aborder le stress dans la société en général dans une optique de prévention du cancer ou suffit-il d’éviter les facteurs classiques tels que le tabagisme, le manque d’activité physique et une mauvaise alimentation pour prévenir ou réduire à la fois le cancer et le stress ?
Source : Batty GD, et al : Psychological distress in relation to site specific cancer mortality : pooling of unpublished data from 16 prospective cohort studies. BMJ 2017 ; 356 : j108.
Littérature :
- Mostofsky E, et al. : Eur Heart J 2014 ; 35(21) : 1404-1410.
InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE 2017 ; 5(3) : 2