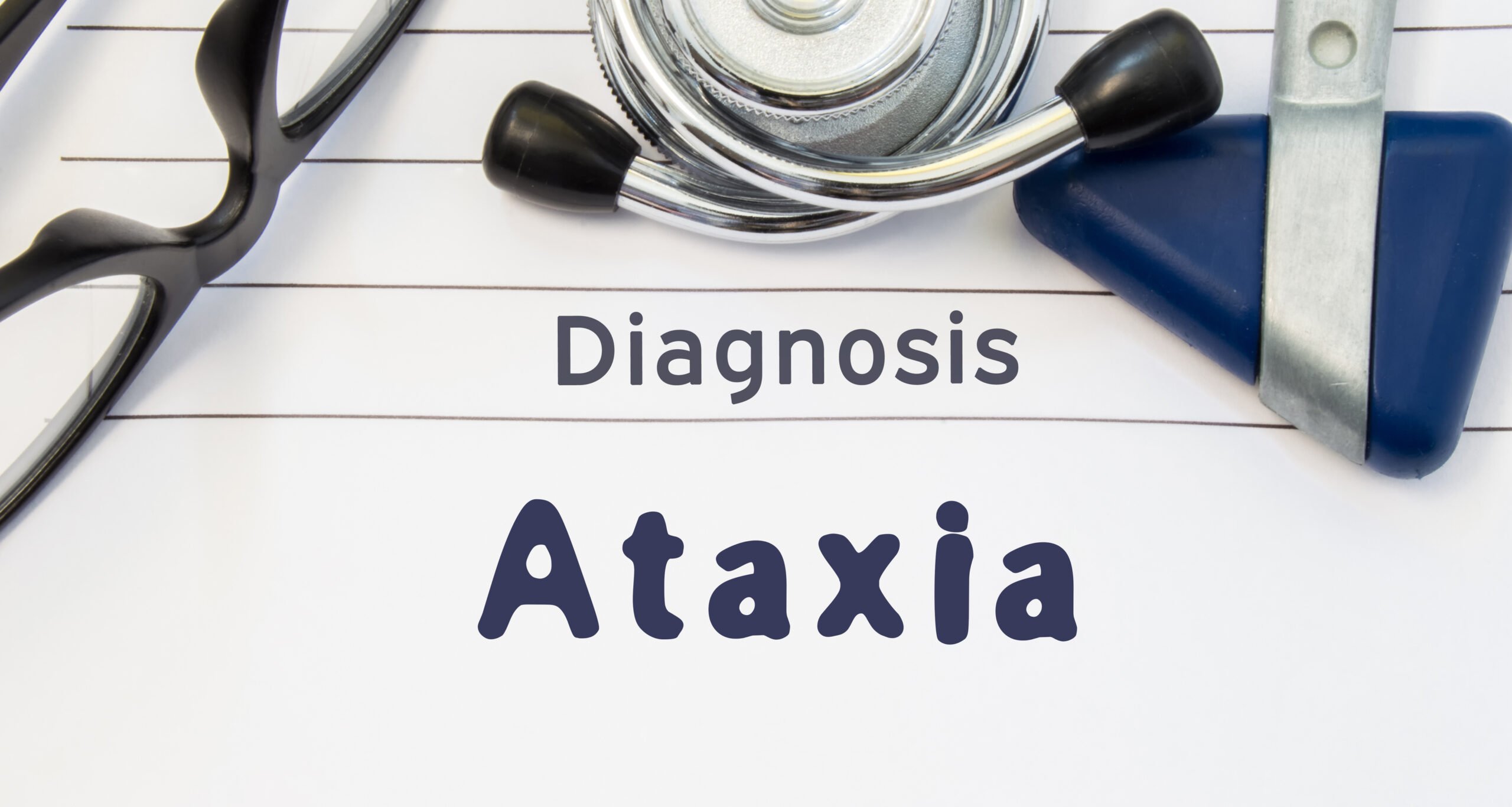L’idée d’améliorer les performances mentales de personnes en bonne santé à l’aide de psychotropes continue de susciter beaucoup d’attention. L’accent est mis sur les psychostimulants, en particulier les amphétamines, le méthylphénidate et le modafinil. La consommation d’améliorateurs cognitifs est toutefois nettement moins répandue qu’on ne le pense généralement. De plus, chez les personnes en bonne santé, les psychostimulants semblent surtout compenser les effets de la fatigue, mais n’augmentent guère les performances cognitives au-delà du niveau initial. Le débat éthique et médiatique est surtout marqué par des exagérations concernant la diffusion et les possibilités pharmacologiques.
Le psychiatre américain Peter Kramer, spécialiste de la dépression, a inventé le terme de “psychopharmacologie cosmétique” dans son livreListening to Prozac, publié en 1993 [1]. Pour illustrer cette idée, il a décrit des patients qui, bien que ne souffrant pas de troubles psychiatriques, semblaient tirer profit de la prescription d’inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS). Il en a conclu que les gens pouvaient ainsi surmonter leurs inhibitions, leur timidité ou leur manque d’assurance, réaliser leur “vrai moi” et devenir ainsi plus performants dans leur vie professionnelle et privée. Malgré les critiques prudentes des professionnels, le livre est resté sur les listes de best-sellers pendant des mois et a été traduit dans plusieurs langues. De plus, son auteur a bénéficié de nombreuses apparitions à la télévision.
Le débat sur la psychopharmacologie “cosmétique” se poursuit encore aujourd’hui. Il est toutefois frappant de constater qu’au début des années 2000, la classe de substances a changé : au lieu des antidépresseurs, ce sont surtout les psychostimulants tels que l’amphétamine, le méthylphénidate ou le modafinil qui sont au premier plan, et au lieu du fonctionnement socio-émotionnel, il s’agit maintenant d’améliorer les capacités de réflexion et de performance. Ainsi, depuis une bonne quinzaine d’années, le débat scientifique et médiatique récent tourne autour de la notion de neuroenhancement ou encore de cognitive enhancements. Nous laissons aux lecteurs intéressés le soin de répondre à la question plus sociologique de savoir si ce revirement traduit une propagation de l’esprit de performance et de compétition dans la société. Dans ce court article, nous nous concentrerons sur les deux questions centrales d’un point de vue psychiatrique concernant la demande pour les substances concernées et leur efficacité, afin de parvenir finalement à un jugement éclairé sur le Cognitive Enhancement .
Demande de substances de neuroenhancement
La pertinence du débat dépend en grande partie de la mesure dans laquelle la consommation de psychotropes pour améliorer les performances cognitives est un phénomène nouveau, répandu et/ou en augmentation. Comme les auteurs l’ont fait remarquer précédemment [2,3], les publications qui donnent le ton dans les principaux médias scientifiques se sont distinguées par des présentations suggestives et des citations erronées [4–6]. Ainsi, des valeurs aberrantes non représentatives issues d’études épidémiologiques sur la consommation non médicale de psychostimulants ont été mises en avant, ou des enquêtes sélectives sur la consommation de drogues dans le cadre d’un style de vie ont tout simplement été réinterprétées comme des preuves de l’amélioration cognitive. Cela a fait naître l’idée dans le débat éthique et scientifique que jusqu’à 25% des étudiants, qui ont été identifiés comme le groupe cible le plus populaire, avaient déjà recours à des médicaments sur ordonnance pour améliorer leurs résultats. Même si certains collègues ont critiqué les exagérations des médias, il n’est pas étonnant que les journalistes aient repris ces chiffres de diffusion apparemment alarmants. Par conséquent, comme l’a démontré une étude approfondie des sources anglophones, les médias ont présenté le phénomène du Cognitive Enhancement comme étant répandu et/ou en augmentation – et ce, en citant des sources scientifiques [7].
En revanche, des études systématiques ont fourni des preuves convaincantes que la consommation de psychostimulants à des fins non médicales se situe à un pourcentage à un chiffre, même parmi les étudiants américains [8,9]. Des enquêtes représentatives récentes menées par de grandes compagnies d’assurance maladie en Allemagne (DAK) et en Suisse (SUVA) ont également confirmé que la prévalence à vie de la prise de stimulants sur ordonnance pour améliorer les performances cognitives est inférieure à 1% dans la population générale [10,11]. Il est intéressant de noter que la prévalence à vie inclut également les personnes qui n’ont pas utilisé les substances après une seule consommation ou une consommation peu fréquente. Si la proportion d’individus ayant une affinité avec les stimulants semble effectivement un peu plus élevée chez les étudiants – des prévalences à vie de 1,3% pour les étudiants allemands et de 4,1% pour les étudiants suisses ont été rapportées [12,13] -, même dans cette population, il est difficile de maintenir l’image d’une diffusion épidémique de la consommation de stimulants pour améliorer les performances.
Nos propres recherches bibliographiques ont révélé que le phénomène est loin d’être nouveau : par exemple, dans les années 1950 et 1960, les amphétamines étaient promues pour améliorer le fonctionnement dans le monde du travail ou directement pour améliorer les capacités d’attention (mental alertness) [14]. Dès les années 1960, 1970 et 1980, des enquêtes ont été menées sur la consommation de psychotropes en intégrant des objectifs non médicaux [15]. Certaines études rapportent des niveaux comparables, voire plus élevés, pour la consommation instrumentale, c’est-à-dire que les substances sont utilisées pour rester éveillé et/ou étudier plus longtemps [16].
En résumé, on peut donc dire que la demande de Cognitive Enhancement existe, mais pas au niveau élevé colporté par de nombreuses présentations scientifiques ou médiatiques. On peut en conclure que certains collègues ont décrit ici la consommation de drogue ordinaire chez les jeunes comme un nouveau problème qu’ils ont fini par se recommander eux-mêmes pour étudier et résoudre, à condition de disposer des fonds nécessaires [2,15,17]. Le fait que les psychotropes et autres médicaments soient utilisés à des fins non médicales – pensez au Viagra dans le contexte sexuel ou aux analgésiques dans le sport de masse – n’est pas non plus nouveau et est étudié depuis des décennies par la sociologie médicale.
Efficacité des substances de neuroenhancement
Depuis que plusieurs grandes entreprises pharmaceutiques ont réduit ou même complètement cessé d’investir dans la recherche en psychopharmacologie, la situation n’est pas devenue plus facile pour les chercheurs cliniques en psychiatrie [18]. L’une des principales différences entre les essais pharmacologiques visant à traiter des patients et à améliorer les performances de personnes en bonne santé est l’objectif visé : si, dans un groupe, il s’agit de soulager ou de guérir une affection et/ou certains symptômes, on ne sait pas encore aujourd’hui ce qu’une bonne préparation de neuroenhancement devrait réellement accomplir chez des personnes en bonne santé. Dans les expériences relativement peu nombreuses menées sur des sujets sains, on utilise généralement des batteries de tests neuropsychologiques conçus pour documenter l’évolution d’une maladie ou d’un traitement. Des améliorations statistiquement significatives dans ces tests ne permettent donc pas de savoir si, par exemple, des étudiants en situation d’examen ou des employés travaillant dans un bureau en tireraient profit. Les méthodes utiles en clinique ne sont pas facilement transposables dans un contexte non clinique [17]. De plus, l’ampleur des effets des améliorations cognitives démontrées chez les personnes en bonne santé sous stimulants est souvent plutôt faible et donc peu pertinente pour la vie quotidienne [19,20].
En outre, la recherche visant à améliorer les performances des personnes en bonne santé est confrontée à des défis particuliers : Elle est plus difficile à justifier d’un point de vue éthique (équilibre coût-bénéfice) et à financer en raison des priorités de financement de la recherche fondamentale ou clinique. C’est pourquoi les échantillons des études disponibles sont souvent petits et les substances n’ont été administrées que brièvement. Pour ces raisons, les résultats obtenus jusqu’à présent sont peu représentatifs. De plus, les effets secondaires indésirables à long terme chez les personnes en bonne santé n’ont guère été étudiés jusqu’à présent. Après avoir passé en revue les études pertinentes il y a plusieurs années, les auteurs ont déjà tiré la conclusion provisoire qu’aucune pilule cognitive miracle n’est à attendre dans un avenir prévisible [2,20,21].
Outre les spéculations optimistes selon lesquelles les antidépresseurs, tels que les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase, auraient également des effets positifs sur les personnes en bonne santé, la discussion a surtout porté sur les psychostimulants que sont l’amphétamine, le métyhlphénidate et le modafinil. Cela est surprenant dans la mesure où ces moyens ne sont pas des découvertes récentes de la recherche moderne sur le cerveau, comme on le suggère parfois. Bien au contraire : l’amphétamine est connue depuis plus de 100 ans et le méthylphénidate a été développé dès les années 1940 [22].
De plus, chez les personnes en bonne santé, les psychostimulants semblent surtout compenser les effets de la fatigue, mais ils ne sont guère capables d’augmenter les performances cognitives globales au-delà du niveau initial [19,20]. Outre l’augmentation de la vigilance typique des stimulants, ces substances augmentent également la motivation, ce qui peut également avoir un effet positif, bien qu’indirect, sur les performances aux tests [20]. A cela s’ajoute l’effet d’amélioration de l’humeur et de récompense de tous les stimulants, ce qui explique aussi leur potentiel de dépendance [23]. Les stimulants n’améliorent donc pas les performances cognitives en soi chez les personnes en bonne santé, mais ils permettent aux consommateurs d’être plus alertes, plus motivés et de meilleure humeur. Dans ce contexte, les études qualitatives sur les consommateurs de méthylphénidate qui utilisaient la substance pour apprendre sont également instructives. D’après leurs rapports, ils ont trouvé le travail d’apprentissage plus intéressant et plus agréable [24]. Cependant, les revues systématiques et les méta-analyses confirment l’impression qu’il est difficile d’obtenir des améliorations pharmacologiques des performances chez les personnes en bonne santé, du moins avec les moyens actuellement disponibles [8,19,20,25].
Perspectives
Nous partons du principe que l’ère d’une “psychopharmacologie cosmétique” n’a pas encore commencé et ne commencera pas dans un avenir prévisible. Le débat dans les revues scientifiques ainsi que dans les médias de vulgarisation scientifique est surtout marqué par des exagérations et des attentes irréalistes. Le fait que des personnes utilisent des médicaments en dehors d’un contexte clinique pour faire face à certains défis de la vie n’est pas non plus un phénomène nouveau en principe. Jusqu’à présent, ce sont surtout les cliniciens et les scientifiques qui ont profité de ce débat pour attirer l’attention des médias et obtenir des fonds pour la recherche. Nous pensons même qu’il s’agit d’un problème éthique, en particulier dans le contexte de la diminution des ressources pour la recherche clinique : avec des moyens limités, nous pensons que le traitement des personnes malades devrait avoir la priorité sur l’amélioration des performances des personnes en fait en bonne santé. En outre, des attentes déçues, alimentées par des promesses prématurées, pourraient avoir un impact négatif à long terme sur l’image publique des secteurs scientifiques concernés.
Enfin, il reste la question du rôle du médecin. Dans le débat sur l’amélioration cognitive, il a été avancé que le médecin avait un rôle de gardien de la porte [26]. Il ou elle décide à qui les médicaments sont prescrits. Nous sommes toutefois d’avis que le mandat de guérison doit continuer à guider l’action du médecin et nous déconseillons donc les prescriptions “cosmétiques” de stimulants, notamment parce que les effets secondaires à long terme chez les personnes en bonne santé sont restés largement inexplorés jusqu’à présent. Si seuls des problèmes de motivation de faible valeur pathologique sont mis en avant pour être traités à l’aide de psychostimulants, la question de savoir dans l’intérêt de qui cela est fait se pose toujours. Il est possible que les personnes concernées soient ainsi privées de la possibilité de réfléchir de manière critique à leur situation et de constater, par exemple, qu’un certain cursus ou une certaine profession ne correspond peut-être pas du tout à leurs propres intérêts.
Littérature :
- Kramer PD : Écouter le Prozac. New York, N.Y., U.S.A. : Viking, 1993.
- Quednow BB : Ethics of neuroenhancement : A phantom debate. BioSocieties 2010 ; 5 : 153-156.
- Schleim S : Second thoughts on the prevalence of enhancement Response. BioSocieties 2010 ; 5 : 484-485.
- Farah MJ : Neuroethics : the practical and the philosophical. Trends Cogn Sci 2005 ; 9 : 34-40.
- Farah MJ, et al : Neurocognitive enhancement : what can we do and what should we do ? Nat Rev Neurosci 2004 ; 5 : 421-425.
- Greely H, et al : Towards responsible use of cognitive-enhancing drugs by the healthy. Nature 2008 ; 456 ; 702-705.
- Partridge BJ, et al : Smart drugs “as common as coffee” : media hype about neuroenhancement. PLoS One 2011 ; 6 : e28416.
- Smith ME, Farah MJ : Les stimulants sur ordonnance sont-ils des “pilules intelligentes” ? The epidemiology and cognitive neuroscience of prescription stimulant use by normal healthy individuals. Psychol Bull 2011 ; 137 : 717-741.
- Sussman S, et al : Abus de “drogues d’étude :” prévalence, conséquences, et implications pour la politique. Subst Abuse Treat Prev Policy 2006 ; 1 : 15.
- Rapport sur la santé de la DAK 2015. Hambourg : DAK Forschung.
- Maier LJ, Schaub, MP : “Dopage” au travail et dans l’éducation en Suisse. Zurich : Institut suisse de recherche sur la santé publique et les addictions (ISGF), 2014.
- Franke AG, et al. : Utilisation non médicale de stimulants prescrits et utilisation illicite de stimulants pour l’amélioration de la cognition chez les pupilles et les étudiants en Allemagne. Pharmacopsychiatry 2011 ; 44 : 60-66.
- Maier LJ, et al. : To Dope or Not to Dope : Neuroenhancement with Prescription Drugs and Drugs of Abuse among Swiss University Students. PLoS One 2013 ; 8.
- Rasmussen N : America’s first amphetamine epidemic 1929-1971 : a quantitative and qualitative retrospective with implications for the present. Am J Public Health 2008 ; 98 : 974-985.
- Schleim S, Quednow BB : Debunking the ethical neuroenhancement debate. In R. ter Meulen, A. D. Mohamed & W. D. Hall (Eds.), Repenser l’amélioration cognitive : une évaluation critique de la neuroscience et de l’éthique de l’amélioration cognitive. Oxford : Oxford University Press (sous presse).
- Wechsler H, Rohman ME : Patterns of drug-use among New England college-students. Am J Drug Alcohol Abuse 1981 ; 8 : 27-37.
- Slime S : Quel bien-être ? Conceptions communes et idées fausses dans le débat sur l’amélioration. Front Syst Neurosci 2010 ; 8.
- Harrison PJ, et al : Pas de psychiatrie sans psychopharmacologie. Br J Psychiatry 2011 ; 199 : 263-265.
- de Jongh R, et al : Botox for the brain : amélioration de la cognition, de l’humeur et du comportement pro-social et blunting des souvenirs indésirables. Neurosci Biobehav Rev 2008 ; 32 : 760-776.
- Quednow BB : Neurophysiologie de la neuro-amélioration : possibilités et limites. AddictionMagazine 2/2010 : 19-26.
- Schleim S, Walter H : Cognitive Enhancement : Faits et mythes. Neurologie 2007 ; 26 : 83-86.
- Sulzer D, et al : Mechanisms of neurotransmitter release by amphetamines : a review. Prog Neurobiol 2005 ; 75 : 406-433.
- Rush CR, et al : Reinforcing and subject-rated effects of methylphenidate and d-amphetamine in non-drug-abusing humans. J Clin Psychopharmacol 2001 ; 21 : 273-286.
- Vrecko S : Just How Cognitive Is “Cognitive Enhancement” ? On the Significance of Emotions in University Study Study Drugs Experiences (L’importance des émotions dans l’expérience des étudiants avec les drogues d’étude). AJOB Neurosci 2013 ; 4 : 4-12.
- Repantis D, et al : Modafinil and methylphenidate for neuroenhancement in healthy individuals : A systematic review. Pharmacol Res 2010 ; 62 : 187-206.
- Synofzik M : Ethically Justified, Clinically Applicable Criteria for Physician Decision-Making in Psychopharmacological Enhancement. Neuroethics 2009 ; 2 : 89-102.
InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2015 ; 13(5) : 14-18