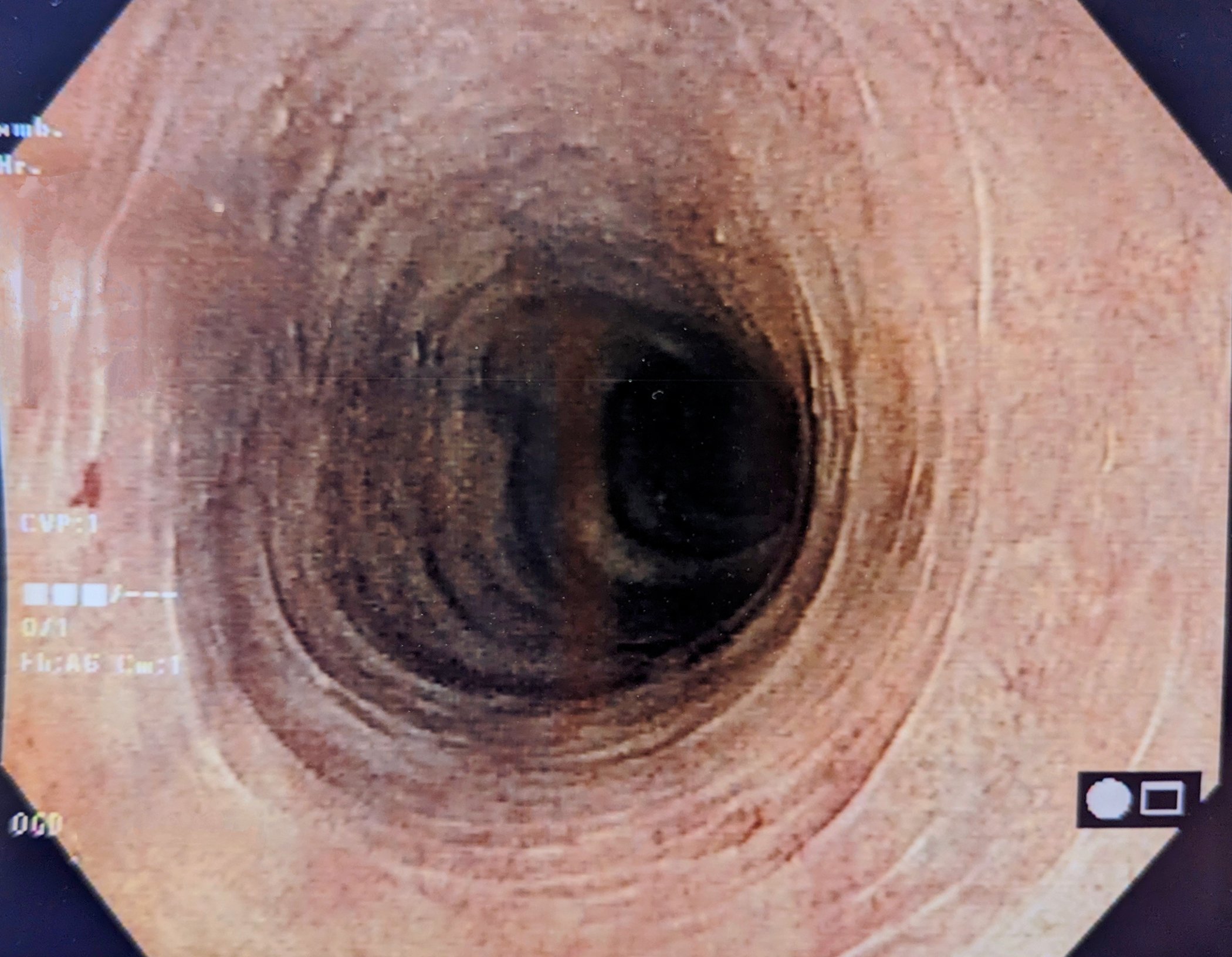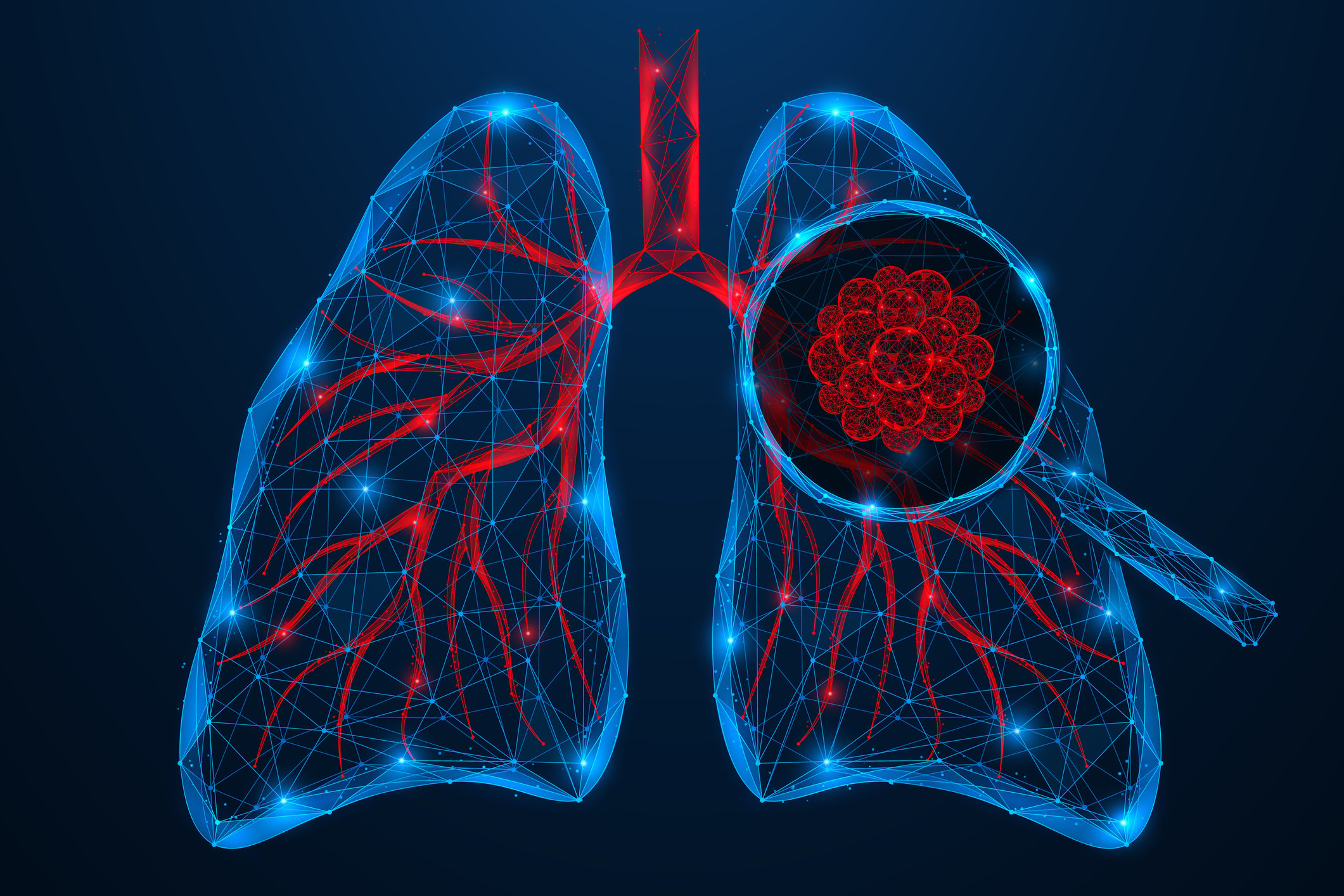Lors de la réunion conjointe ACTRIMS-ECTRIMS 2014 à Boston (du 10 au 13 septembre 2014), le prix GMSI (Grant for Multiple Sclerosis Innovation) a été remis pour la deuxième fois aux lauréats. L’objectif du prix est de promouvoir la recherche et de soutenir des projets de recherche translationnelle prometteurs qui aident à mieux comprendre la sclérose en plaques et donc, en fin de compte, à mieux la traiter.
(lg) Comme lors de la première cérémonie de remise des prix à l’ECTRIMS 2013 à Copenhague, le prix a été décerné pour la deuxième fois aux projets de recherche les plus prometteurs. Le montant total du prix s’élève à 1 million d’euros, somme qui a été répartie entre les cinq gagnants. L’afflux de candidatures enregistré chez Merck Serono est un signe de la forte demande de financement de la recherche sur la sclérose en plaques. Par rapport à la première cérémonie de remise des prix, le nombre de candidatures reçues a plus que doublé, avec un total de 205.
Promouvoir les domaines clés de la recherche
Le soutien financier est destiné à des projets de recherche sur la SEP dans des domaines clés de la maladie. Il s’agit de la pathogenèse et de l’identification des sous-types de SEP, des taux de réponse, des marqueurs pertinents de la maladie, des nouvelles options thérapeutiques potentielles et des programmes innovants de soutien aux patients. Il s’agit par exemple des nouvelles technologies telles que la santé mobile ou l’e-santé, qui peuvent être utiles dans la gestion quotidienne des patients.
Sur plus de 200 candidatures, huit groupes de recherche ont été invités à présenter leurs projets sur la base des critères suivants : recherche innovante sur la SEP (1), idée scientifique de base solide (2), faisabilité (3) et faisabilité pratique (4). Cinq candidats ont été récompensés cette année.
Réparation de la myéline par manipulation des cellules microgliales ?
Les premiers gagnants sont PD Maria Domercq et Prof. Carlos Matute du Centre basque de neurosciences Achucarro et du Département de neurosciences de l’Université du Pays basque en Espagne. Leur hypothèse de recherche porte sur la question de savoir si les cellules immunitaires du système nerveux central (SNC), les cellules microgliales, ont une influence indirecte sur la réparation de la myéline. Les résultats de la recherche pourraient conduire au développement de nouvelles options de traitement de la SEP.
Lorsqu’une lésion ou une infection est détectée dans le SNC, la libération d’ATP entraîne l’activation et la prolifération des cellules microgliales, qui s’accumulent sur le site des lésions et y éliminent les cellules et substances cellulaires endommagées par phagocytose. Cependant, une activation excessive et prolongée des cellules microgliales peut également être nocive.
Les données existantes montrent que la différenciation des cellules microgliales en cellules M2 peut avoir un effet positif sur la dégénérescence des tissus. Dans ce contexte, la dégradation des cellules microgliales n’est pas toujours nécessaire dans le traitement de la SEP, mais pourrait même produire des options thérapeutiques plus efficaces en modifiant leur activation. L’étude pour laquelle les lauréats ont concouru vise à déterminer si la transformation des cellules microgliales peut être modifiée en manipulant les récepteurs P2X4 de manière à ce que les cellules perdent leurs fonctions pro-inflammatoires M1 et que leurs propriétés M2, la phagocytose et la régénération, soient renforcées à la place.
Un biomarqueur d’imagerie pour la détection précoce de la neurodégénérescence
PD Bruno Stankoff, professeur de neurologie à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris (UPMC), a reçu sa subvention pour un projet portant sur l’utilité de la tomographie par émission de positrons (TEP) combinée au [18F]-flumazénil dans le dépistage précoce de la sclérose en plaques. L’objectif de l’étude est de développer un indice de neurogénération. Ce dernier, en tant que biomarqueur d’imagerie, devrait permettre de mettre en évidence les lésions neuronales à un stade précoce de la maladie, soit dans le cas d’une SEP évoluant par poussées, soit dans le cas d’une SEP primaire progressive. Un autre aspect du projet de recherche est d’aborder le rôle de la matière grise du cerveau dans la maladie.
Cellules T régulatrices
Un projet mené par PD Margarita Dominguez-Villar, de la Yale School of Medicine, vise à déterminer si les patients atteints de SEP ont un système immunitaire altéré et si cela est lié à la fonction des cellules T régulatrices (Treg). Ils aident normalement à contenir la réponse immunitaire et donc à prévenir une maladie auto-immune. Les résultats de la recherche pourraient aider à développer de nouvelles thérapies permettant de restaurer la capacité à lutter contre l’inflammation.
En particulier, la recherche se concentre sur les mécanismes de génération des Th1-Tregs, sur le fonctionnement de ces cellules in vivo et in vitro et sur la différence exacte entre les personnes en bonne santé et les patients atteints de SEP. La voie de signalisation PI3K/AKT/FoxO dans la différenciation des Th1-Tregs semble jouer un rôle ici, selon Dominguez-Villar.
Test des molécules de signalisation BAFF et APRIL
Un autre projet de recherche américain bénéficie également d’un soutien financier : PD Robert Axtell de l’Oklahoma Medical Research Foundation étudie le rôle du “B-cell activating factor” (BAFF) et du “a proliferation inducing ligand” (APRIL) dans les troubles neuroinflammatoires. BAFF et APRIL sont des molécules de signalisation qui seront testées dans deux modèles animaux différents. L’un d’eux simule la sclérose en plaques, l’autre la neuromyélite optique (NMO). L’objectif est de déterminer si l’inhibition de BAFF et d’APRIL améliore ou aggrave les maladies dans les modèles animaux respectifs. L’idée de recherche repose sur la connaissance de l’importance de la fonction des cellules B dans l’auto-immunité. Le contexte de la maladie auto-immune détermine si les cellules B, BAFF et APRIL ont un effet pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire.
Réparation de la myéline à l’aide de la nanothérapie ?
PD Su Metcalfe, chercheur principal au John van Geest Centre for Brain Repair de l’Université de Cambridge, a également remporté la victoire face à d’autres projets avec son idée de recherche. Elle étudie dans quelle mesure une nanothérapie avec le “leukaemia inhibitory factor” (LIF) peut favoriser l’autotolérance et la réparation de la myéline chez les patients atteints de SEP. Le LIF est une cytokine de cellule souche.
Metcalfe a formulé plusieurs questions auxquelles l’équipe de recherche s’est engagée à répondre : la nanothérapie LIF protège-t-elle contre l’encéphalomyélite auto-immune expérimentale rémittente, contre d’autres maladies auto-immunes et/ou contre des formes secondairement progressives de maladies neurodégénératives ? La nanothérapie LIF augmente-t-elle le bénéfice thérapeutique de la lymphodéplétion médiée par les anticorps ? L’argent distribué par le GMSI Award devrait permettre de répondre à ces questions et à d’autres.
Source : Cérémonie de remise des prix GMSI, réunion conjointe ACTRIMS-ECTRIMS 2014, Boston
InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2015 ; 13(1) : 28-29