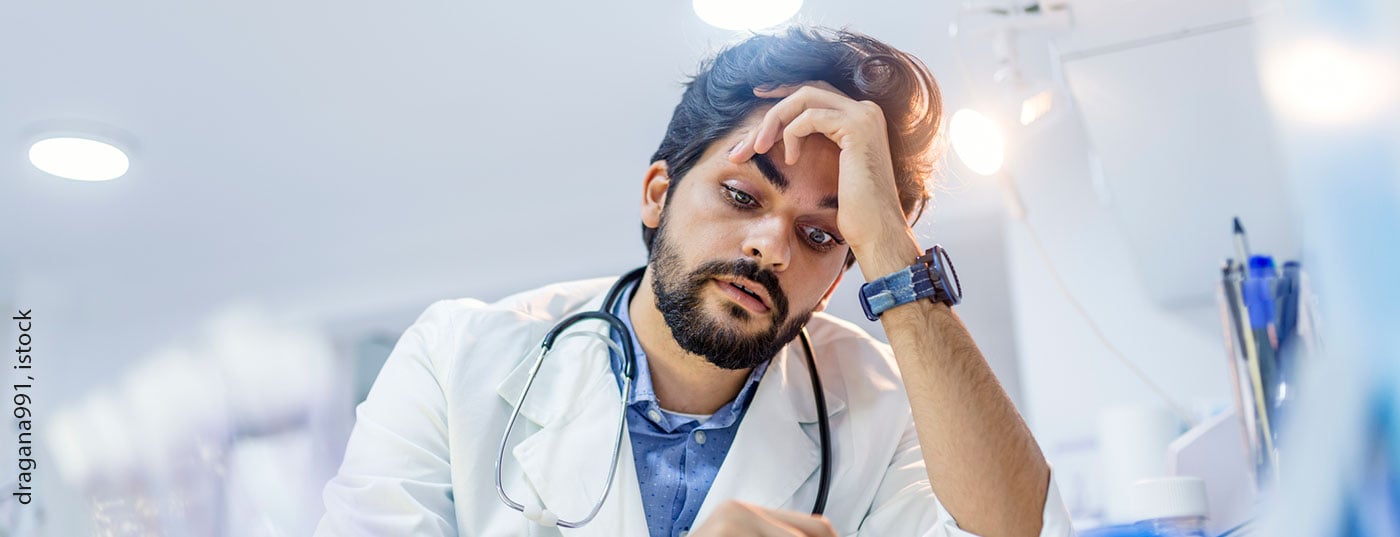La gestion des maladies, souvent graves, est l’élément le plus central de la profession de médecin. Dans ce contexte, la vulnérabilité personnelle est généralement reléguée au second plan. Mais que se passe-t-il si l’on est touché ? Comment l’expérience personnelle influence-t-elle l’action médicale ? Et inversement : comment la profession influence-t-elle la façon dont on gère le cancer ? Nous avons posé la question à quelqu’un qui doit savoir et avons obtenu, en plus d’un entretien intéressant, de précieuses idées pour la pratique quotidienne.
Samuel Perri est assis dans le salon de sa maison familiale. Le chien, un weimaraner, est allongé sur son coussin juste à côté du radiateur, il y a une musique douce. Samuel boit du thé dans une grande tasse et parle de sa maladie. Une maladie qui ne se voit même plus aujourd’hui. Il est de grande taille, porte une barbe de trois jours bien entretenue et des vêtements de sport. Il y a trois jours, il a fêté son 51e anniversaire, en raison de la Corona, en petit comité, uniquement avec sa famille. Ses deux grandes filles lui ont rendu visite, sa femme et son fils de 13 ans ont cuisiné. Il y a trois ans, Samuel n’aurait jamais pensé vivre ce jour.
C’est à cette époque que sa tumeur neuroendocrine a été diagnostiquée. Il avait des nausées depuis un certain temps et il a simplement posé la sonde sur son foie dans son propre cabinet de médecin généraliste, en fait sans mauvais pressentiment. On pouvait y voir d’innombrables masses spatiales et la vie était sens dessus dessous. Six mois, trois chimiothérapies et de nombreux effets secondaires plus tard, il a dit adieu à sa famille, à sa femme, à ses trois enfants et à son chien. La tumeur s’était propagée dans tout le corps, sortant même de la peau. Il a accepté une dernière tentative de traitement avec un inhibiteur de point de contrôle – à l’époque hors étiquette – davantage pour le bien de son entourage. Les conséquences sont graves, car au bout de deux semaines seulement, le traitement a porté ses fruits et Samuel a repris goût à la vie. Après deux semaines supplémentaires, il a recommencé à se promener, et après trois mois, à faire du jogging. Et après six mois de travail.
Un nouveau départ en tant que “non-assuré
Ayant abandonné son propre cabinet, Samuel s’est mis à la recherche d’un emploi. Celle-ci s’est avérée difficile malgré la pénurie de médecins en soins primaires. Un emploi a échoué en raison de son “inassurabilité”, les taux d’occupation étant souvent trop élevés. Mais il a finalement trouvé un employeur qui n’a pas hésité à prendre le risque de perdre à nouveau rapidement un travailleur en raison d’une rechute. “Une grande chance”, dit Samuel. Il lui est resté fidèle depuis deux bonnes années maintenant.
Lorsqu’il a repris le travail, il a d’abord eu beaucoup d’appréhension, raconte ce médecin généraliste expérimenté. Il pensait ainsi ne plus pouvoir s’intéresser qu’aux personnes réellement et gravement malades. L’idée d’être assis en face de patients qui se plaignent – eux-mêmes bien moins malades que lui – lui semblait insupportable. Mais dans la pratique, ces doutes n’ont généralement pas posé de problème, d’une part grâce à la routine des années précédentes et d’autre part en raison de la faible charge de travail de 30% avec laquelle il a commencé. Sa superviseuse l’a beaucoup aidé pendant cette période, en le freinant quelque peu dans ses ambitions et en l’empêchant de reprendre trop tôt et trop intensément.
Une nouvelle honnêteté
Peu de temps après son nouveau départ professionnel, Samuel a remarqué les effets de sa propre maladie sur ses priorités en tant que médecin. “Mes priorités professionnelles se sont clairement déplacées encore plus vers là où elles ont toujours été”, raconte-t-il. Ainsi, une médecine rationnelle, honnête et empathique est encore plus importante pour lui qu’auparavant. Il est également capable de pondérer différemment les attentes qui lui sont adressées et de mieux gérer le fait de ne pas y répondre. L’activisme excessif est aujourd’hui moins fréquent qu’auparavant et il peut désormais mieux supporter d’attendre, dans l’esprit du “less is more”.
Samuel, qui a lui-même contracté la maladie sans facteurs de risque, ne fume pas, boit peu, est mince et physiquement actif, voit la prévention d’un œil moins sévère après sa maladie. En tant que personne et en tant que médecin. “Même avec le mode de vie le plus sain, nous ne sommes pas à l’abri de la maladie et de la mort prématurée. Bien sûr, nous avons la responsabilité de prendre soin de la vie, mais cela ne devrait pas mettre la vie elle-même en péril”, dit-il. Lorsqu’on lui demande s’il est devenu un meilleur médecin, il n’a qu’un sourire fatigué. En tout cas, il connaît mieux le domaine de l’oncologie. Non, sérieusement, il est devenu plus honnête. Et plus critique. Ainsi, il aborde aujourd’hui le plus grand dilemme de la médecine générale à ses yeux différemment qu’avant sa maladie : “Pour moi, l’éthique en médecine est liée à des connaissances solides. Les connaissances et ce que nous pouvons offrir aux patients augmentent plus rapidement que ce que chacun peut apprendre. Aujourd’hui, je dis aussi plus facilement qu’avant que je ne sais tout simplement pas, mais que nous pouvons par exemple demander à quelqu’un d’autre”.
En fin de compte, Samuel aime son métier – encore et toujours. Ce n’est que parfois, quand il ne se sent pas très bien, qu’il aimerait avoir un travail où il peut se taire. “Devoir communiquer peut être très fatigant, surtout si vous êtes aussi le médecin – c’est-à-dire la personne saine dans la situation”. Il n’oubliera jamais comment, juste après sa reprise, un patient a posé avec insistance des questions sur divers médicaments à base de plantes pour la prostate, leurs avantages et leurs inconvénients, alors qu’il attendait lui-même le résultat d’une IRM pour un examen de suivi. C’est dans ces moments-là, lorsqu’il ressent le besoin de se retirer et qu’il ne peut pas satisfaire les patients, que Samuel prend également conscience de l’impact négatif de sa maladie sur lui en tant que médecin. Celles-ci se font surtout sentir lorsque l’anxiété le taraude.
Le savoir, un avantage et un inconvénient
Même si les connaissances en tant que médecin peuvent être un énorme avantage pour faire face à sa propre maladie et la gérer, elles peuvent aussi être effrayantes. Car Samuel sait ce qui est désormais possible, mais aussi à quel point nos options sont encore limitées. D’une part, c’est pour lui un énorme soulagement d’être moins vulnérable à ce qu’il appelle les crieurs publics de la médecine alternative et de pouvoir renoncer sans mauvaise conscience à des méthodes scientifiquement douteuses comme la vitamine C à haute dose. D’autre part, sa formation et son expérience professionnelle l’obligent à être réaliste quant à son pronostic et il manque parfois de confiance en ses médecins. Un instinct qui lui a potentiellement sauvé la vie, mais auquel il doit aussi d’innombrables nuits blanches. S’il n’avait pas changé de médecin, il serait probablement mort. Sans que personne n’ait commis d’erreur. “Si je n’étais pas médecin et si j’avais eu divers contacts dans ce domaine auparavant, je ne serais pas assis ici aujourd’hui. La médecine conventionnelle offre des possibilités fantastiques, mais elles sont loin d’être accessibles à tous de la même manière. Même en Suisse, ce n’est pas le cas. Pour moi, ce qui fait un bon médecin, outre des connaissances solides, c’est la connaissance de ses propres limites et l’ouverture d’esprit pour demander à ses collègues”.
Le cancer a renforcé les convictions de Samuel à l’égard de la médecine conventionnelle, mais lui a également fait prendre conscience de ses limites et lui a fait redécouvrir sa spiritualité. Un processus qui a dû être plus difficile pour lui que pour d’autres en raison de sa formation scientifique. Dans le cadre de sa maladie, il a appliqué ce qu’il avait appris dans son enfance et son adolescence de sa grand-mère catholique et de son oncle bouddhiste, et a eu de précieux entretiens avec un aumônier réformé. Aujourd’hui, il est convaincu que la spiritualité offre une aide que la médecine, y compris la psycho-oncologie et la psychiatrie, n’est pas en mesure de fournir.
Le plus important en conclusion
Samuel est satisfait et infiniment reconnaissant de sa “deuxième vie”. En tant que médecin, en tant qu’homme, en tant que père, en tant qu’être humain. Enfin, nous voulons lui donner la parole :
Samuel, quel conseil donneriez-vous à tous les oncologues ?
Samuel Perri : Je pense que chacun répondrait à cette question de manière légèrement différente. Je pense à quatre choses que j’aimerais mentionner :
- La connaissance est éthique. Et il est actuellement difficile de rester à jour en raison de la croissance rapide des connaissances. Le courage d’utiliser un traitement hors étiquette m’a sauvé la vie. Pour faire une telle chose, il faut être un médecin qui connaît parfaitement son domaine.
- Si un patient veut vous parler de la mort, faites-le !
- Assurez l’intimité de la chimiothérapie ! Les patients qui reçoivent des chimiothérapies sont dans un état d’urgence. Les conditions spatiales de la chimiothérapie sont encore aujourd’hui en grande partie une contrainte. Réprimer ses propres larmes pendant que la patiente d’en face doit tout naturellement exposer son port et sa poitrine retirée, tout en écoutant les détails de la diarrhée d’un autre patient, pendant que le petit enfant d’une autre patiente se tient entre les lits et me brise presque le cœur et qu’un cinquième patient passe ses appels téléphoniques professionnels n’est malheureusement pas un scénario inventé.
- De plus, j’ai rencontré des infirmières oncologiques excellentes et sensibles. Votre travail ne sera jamais assez apprécié !
InFo ONKOLOGIE & HÉMATOLOGIE 2021 ; 9(1) : 22-23