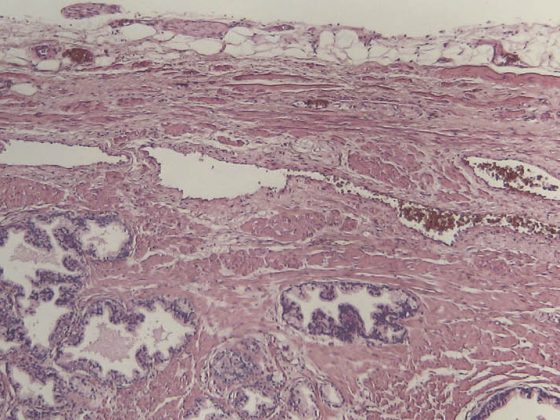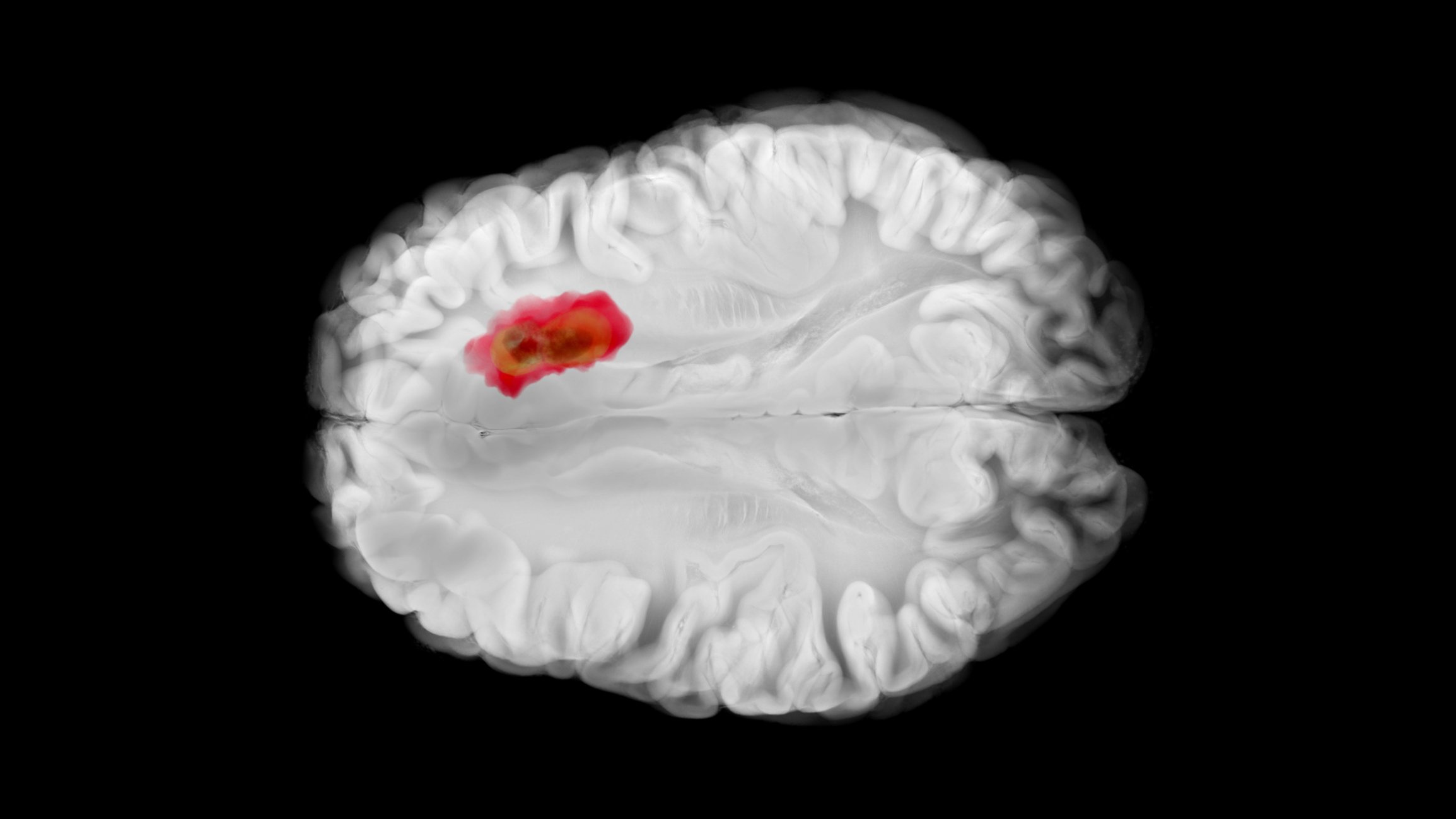Dans une interview accordée à l’InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE, le professeur Christoph Renner, de l’Onkozentrum Hirslanden de Zurich, revient sur les dernières avancées thérapeutiques dans le domaine du myélome multiple. Il répond ainsi à des questions telles que “Qui bénéficie de la nouvelle autorisation de mise sur le marché du pomalidomide en Suisse et quelle est la tolérance de la substance ?” ou “Quels sont les développements en première ligne et en traitement d’entretien ?”
Professeur Renner, il n’y a guère d’autres maladies malignes pour lesquelles des progrès aussi importants ont été réalisés ces dernières années que le myélome multiple. D’une manière générale, quels sont les résultats particulièrement améliorés par les “nouvelles” molécules (thalidomide, lénalidomide, bortézomib, pomalidomide) ?
Professeur Renner : Si l’on considère la période des 20-25 dernières années, je pense que c’est surtout la qualité de vie pour le patient qui a pu être fortement améliorée. Autrefois, on ne disposait guère de médicaments et la maladie n’était traitée que tardivement. On le voit encore dans les anciens systèmes de classification : Ils se basaient sur la gravité de la maladie et sur des paramètres sanguins qui ne seraient plus acceptés aujourd’hui, car les gens se sentent déjà trop mal. Au plus tard lors des rechutes, on se retrouvait souvent sans aucune option.
Les nouvelles substances utilisées aujourd’hui permettent généralement d’éviter de graves dommages et de maintenir une très bonne qualité de vie. La tolérance est généralement bonne. Les nouvelles substances ne font pas les effets secondaires d’une chimiothérapie classique. Par exemple, la perte de cheveux, et donc une stigmatisation pesante pour le patient, peut être évitée. Et en fin de compte – comme le montrent également les données des registres et des études – on vit plus longtemps avec cette maladie. En résumé, les nouveaux médicaments permettent donc aujourd’hui d’avoir une meilleure qualité de vie sur une plus longue période. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la plupart de ces nouveaux médicaments ne “fonctionnent” plus, c’est-à-dire qu’ils ne sont plus utiles après une certaine période d’utilisation. Le myélome multiple reste donc, à quelques exceptions près, une maladie incurable. Mais comme elle peut être contrôlée pendant longtemps, certains parlent déjà d’une maladie “chronique”, qui doit être traitée à intervalles réguliers pour être maintenue en échec.
Le lénalidomide fait l’objet d’études de phase III à la fois dans les formes nouvellement diagnostiquées du myélome multiple et dans le traitement d’entretien. Quels sont les principaux résultats des études et quelle est leur pertinence pratique ?
Jusqu’à présent, la lénalidomide est autorisée en cas de rechute, c’est-à-dire de récidive. Or, une étude (FIRST) présentée l’an dernier au congrès américain d’hématologie a comparé le lénalidmoide en traitement de première ligne pour les patients non éligibles à une transplantation à l’une des chimiothérapies possibles de première ligne. Le problème des études est bien sûr que les directives peuvent changer pendant la période de réalisation et jusqu’à la publication. L’une des critiques adressées à l’étude était donc le bras de comparaison quelque peu obsolète. Cependant, le lénalidomide a permis d’améliorer la survie sans progression tout au long de la période, même lorsqu’il a été maintenu. L’avantage serait d’obtenir ainsi un traitement de première ligne sans chimiothérapie. En outre, les coûts seraient bien sûr beaucoup plus élevés qu’auparavant.
En ce qui concerne le traitement d’entretien, outre l’étude positive du groupe d’étude américain, une étude française a montré que le lénalidomide permettait de retarder très nettement le moment de la réapparition de la maladie, mais que les patients ne vivaient pas plus longtemps pour autant. En effet, en cas de rechute, les patients répondaient moins bien au traitement. Ainsi, dans l’ensemble, la différence de survie globale n’est pas significative. C’est pourquoi les autorités réglementaires locales attendent encore avant d’inclure la lénalidomide dans le traitement d’entretien.
Le pomalidomide est autorisé aux États-Unis et dans l’UE (et depuis peu en Suisse) pour le myélome multiple récidivant/réfractaire. Il est indiqué dans les combinaisons. Que dire des résultats de la recherche dans ce domaine ?
Le pomalidomide est autorisé dans cette indication en Suisse depuis juin 2014 et est remboursé depuis le 1er août. On dispose aujourd’hui de deux substances récentes qui ont une très bonne réponse, d’une part le bortézomib et d’autre part le lénalidomide. Ils sont efficaces pendant un certain temps et sont bien tolérés, mais ils doivent être arrêtés à un moment donné, généralement en raison de l’apparition de nouveaux effets secondaires ou de l’absence d’effet. Chez les jeunes transplantés, cela prend beaucoup plus de temps que chez les patients plus âgés, où un changement peut également être nécessaire après deux ans et demi à trois ans en moyenne. Jusqu’à présent, il n’y avait plus beaucoup d’options sur les troisième et quatrième lignes. Il était donc urgent de trouver des substances qui puissent continuer à aider. Cette lacune est désormais comblée par le pomalidomide, qui est indiqué en association avec la dexaméthasone dans le traitement du myélome multiple récidivant et réfractaire chez les patients qui ont reçu au moins deux traitements antérieurs (y compris le lénalidomide et le bortézomib) et qui ont montré une progression vers le dernier traitement. Cela double la survie sans progression par rapport à la situation que nous avions auparavant.
Quelle est la tolérance de l’association de pomalidomide et de dexaméthasone à faible dose ?
Elle est très bien tolérée. La fatigue et la faiblesse sont parfois un problème, une polyneuropathie préexistante peut s’aggraver, certains peuvent être constipés ou avoir la diarrhée, mais en général, c’est une substance bien tolérée.
Quels sont les progrès concrets et pratiques apportés par la nouvelle autorisation de cette combinaison (pomalidomide/dexaméthasone) en Suisse ?
Il s’agit d’une évolution importante, car dans la pratique quotidienne, nous avons des patients qui ont besoin d’une alternative au bortézomib et au lénalidomide. L’un commence par le bortézomib, puis peut avoir une polyneuropathie ou une absence de réponse et passer au lénalidmoide. Il faut donc s’attendre à ce qu’il n’y ait plus de réponse au lénalidomide. C’est précisément le genre de patients pour lesquels il fallait jusqu’à présent regarder de près quelles étaient les autres alternatives. On est donc déjà content d’avoir encore une possibilité de traitement dans cette population .
Quelles sont les normes actuelles de traitement des patients âgés ?
Tout d’abord, il faut bien sûr se demander comment définir “plus âgé” et “jeune”. Les Français l’ont assez fortement établi en fonction du calendrier : vieux signifie 65 ans ou plus. Il s’agit d’une simplification qui est certainement trop réductrice. Aujourd’hui, on trouve encore des personnes de 70 ans, voire de 74 ans, qui sont en forme et qui, selon les données de l’étude, bénéficient d’une transplantation réduite. On continue à le faire pour obtenir une consolidation (consolidation de la réponse) après une bonne réponse aux nouveaux médicaments et pour obtenir parfois un intervalle sans traitement. Les médicaments efficaces peuvent ainsi être différés. On a parfois pensé qu’avec les nouveaux médicaments, la transplantation deviendrait superflue, ce qui ne semble pas être le cas jusqu’à présent. On associe donc aujourd’hui plutôt des substances efficaces suivies d’une transplantation.
Quels sont les autres nouveaux développements dans le domaine de la recherche sur le myélome multiple ?
Il y a une multitude de nouveaux médicaments qui vont arriver dans un avenir proche. Des médicaments aux principes d’action entièrement nouveaux rendent le domaine de la recherche sur le myélome très passionnant. Il est encourageant de constater que des recherches aussi intensives sont actuellement menées dans ce domaine. Par exemple, les anticorps anti-CD-38 représentent des opportunités futures intéressantes en raison des résultats positifs des études (phase II-III).
Entretien : Andreas Grossmann
InFo Oncologie & Hématologie 2014 ; 2(7) : 22-24