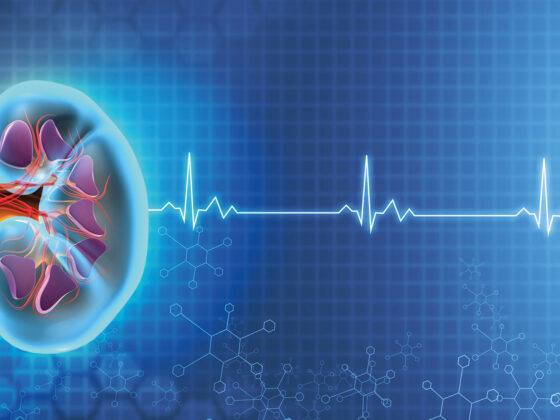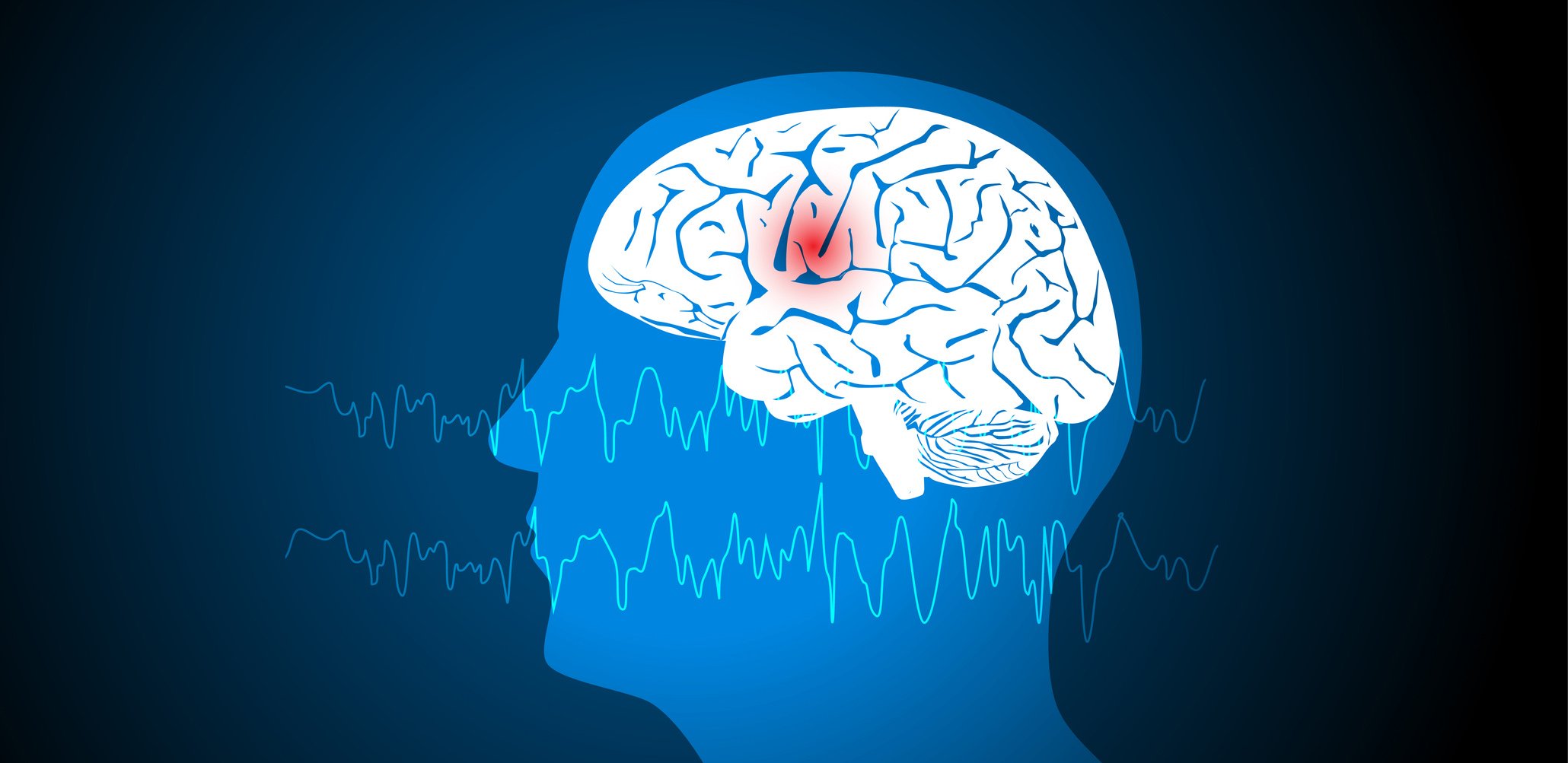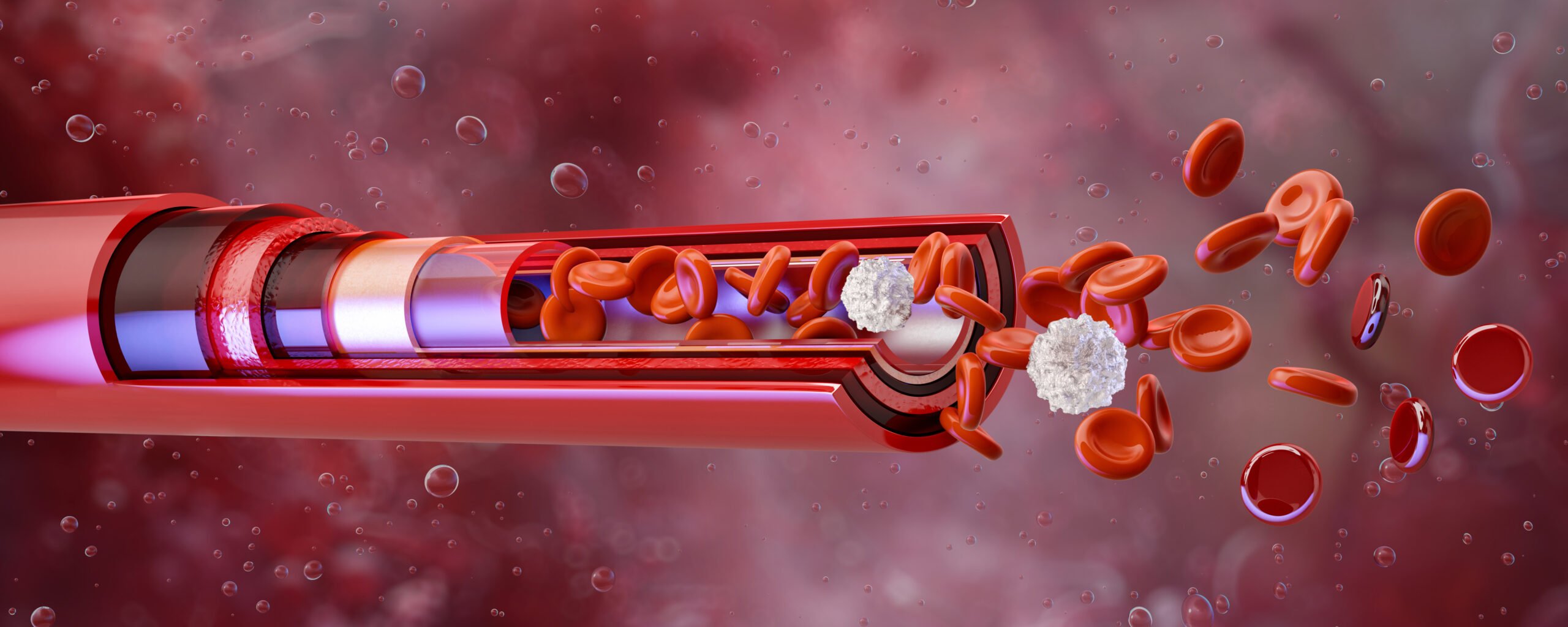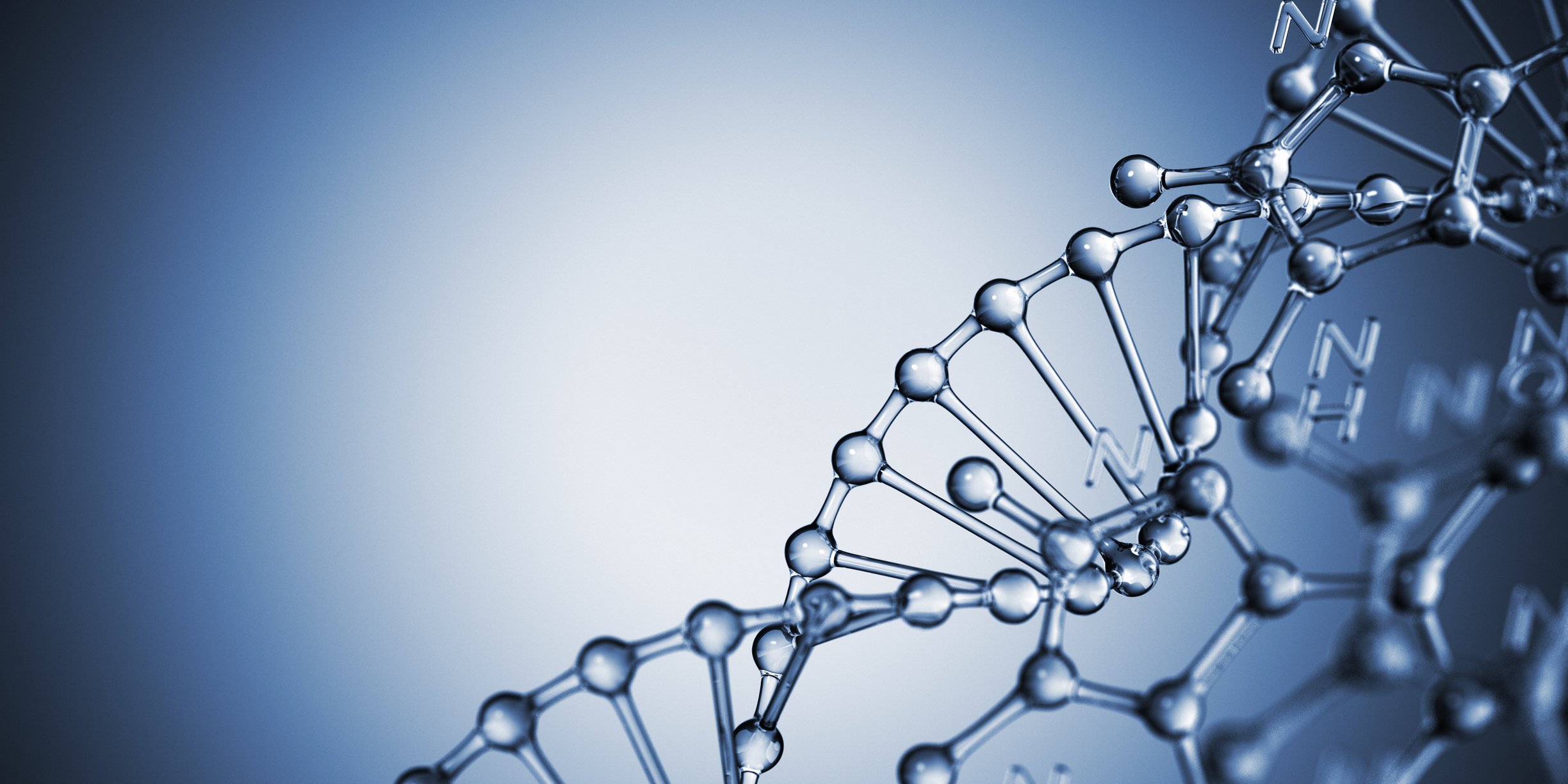Cette année, le DGN s’est concentré sur les maladies neurodégénératives, car c’est un domaine qui a beaucoup évolué. Des approches thérapeutiques prometteuses se profilent à l’horizon, la recherche en biologie moléculaire a permis de faire des découvertes importantes sur les mécanismes pathologiques, ce qui a permis de développer des diagnostics plus précis et plus précoces ainsi que des approches thérapeutiques ciblées. Mais il y avait aussi beaucoup de choses à découvrir en dehors de cela.
(red) La nouvelle ligne directrice sur la maladie de Parkinson est arrivée [1]. Elle a cependant été rétrogradée de S3 à S2k. L’objectif était d’élargir la prise en compte des différents aspects des soins. Néanmoins, la réévaluation des médicaments et l’aide au choix des médicaments dans certaines situations sont restées au niveau S3. Comme il apparaît de plus en plus clairement que la maladie de Parkinson idiopathique a souvent une cause génétique, les auteurs ont décidé de ne plus parler que de la maladie de Parkinson. En ce qui concerne le diagnostic, les critères MDS de 2015 devraient être utilisés à l’avenir au lieu de la “Parkinson’s UK Brain Bank” en raison de leur meilleure sensibilité et spécificité. Par la suite, l’évaluation des fluctuations motrices et des dyskinésies est ajoutée afin d’augmenter la certitude du diagnostic. Si une phase prodromique de la maladie de Parkinson est suspectée, il est recommandé d’utiliser des critères prodromiques définis (par exemple, un test olfactif), d’utiliser l’imagerie par résonance magnétique (IRM) crânienne dans le cadre du diagnostic précoce et de réaliser un examen polysomnographique en laboratoire du sommeil pour détecter les troubles du comportement du sommeil paradoxal spécifiques à la maladie de Parkinson. En cas de suspicion clinique, une IRM crânienne doit être réalisée. La gestion du traitement doit être précoce, adaptée à l’âge et personnalisée. Des recommandations détaillées sont données sur l’utilisation combinée et différenciée de substances appropriées, mais une grande marge de manœuvre est également laissée. Ainsi, les études ne permettent pas de donner la priorité aux inhibiteurs de la MAO-B, aux inhibiteurs de la COMT ou aux agonistes dopaminergiques en cas de fluctuations sous lévodopa. Il est recommandé de proposer des inhibiteurs de la MAO-B pour réduire les temps morts. Mais les inhibiteurs de la COMT et les agonistes de la dopamine (à l’exception de l’Ergoline-DA) sont également possibles. Il est également possible d’utiliser des injections d’apomorphine ou de l’apomorphine sublinguale. La lévodopa soluble à action rapide a également été ajoutée aux recommandations. En outre, les substances qui ne sont plus recommandées sont également répertoriées. De nouveaux chapitres ont également été ajoutés sur le traitement par pompe, le delirium et le traitement des troubles autonomes.
Physiopathologie de la maladie de Parkinson
La maladie de Parkinson (MP) résulte de la mort des neurones producteurs de dopamine dans la substantia nigra et se caractérise par une accumulation anormale de la protéine alpha-synucléine. La caractéristique neuropathologique de la MP est l’accumulation et l’agrégation anormales de la protéine alpha-synucléine (α-Syn) sous forme de corps de Lewy et de névrites de Lewy. Il est bien connu que l’agrégation pathologique de l’α-Syn est une caractéristique commune à plusieurs maladies neurodégénératives – dont la MP, la démence à corps de Lewy (DLB) et l’atrophie systémique multiple (MSA), collectivement appelées synucléinopathies. Une étude s’est à présent penchée sur la question de savoir quels aspects biochimiques perturbent, d’un point de vue nucléaire, les troubles de la conformation de l’alpha-synucléine [2].
Les propriétés structurelles de la protéine alpha-synucléine liée à l’ubiquitine et à la dopamine ont été déterminées à la fois par des méthodes de structure électronique basées sur la densité et par des méthodes basées sur la fonction d’onde afin d’évaluer la capacité des champs de force ab initio. En utilisant la dynamique moléculaire (MD) et les simulations Monte Carlo, les dysfonctionnements des systèmes protéasomal et lysosomal dans la physiopathologie de la maladie de Parkinson ont été analysés. Il s’est avéré que la protéine alpha-synucléine liée à l’ubiquitine s’accumule dans les neurones et que cette accumulation affecte la fonction cellulaire. Les variations locales phi et psi de l’angle de torsion de l’alpha-synucléine indiquent que des perturbations dans la synthèse de la protéine et des déformations dans la région amphipathique N-terminale, hydrophobe centrale et une région fortement acide et riche en proline de cette protéine peuvent perturber la voie de biosynthèse et de métabolisme de la dopamine. La dégradation de la dopamine et les problèmes synaptiques peuvent être déclenchés par des troubles de la conformation de l’alpha-synucléine.
Détection précoce de la maladie d’Alzheimer
Les nouvelles thérapies visant à traiter la démence d’Alzheimer (MA) de manière causale mettent de plus en plus l’accent sur la pertinence des méthodes de détection précoce. L’examen neuropsychologique reste central, car il est facilement disponible, peu contraignant et peu coûteux. L’approche “Testing the Limits (TtL)” s’est révélée particulièrement appropriée, car elle permet de détecter directement la réserve cognitive réduite très tôt dans la MA. Avec une sensibilité de 93% et une spécificité de 80%, le paradigme TtL que nous avons utilisé jusqu’à présent, un test de mémoire visuelle, différencie déjà de manière très fiable les personnes suspectées de démence, les personnes dépressives et les personnes âgées en bonne santé. Toutefois, on peut supposer que le pouvoir séparateur peut encore être amélioré en faisant varier la résolution et la luminosité des images. Pour étudier ce point, une version test a été développée, permettant pour la première fois une variation systématique de la luminance et du contraste [3]. La procédure consistait en un pré-test et deux post-tests et utilisait comme stimuli des images en noir et blanc de type bande dessinée présentées sur un PC. Chaque subtest comprenait une unité d’apprentissage et une unité de reconnaissance qui, en plus des 20 modèles d’apprentissage, contenait 60 images de distracteurs. La durée de présentation était de 15 secondes pour chacun des modèles d’apprentissage, la reconnaissance se fait sans limite de temps. Le nombre d’erreurs de reconnaissance au post-test 1 et au post-test 2 a été utilisé comme mesure de la plasticité cognitive. Lors de la phase d’encodage des trois sous-tests, les images ont été présentées dans leur forme originale la plus claire et la mieux profilée. D’après les données disponibles à ce jour, les sujets témoins, avec des médianes d’erreurs de 24,5, 21,5 et 24,5, présentent de meilleures performances de reconnaissance, conformément aux attentes, que les patients atteints de la MA, qui ont commis 29, 28 et 24 erreurs en médiane dans les trois unités de test. Il est intéressant de noter qu’une diminution de la luminance pendant la phase de reconnaissance semblait plutôt améliorer les performances de recognition des patients atteints de la MA.
Évaluer l’atrophie hypothalamique dans la SLA
L’imagerie détaillée de l’hypothalamus est d’un grand intérêt pour mieux caractériser les lésions tissulaires liées à la maladie et les anomalies de la neurodégénérescence. Des études antérieures ont montré que le volume total de l’hypothalamus est considérablement réduit chez les patients atteints de SLA par rapport aux sujets témoins. Cependant, la délimitation manuelle ou semi-automatique de l’hypothalamus nécessite beaucoup de travail et dépend fortement de l’opérateur. L’objectif d’une étude était donc d’automatiser la segmentation de l’hypothalamus et du volume intracrânien (ICV) à partir d’images IRM pondérées en T1 afin de réduire la variabilité humaine et d’améliorer la robustesse des résultats [4]. La question a été posée de savoir si la segmentation de l’hypothalamus à l’aide d’un réseau de neurones convolutifs (CNN) pouvait être utilisée pour une analyse impartiale de la variation du volume hypothalamique dans la SLA. 120 ensembles de données MPRAGE tête entière pondérés en T1 (78 SLA et 42 témoins sains), avec des délimitations manuelles appropriées de l’hypothalamus, étaient disponibles et ont été utilisés pour l’entraînement et la validation de l’approche automatique basée sur le CNN avec une architecture en U-net. Tant pour le groupe SLA que pour les témoins, des différences non significatives ont été observées dans les volumes hypothalamiques calculés entre la prédiction et la vérité de base (avant normalisation de l’ICV). Après la normalisation de l’ICV, des différences significatives ont été observées dans le volume de l’hypothalamus entre la SLA et les contrôles. En conséquence, il pourrait s’agir d’une méthode rapide et impartiale de quantification de l’hypothalamus, basée sur l’utilisation de CNN comme technique basée sur l’intelligence artificielle.
Démangeaisons neuropathiques dans la SEP
Une atteinte nerveuse périphérique ou des lésions centrales peuvent provoquer des démangeaisons en plus des douleurs neuropathiques. Environ la moitié des patients atteints de sclérose en plaques (SEP) souffrent de douleurs neuropathiques. Cependant, on sait encore peu de choses sur la prévalence, les caractéristiques et les causes du prurit dans la SEP. L’objectif de cette étude était d’examiner la prévalence du prurit chronique dans la SEP [5]. Ils ont également analysé le lien entre les douleurs neuropathiques et les démangeaisons. Pour cela, 99 patients atteints de SEP ont été recrutés. 34% des personnes concernées ont déclaré avoir eu des démangeaisons au cours des six dernières semaines. Le prurit moyen des dernières 24h était de 2,6 ± 3,1 (sur une échelle de notation numérique de 0 à 10). Les patients souffrant de démangeaisons étaient plus susceptibles d’avoir des douleurs neuropathiques que les patients sans démangeaisons. Les qualités des démangeaisons ont été le plus souvent décrites comme “localisées en surface” (65%) et “picotements” (65%). Il s’est avéré que les démangeaisons chroniques sont beaucoup plus fréquentes dans la SEP qu’on ne le pensait jusqu’à récemment. Les patients atteints de SEP et souffrant de démangeaisons ont également souvent des douleurs neuropathiques. La localisation et les caractéristiques des démangeaisons sont similaires à celles des patients atteints de PNP. Par conséquent, les auteurs considèrent qu’une origine neuropathique périphérique est possible.
Première manifestation de l’épilepsie chez les personnes âgées
En l’absence de lésions corticales, la cause des premières crises d’épilepsie chez les personnes âgées (LOFES) est souvent soupçonnée d’être une leuco-encéphalopathie microangiopathique, bien que les mécanismes physiopathologiques sous-jacents restent inconnus. L’intention d’une étude était de déterminer l’importance de la teneur volumétrique exacte et de la localisation des hyperintensités de la matière blanche (WMH) en tant que corrélat radiologiquement mesurable de la leucoencéphalopathie microangiopathique sur le LOFES [6]. En outre, l’influence de l’atrophie cérébrale globale et régionale a également été examinée de plus près.
Dans le cadre d’une étude rétrospective cas-témoins, 50 patients LOFES âgés d’au moins 60 ans ainsi que des patients témoins ayant subi un accident ischémique transitoire (groupe AIT) et des patients témoins sans antécédents de maladie cérébrovasculaire (patient controls, groupe PC) ont été examinés. Le critère d’inclusion obligatoire était, outre l’absence de lésions corticales, la présence d’une imagerie IRM structurelle. Les patients LOFES ont montré une augmentation du volume de l’HMF dans le compartiment juxtacortical par rapport aux deux groupes de contrôle, ainsi qu’un schéma de distribution de l’HMF déplacé vers le compartiment juxtacortical. En outre, l’analyse de la trajectoire a montré que parmi toutes les variables d’influence étudiées, seule la pondération juxtacorticale de la WMH était un prédicteur de LOFES. Chez les patients LOFES, l’analyse VBM a révélé une atrophie corticale régionale significative des deux côtés du gyrus pré- et postcentral, de la partie antérieure du gyrus parahippocampique des deux côtés, de la partie postérieure du gyrus cingulaire, du cortex fronto-orbitaire droit et du cortex cérébelleux des deux côtés, par rapport au groupe témoin composite. Les résultats indiquent le rôle clé d’une distribution juxtacorticale des WMH et d’une atrophie corticale régionale, en particulier dans le lobe frontal, le gyrus parahipocampique et le gyrus cingulaire, qui sont considérés comme faisant partie d’un réseau épileptogène, et soulignent la conception moderne de l’épilepsie comme une maladie avec des troubles au niveau du réseau.
Succès du traitement de la LEMP
Infection virale opportuniste rare mais grave du cerveau, la leuco-encéphalopathie multifocale progressive (LEMP) entraîne la mort dans de nombreux cas. La maladie est causée par le polyomavirus humain 2 (HPyV-2) et touche particulièrement les patients dont les défenses immunitaires cellulaires sont considérablement affaiblies. Chez les patients atteints d’une maladie hématologique sous-jacente en particulier, le taux de mortalité de la LEMP atteint près de 90%. En l’absence actuelle d’options thérapeutiques autorisées, l’utilisation de cellules T allogéniques spécifiques du virus constitue une nouvelle thérapie expérimentale réussie. En l’absence de contre-indication, le pembrolizumab, un anticorps anti-PD-1, peut également être utilisé dans le traitement de la LEMP si les personnes concernées présentent leurs propres cellules T HPyV-2 spécifiques dans le sang. L’analyse métabolomique doit permettre d’identifier, dans la mesure du possible, des biomarqueurs pronostiques préthérapeutiques dans le LCR et le sérum des patients atteints de LEMP, afin de prédire la réponse à un traitement par cellules T allogéniques spécifiques du virus ou par pembrolizumab [7].
Depuis 2020, les patients atteints de LEMP sont traités sur la base d’essais thérapeutiques individuels avec des cellules T allogéniques partiellement compatibles HLA et spécifiques du virus, provenant de donneurs non apparentés ou apparentés. Dans le cadre de ce travail, des échantillons de sérum et de LCR provenant de 11 patients répondeurs et de 5 patients non répondeurs ont été soumis à une analyse métabolomique dirigée par spectrométrie de masse. De plus, des échantillons de deux patients ayant bien profité d’un traitement par pembrolizumab ont été analysés. Les tracés PLS-DA à validation croisée ont montré une séparation nette entre les groupes de répondeurs et de non-répondeurs. Pour 35 métabolites, les concentrations étaient significativement plus élevées dans le groupe des répondeurs au traitement, tandis que 25 métabolites étaient significativement plus faibles dans ce groupe. Dans ce contexte, la proline bétaïne a été identifiée comme un biomarqueur sérique potentiel. L’analyse du métabolome du LCR avant le début du traitement a montré des niveaux significativement plus élevés d’acide docosahexaénoïque (DHA) et d’hypoxanthine chez les patients qui n’ont pas répondu au traitement, en comparaison des deux groupes. L’application de cellules T allogéniques spécifiques du virus a permis d’obtenir des résultats thérapeutiques prometteurs dans la LEMP. Le métabolite apparenté à la bétaïne, la proline bétaïne, a été identifié comme un biomarqueur sérique potentiel pour prédire la réponse au traitement.
Maux de tête induits par le froid
Il existe plusieurs approches de la physiopathologie des céphalées primaires. Cliniquement, il existe de nombreux recoupements entre la migraine et les céphalées induites par le froid (HICS), par exemple l’augmentation de l’incidence des HICS chez les patients migraineux ou la latéralisation des HICS du côté des céphalées migraineuses. Cependant, il n’existe à ce jour aucune donnée permettant de comparer la physiopathologie de ces deux entités. L’objectif principal d’une étude était de déterminer le rôle de la molécule CGRP dans le déclenchement du HICS chez les patients souffrant de migraine chronique [8]. Une étude a été menée sur 17 sujets souffrant de migraine chronique avant et quatre semaines après l’initiation du traitement par l’erenumab. Aux moments de l’examen, un HICS a été déclenché chez les sujets par 200 ml d’eau glacée, selon un protocole standardisé, pendant lequel les paramètres vitaux et la représentation échographique doppler de l’artère cérébrale moyenne ont été enregistrés des deux côtés dans la fenêtre sonore temporale. Sur le plan clinique, une réduction de la prévalence du HICS a été constatée. Les symptômes associés trigémino-autonomes n’étaient plus détectables après l’utilisation de l’érénumab. Une analyse de sous-groupe a révélé une diminution encore plus importante de la prévalence en cas de réponse clinique de la migraine à l’erenumab. L’échographie Doppler a montré une diminution du flux sanguin cérébral sous la forme d’une diminution de la vitesse moyenne du flux et d’une augmentation de l’indice de résistance lors de la comparaison des deux mesures. Un lien physiopathologique entre la migraine et le HICS doit donc être postulé.
Congrès : 96e congrès de la Société allemande de neurologie (DGN)
Littérature :
- Höglinger GU, Trenkwalder C : Nouvelle ligne directrice S2k sur la maladie de Parkinson. Session Hot Topics le 11 novembre 2023. 96e Congrès DGN 2023, Berlin/virtuel, 8-11 novembre 2023.
- Brandet JM : Physiopathologie de la maladie de Parkinson : étude de la protéine alpha-synucléine liée à l’ubiquitine, de la dopamine et des dysfonctionnements des systèmes protéasomal et lysosomal par des méthodes de physique nucléaire théorique. Abstract 42. 96e Congrès DGN 2023, Berlin/virtuel, 8-11 novembre 2023.
- Uttner I, et al. : Influence de la luminance et du contraste sur la reconnaissance d’images : Evaluation d’un test de mémoire nouvellement développé, orienté sur le potentiel d’apprentissage, pour le diagnostic précoce de la démence d’Alzheimer. Abstract 65. 96e Congrès DGN 2023, Berlin/virtuel, 8-11 novembre 2023.
- Vernikouskaya I, et al : Convolutional neural network-assisted segmentation of the hypothalamus from MRI to assess hypothalamic atrophy in amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Abstract 79. 96e Congrès DGN 2023, Berlin/virtuel, 8-11 novembre 2023.
- Steeken L, et al : Démangeaisons neuropathiques dans la sclérose en plaques ? Abstract 272. 96e Congrès DGN 2023, Berlin/virtuel, 8-11 novembre 2023.
- Nasca A, et al. : Première crise d’épilepsie chez les personnes âgées et leucoencéphalopathie microangiopathique : sur le rôle clé des lésions juxtacorticales de la moelle et de l’atrophie corticale régionale. Abstract 131. 96e Congrès DGN 2023, Berlin/virtuel, 8-11 novembre 2023.
- Möhn N, et al : Analyse du métabolome dans le LCR et le sérum de patients atteints de leucoencéphalopathie multifocale progressive sous traitement par des cellules T allogéniques spécifiques du virus. Abstract 244. 96e Congrès DGN 2023, Berlin/virtuel, 8-11 novembre 2023.
- Sorge J, et al. : Le rôle du CGRP dans les céphalées induites par le froid. Abstract 644. 96e Congrès DGN 2023, Berlin/virtuel, 8-11 novembre 2023.
InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2023 ; 21(6) : 20-22 (publié le 2.12.23, ahead of print)