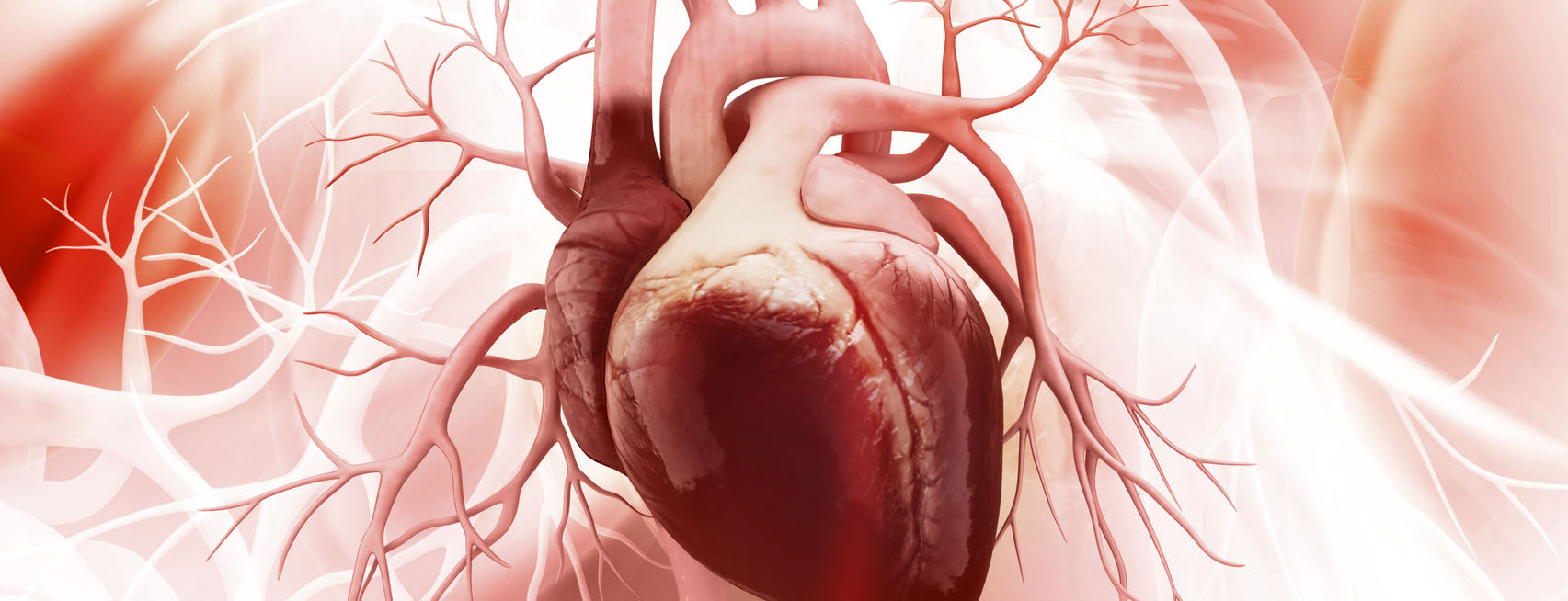Environ 15 600 personnes de 134 pays ont participé à la 51e conférence européenne sur le diabète à Stockholm (Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes). Les résultats de l’étude EMPA-REG sur l’empagliflozine, qui a montré pour la première fois l’influence positive d’un antidiabétique sur la mortalité cardiovasculaire, ont fait sensation. Nous rapportons également des études sur la fragilité chez les diabétiques, sur le lien entre néphropathie et rétinopathie et sur la carence en vitamine B12 suite à un traitement par metformine.
L’étude EMPA-REG-Outcome sur l’empagliflozine (Jardiance®), un inhibiteur du SGLT-2, avait pour objectif de montrer les effets cardiovasculaires de la molécule chez les diabétiques de type 2 présentant un risque élevé de maladie cardiovasculaire [1]. Au total, 7020 patients ont été randomisés en trois groupes : Le groupe 1 a reçu 10 mg d’empagliflozine en plus du traitement standard (antidiabétiques et médicaments destinés à réduire le risque cardiovasculaire, y compris les antihypertenseurs et les statines), le groupe 2 a reçu 25 mg d’empagliflozine en plus du traitement standard et le groupe 3 a reçu un placebo en plus du traitement standard. Le critère d’évaluation principal était le décès dû à une maladie cardiovasculaire, l’infarctus du myocarde non fatal et l’accident vasculaire cérébral non fatal.
Le critère d’évaluation a été réduit dans les données regroupées des deux groupes de traitement par le verum, avec une réduction relative de 14% par rapport au placebo (10,5% vs 12,1%). La mortalité cardiovasculaire a été significativement réduite de 38% (3,7% vs 5%) dans le groupe de patients traités par l’inhibiteur de SGLT-2, de même que la mortalité globale de 32% (5,7% vs 8%). EMPA-REG-Outcome est ainsi la première étude à montrer l’influence positive d’un antidiabétique sur la mortalité.
Risque de mortalité chez les diabétiques de type 2 fragiles
Dans une étude néerlandaise, les auteurs ont examiné le lien entre le degré de fragilité (frailty), l’HbA1c et la mortalité [2]. L’étude d’observation prospective a porté sur 858 diabétiques de type 2 âgés de plus de 60 ans et suivis en cabinet par des médecins de premier recours. La frailty a été définie comme un score inférieur à 80 sur l’échelle des capacités physiques du questionnaire RAND-36. Le suivi médian était de 14 ans. Des facteurs tels que l’âge, le sexe, l’IMC, la durée du diabète et les facteurs de risque cardiovasculaire ont été pris en compte dans l’analyse.
L’âge moyen de la population étudiée était de 72 ans. 73% des patients ont été considérés comme fragiles ; chez eux, des taux élevés d’HbA1c ont augmenté la mortalité cardiovasculaire et la mortalité totale (hazard ratio 1,19 et 1,11 respectivement). Aucune association de ce type n’a été observée chez les participants à l’étude qui n’étaient pas fragiles. Cependant, ces différences disparaissaient pour la plupart lorsque seules les données des patients souffrant de diabète de type 2 depuis plus de cinq ans étaient analysées. Les auteurs en concluent que chez les patients fragiles, une HbA1c élevée augmente certes la mortalité totale et la mortalité cardiovasculaire, mais que l’impact est très faible – par rapport aux personnes non fragiles. La durée du diabète semble être plus importante que la fragilité.
Protection contre la rétinopathie, mais pas contre la néphropathie
Les diabétiques de type 1 atteints de néphropathie (DN) développent souvent aussi une rétinopathie (DR), mais les diabétiques atteints de rétinopathie n’ont souvent pas de néphropathie. Ce fait suggère qu’il existe des causes différentes – et des facteurs protecteurs différents – pour les deux maladies. Une étude américaine menée à Boston a examiné les relations correspondantes [3]. Dans la cohorte, les diabétiques de type 1 ont été répartis en quatre groupes :
- Avec DN et DR (+DN/+DR, n=63)
- Avec DN, mais sans DR (+DN/-DR, n=30)
- Sans DN, mais avec DR (-DN/+DR, n=345)
- Sans DN et sans DR (-DN/-DR, n=326).
Dans le groupe +DN/-DR, le taux de maladies cardiovasculaires était étonnamment plus faible que prévu (34,5%) lorsqu’il était comparé aux taux des autres groupes (+DN/+DR : 71,0%, -DN/+PDR : 43,8%, -DN/-DR : 29,3%). Le taux de patients chez qui le peptide-C a été détecté était également le plus élevé dans le groupe +DN/-DR (56,7%, contre 30-35% dans les autres groupes).
La sécrétion de “vascular endothelial growth factor” (VEGF) par les fibroblastes suite à une stimulation par l’insuline et l’hypoxie était deux fois plus élevée dans le groupe +DN/-DR que dans le groupe +DN/+DR, la réponse du VEGF était la plus forte dans le groupe -DN/-DR (la réponse du VEGF à la stimulation était inversement proportionnelle à la prévalence des maladies cardiovasculaires dans les quatre groupes).
La conclusion des auteurs : Dans cette cohorte, chez les patients atteints de néphropathie diabétique mais pas de rétinopathie, la prévalence des maladies cardiovasculaires était plus faible, la fonction des cellules bêta meilleure et la réponse du VEGF plus élevée que chez les patients atteints de néphropathie et de rétinopathie. Cela indique qu’il existe probablement des facteurs qui protègent simultanément contre les maladies cardiovasculaires et la rétinopathie diabétique.
Traitement à la metformine, carence en vitamine B12 et neuropathie
La metformine diminue les taux sériques de vitamine B12 et augmente les taux d’acide méthylmalonique (MMA), un biomarqueur de la carence en vitamine B12. La pertinence clinique d’une carence en vitamine B12 associée à la metformine est toutefois controversée, car les données cliniques sur les résultats font défaut à ce jour. Les directives actuelles mentionnent la carence en vitamine B12 comme un inconvénient du traitement par metformine, mais il n’existe aucune recommandation sur le diagnostic et la prévention d’une telle carence. Une étude néerlandaise a donc cherché à savoir si une augmentation de la MMA était associée au début ou à l’aggravation d’une neuropathie [4]. 390 diabétiques de type 2 traités à l’insuline ont également reçu jusqu’à 850 mg de metformine ou un placebo trois fois par jour pendant 52 mois. L’analyse a porté sur les relations entre les variations de l’HBA1c, la valeur de la MMA et le score de Valk (score permettant de diagnostiquer une neuropathie).
La metformine a augmenté les taux de MMA par rapport au placebo. Au terme des 52 mois, aucune différence n’a été observée entre le groupe metformine et le groupe placebo en termes de score de neuropathie. Cependant, cela a été attribué à la réduction plus importante de l’HbA1c dans le groupe metformine, car la neuropathie s’est également aggravée dans le groupe avec augmentation de l’AMM. Pour les auteurs, ces résultats indiquent qu’une carence en vitamine B12 induite par un traitement à la metformine peut être cliniquement pertinente. Le contrôle des taux de vitamine B12 et, si possible, de MMA doit être envisagé chez les patients traités par la metformine.
Source : 51e réunion annuelle de l’Association européenne pour l’étude du diabète (EASD), 14-18 septembre 2015, Stockholm
Littérature :
- Zinman B, et al : Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2015 ; DOI : 10.1056/NEJMoa1504720
- Hartog LC, et al. : Frailty and the relationship between HbA1c and mortality in elderly patients with type 2 diabetes. EASD 2015, paragraphe 225.
- Hillary KA, et al : Protection from diabetic retinopathy, but not nephropathy. EASD 2015, paragraphe 228.
- Out M, et al : Metformin, methylmalonic acid and the risk of neuropathy : a randomised placebo-controlled trial. EASD 2015, paragraphe 220.
CARDIOVASC 2015 ; 14(6) : 30-31