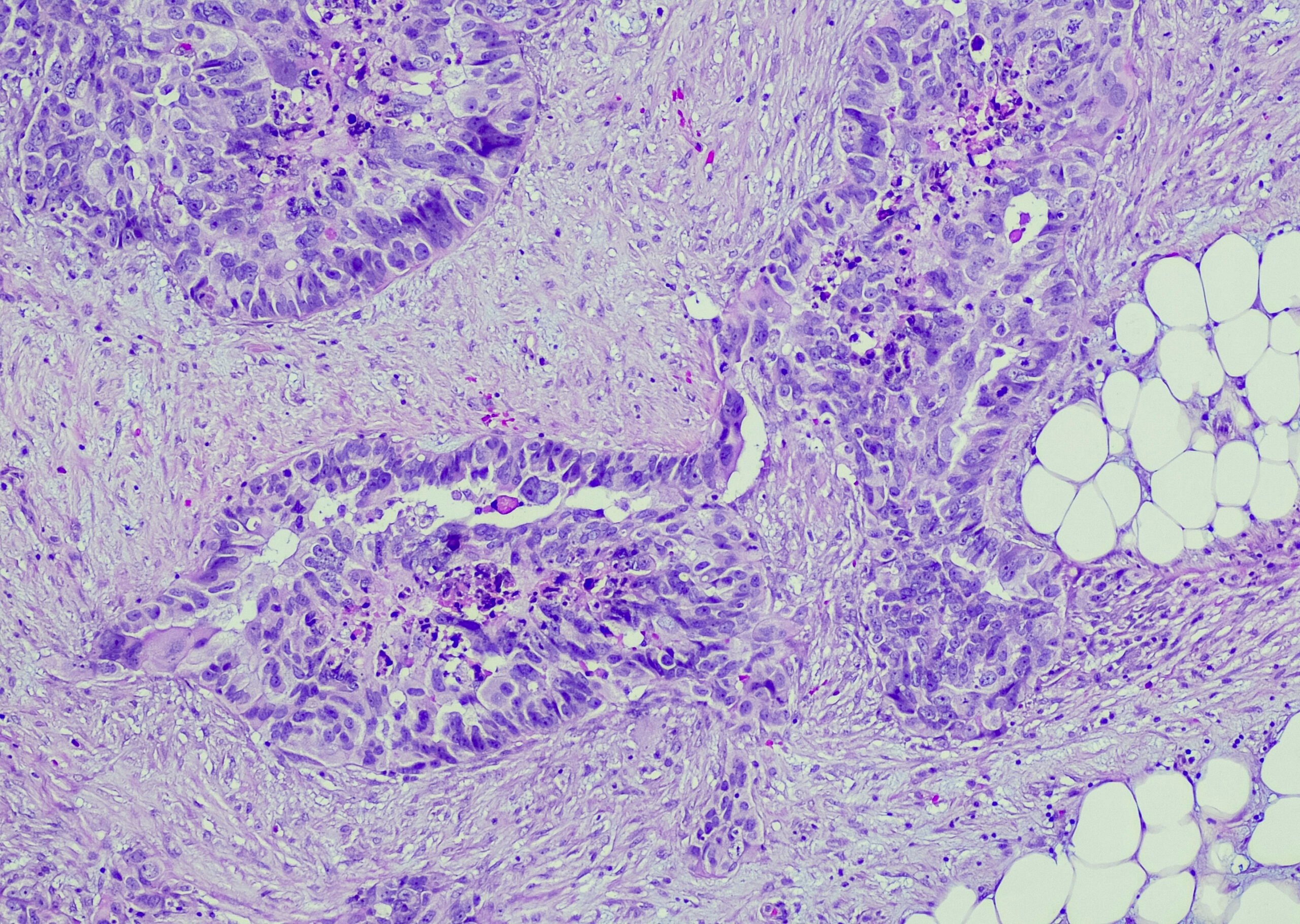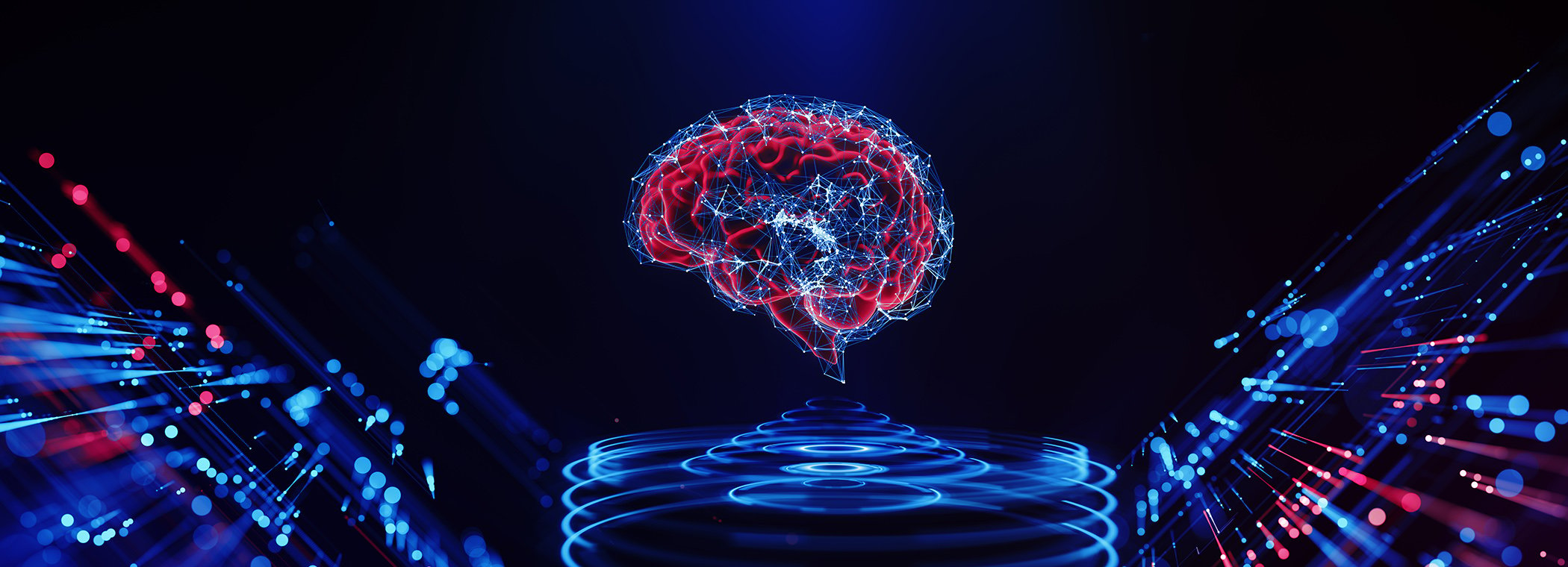Près de 9% des femmes enceintes développent un diabète gestationnel. Il existe depuis peu de nouveaux critères de diagnostic. Pour le traitement, on dispose à la fois d’insuline et d’antidiabétiques oraux. Lors du symposium DIP (The 7th international Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy) à Florence, des rapports ont été rédigés sur la manière dont le diabète devrait être diagnostiqué et traité de manière moderne chez les femmes enceintes.
Le diabète est un problème croissant chez les femmes enceintes. Alors qu’en 1980, seulement 5% des femmes enceintes étaient atteintes de diabète gestationnel ou souffraient déjà de diabète, elles étaient près de 9% en 2008 [1]. Près de la moitié des femmes enceintes atteintes de diabète gestationnel développent également une forme manifeste de diabète dans les 20 à 30 années qui suivent [2].
Le diabète gestationnel est défini comme “tout degré d’intolérance au glucose qui survient ou est diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse” [3–6]. Certains chercheurs considèrent que les critères actuels sont trop stricts, mais ils résultent de la critique selon laquelle il y a trop peu de preuves pour pouvoir déterminer le risque associé à l’intolérance au glucose pour la mère et l’enfant [7].
Recommandations de l’IADPSG pour le diagnostic du diabète gestationnel
En se basant sur l’étude HAPO, une grande étude multicentrique en aveugle sur le déroulement de la grossesse en cas d’hyperglycémie [8], l’International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group (IADPSG) a publié en 2010 de nouvelles recommandations sur le diagnostic et la classification de l’hyperglycémie pendant la grossesse [9]. “La stratégie de diagnostic comprend deux étapes distinctes”, a résumé le professeur David McIntyre, directeur du Mater Medical Research Institute à l’université du Queensland à Brisbane, en Australie. Dans un premier temps, le groupe de travail sur le dépistage du diabète chez les femmes enceintes recommande de dépister toutes les femmes enceintes en général et d’accorder une attention particulière aux groupes de population présentant une prévalence élevée de diabète de type 2. Lors de la première visite chez le médecin après la découverte de la grossesse, la première étape consiste à mesurer la glycémie à jeun, l’HbA1c ou une glycémie occasionnelle. Si les résultats indiquent un diabète manifeste (tab. 1), celui-ci sera traité conformément aux lignes directrices.

Toutefois, si les résultats ne permettent pas de poser un diagnostic de diabète manifeste, alors que la glycémie à jeun se situe entre 5,1 et 6,9 mmol/l, il s’agit d’un diabète gestationnel. La deuxième étape du dépistage du diabète consisterait à soumettre à un test de tolérance au glucose oral (OGTT) avec 75 mg de glucose, entre la 24e et la 28e semaine de grossesse , toutes les femmes enceintes chez qui aucun diabète manifeste ni aucun diabète gestationnel n’a été détecté à ce jour, mais qui présentent une glycémie à jeun inférieure à 5,1 mmol/l ( tableau 2).

L’IADPSG a défini des seuils à partir desquels le diagnostic de diabète gestationnel ou de diabète manifeste est posé (tableau 1). Le professeur McIntyre a ajouté que si ces directives de l’IADPSG étaient suivies à la lettre, le diabète gestationnel pourrait être détecté plus de deux fois plus souvent [10].
Les associations de diabétiques dans des pays comme l’Amérique, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et l’Inde ont désormais adopté les critères de l’IADPSG. “Mais certains experts critiquent également ces recommandations”, a rapporté le professeur McIntyre. Le coût élevé des nombreux tests et le manque partiel de fiabilité de l’OGTT, par exemple, sont des facteurs sous-optimaux. L’obésité chez les femmes enceintes est également un sujet trop peu abordé. Selon le professeur McIntyre, les données indiquent que le dépistage est bénéfique. Il restait à étudier les conséquences et les effets à long terme du traitement sur la mère et l’enfant.
D’abord un régime de deux semaines, ensuite des médicaments
Selon le professeur Mark Landon, président du département d’obstétrique et de gynécologie du Ohio State University College of Medicine, aux États-Unis, le dépistage et le traitement du diabète gestationnel permettent de réduire considérablement la mortalité et la morbidité des bébés.
Selon le cinquième atelier international sur les soins du diabète, la glycémie à jeun devrait être inférieure à 5,3 mmol/l, après une à <7,8 mmol/l et après deux heures après l’OGTT à <6,7 mmol/l [11]. Selon le professeur Landon, les médicaments ne sont pas nécessaires immédiatement en cas de diabète gestationnel. Il faut d’abord conseiller aux patients d’essayer de suivre un régime pendant au moins deux semaines. Cependant, les femmes enceintes dont la glycémie à jeun est de >5,3 mmol/l pourraient se voir prescrire de l’insuline après une semaine de régime ou dès le diagnostic [12].
Les insulines appropriées pour le traitement sont : Lispro, Aspart, Glargine et Detemir. Le professeur Landon a résumé les études (comparaison avec l’insuline humaine) : Les femmes sous Lispro avaient des taux d’HbA1c similaires à celles sous insuline humaine régulière après six semaines. Cependant, le lispro a entraîné moins d’hypoglycémies [13], le lispro semble mieux réduire les taux de glucose postprandial [14]. La préparation d’insuline Aspart a également été plus efficace que l’insuline humaine pour réduire la glycémie postprandiale. Aucune différence n’a été observée en ce qui concerne les résultats périnataux avec Lispro et Aspart par rapport à l’insuline humaine [15]. “Les insulines analogues à action rapide sont mieux adaptées que l’insuline humaine pour réduire les hyperglycémies postprandiales”, a résumé le professeur Landon. “Ces deux préparations devraient être l’insuline standard lors des repas”.
Les insulines à action prolongée glargine et détémir ont été peu étudiées chez les femmes enceintes, a rapporté le professeur Landon. Des études indiquent que les hypoglycémies nocturnes sont moins fréquentes. Cependant, une éventuelle activité mitogène de la glargine et du détémir n’a pas été établie. “Des études doivent d’abord démontrer si ces insulines sont meilleures que l’insuline humaine”, a déclaré le professeur Landon.
Les médicaments oraux ont l’avantage d’être faciles à prendre, ce qui peut améliorer l’observance. Parmi les sulfonylurées, seul le glyburide a montré un transfert minimal vers le fœtus. Dans les études cliniques, l’hypoglycémie néonatale n’est pas plus fréquente [16]. Le glyburide permet de réduire la glycémie de manière similaire à l’insuline humaine. En outre, le glyburide a entraîné moins d’hypoglycémie symptomatique chez les femmes enceintes. 4% des femmes traitées par glyburide ont tout de même eu besoin d’insuline, car les glyburides n’ont pas été détectés dans le sang du cordon ombilical et les résultats néonataux des glyburides et de l’insuline sont comparables [17].
La metformine peut réduire la glycémie aussi bien que l’insuline et semble être aussi sûre. L’utilisation de l’insuline semble toutefois plus répandue, mais près de 50% des femmes traitées par metformine ont besoin d’insuline supplémentaire [18]. Le professeur Landon a fait remarquer qu’il y avait encore trop peu d’études comparant les résultats maternels et infantiles entre l’insuline et les antidiabétiques oraux.
Une revue systématique n’a pas trouvé de différence dans l’incidence des malformations congénitales avec l’insuline par rapport au glyburide ou à la metformine ; le poids à la naissance était également comparable [19]. “Tant l’insuline que les glyburides ou la metformine peuvent être utilisés pendant la grossesse”, explique le professeur Landon. Les risques à court terme des antidiabétiques oraux, s’ils existent, seraient minimes par rapport à l’insuline. Toutefois, selon le professeur Landon, d’autres études sont nécessaires pour garantir la sécurité à long terme pour la mère et l’enfant.
Bibliographie chez l’éditeur
Dr. med. Felicitas Witte
Source : The 7th international Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy, Florence, 14-16 mars 2013
PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2013 ; 8(6) : 43-44