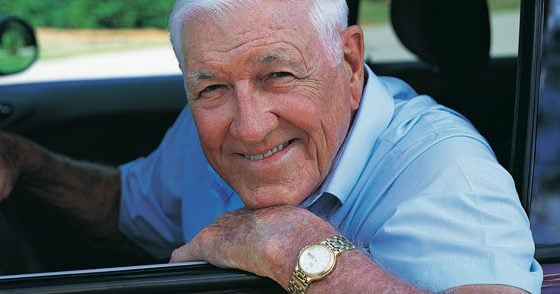Pour des raisons pronostiques, l’implantation d’un stimulateur cardiaque devrait également être recommandée aux patients asymptomatiques atteints d’AVB II° de type Mobitz ou d’AVB III°. Les maladies du nœud sinusal (par ex. bloc SA, bradycardie sinusale) ont généralement un bon pronostic et ne nécessitent un traitement par stimulateur cardiaque qu’en cas de bradycardie symptomatique. Les bradycardies fonctionnelles ne nécessitent généralement pas de traitement par stimulateur cardiaque, tout comme un AVB I° ou un AVB II° de type Wenckebach. Les causes réversibles les plus fréquentes de bradycardie sont les médicaments bradycardisants, l’ischémie myocardique, les intoxications et les troubles électrolytiques. En cas d’intolérance à l’effort ou d’insuffisance cardiaque inexpliquée, il convient de rechercher un AVB de type 2:1, car les ondes P localisées dans l’onde T peuvent facilement être ignorées.
Le traitement standard des arythmies bradycardiques symptomatiques irréversibles est l’implantation d’un stimulateur cardiaque. En 2015, 5170 stimulateurs cardiaques ont été implantés rien qu’en Suisse. L’âge moyen des patients lors de la première implantation était de 77 ans [1].
Il existe désormais des systèmes de stimulation sans électrodes (Fig. 1) qui, contrairement aux stimulateurs traditionnels, sont placés dans le ventricule droit via la veine fémorale . L’utilisation de ces dispositifs à chambre unique reste toutefois réservée à un nombre limité de patients. Selon les premières données, les “leadless devices” peuvent être considérés comme sûrs et viables [2].

Étiologie de la bradycardie
Dans 88,5% des implantations de stimulateurs cardiaques, l’étiologie de la bradycardie reste inconnue [1]. Les médicaments bradycardisants doivent être arrêtés si possible. Il convient de noter que les formes d’application locale peuvent également avoir un effet systémique (par exemple, le timolol, un bêtabloquant, dans les gouttes pour les yeux). Certains médicaments non cardiaques peuvent également provoquer des troubles de la conduction AV – ils sont présentés dans le Tableau 1 en résumé. L’ischémie coronarienne est une cause fréquente et traitable de troubles de la fonction du nœud sinusal ou de la conduction AV, qui doit être recherchée et traitée en cas de symptômes typiques de l’ischémie ou de profil de risque correspondant [3]. Les intoxications ou les troubles électrolytiques, en particulier l’hyperkaliémie, entraînent également des bradycardies. En cas de suspicion clinique de borréliose, les IgM et IgG de B. burgdorferi peuvent être déterminées (ELISA comme test de recherche, Western blot comme test de confirmation), mais les résultats faussement positifs ne sont pas rares. Les titres d’IgM peuvent être élevés de manière persistante pendant des mois. Les troubles de la conduction de l’excitation comme première manifestation d’une maladie rhumatismale (par ex. lupus érythémateux disséminé) ou infiltrative (amylose) sont rares [3].

Clinique et diagnostic
La cause de la bradycardie est généralement un dysfonctionnement du nœud sinusal ou un trouble de la conduction auriculo-ventriculaire (Fig. 2-8). Les symptômes typiques de la bradycardie ou de l’asystolie sont la dyspnée, l’intolérance à l’effort et surtout les vertiges, voire les présyncopes ou les syncopes. Dans le cas du BAV de type 2:1 en particulier, une intolérance soudaine à l’effort peut s’accompagner d’une dyspnée ou de symptômes d’insuffisance cardiaque [4]. En cas de BAV I° ou BAV II° long de type Wenckebach, des symptômes tels que des palpitations ou des pulsations dans la région des veines jugulaires peuvent apparaître en raison du temps de conduction AV très long et de la contraction auriculaire diastolique précoce consécutive.



Les valves AV ne sont pas encore ouvertes pendant la contraction auriculaire et il se produit un “greffage auriculaire” [3]. Si les troubles du rythme sont persistants, un ECG normal à 12 dérivations suffit à établir le bon diagnostic. En cas d’apparition paroxystique de bradycardies, un holter ECG est nécessaire. Dans ce cas, la durée d’enregistrement doit être adaptée à la fréquence des symptômes (tableau 2). En cas de longs intervalles sans symptômes, l’implantation d’un enregistreur en boucle peut être utile pour établir le diagnostic. Un examen électrophysiologique n’est que rarement nécessaire pour un examen plus approfondi, par exemple en présence d’un bloc de branche à l’ECG de repos et en cas de syncopes récurrentes d’étiologie indéterminée ou en cas de st. n. infarctus du myocarde et de suspicion clinique de tachycardie ventriculaire [3]. Si les syncopes sont survenues lors d’un effort physique, il est recommandé d’effectuer une ergométrie pour clarifier la situation. Si l’on suspecte cliniquement des syncopes réflexes, il convient d’effectuer un examen de la table basculante ainsi qu’un test de pression carotidienne. Les deux examens ne sont positifs que si une réaction cardioinhibitrice est documentée [3].

Indication du stimulateur cardiaque
Les lignes directrices de la Société européenne de cardiologie (ESC) sur le traitement par stimulateur cardiaque et la resynchronisation cardiaque (CRT) ont été mises à jour et largement révisées en 2013 (Fig. 9, Tab. 3 et 4) [3].

En cas de maladie du nœud sinusal (syndrome du sinus malade, incompétence chronotrope, arrêt sinusal, bloc SA), le pronostic est généralement bon et l’implantation d’un stimulateur cardiaque ne doit être effectuée que pour traiter les bradycardies ou asystolies symptomatiques documentées. Aucune réduction de la mortalité n’a été démontrée par le traitement par stimulateur cardiaque [3]. Il en va de même pour le syndrome de Tachy-Brady.

En cas de blocage AV I° et II° de type Wenckebach, le pronostic est également bon et l’implantation d’un stimulateur cardiaque n’est indiquée qu’en cas de symptômes. En raison du pronostic défavorable d’un BAV II° de type Mobitz ou d’un bloc AV total non traité, l’implantation d’un stimulateur cardiaque est également indiquée chez les patients asymptomatiques.

En outre, la thérapie de resynchronisation (CRT) est indiquée chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque, d’une réduction de la fonction systolique du VG <35% et d’un bloc de branche gauche ou d’un retard de conduction intraventriculaire avec une largeur de QRS >150 ms. En l’absence de contre-indications, le CRT est généralement associé à un défibrillateur interne pour la protection contre la mort subite d’origine cardiaque.
Les syncopes cardioinhibitrices récurrentes sans prodromes sont associées à une grande souffrance, même si elles ont un pronostic globalement favorable. Après avoir épuisé les mesures conservatrices, l’implantation d’un stimulateur cardiaque peut réduire le taux de récidive des syncopes chez les patients âgés de 40 ans et plus. Dans un groupe de patients plus jeunes, cela n’a pas été prouvé et le traitement par stimulateur cardiaque n’est généralement pas recommandé [3].
En cas d’antécédents de syncopes et de documentation d’asystolies >6 secondes, l’indication d’un stimulateur cardiaque est également posée [3].
Une cause rare de syncope est le bloc de branche droit et gauche alterné, qui constitue une indication de stimulation cardiaque indépendamment de tout symptôme [3].
Littérature :
- Statistiques du groupe de travail sur les stimulateurs cardiaques et l’électrophysiologie de la Société Suisse de Cardiologie. www.arrhythmia.ch
- Reynolds D, et al : A Leadless Intracardiac Transcatheter Pacing System. N Engl J Med 2016 ; 374 : 533-541.
- Brignole M, et al. : 2013 ESC guidelines on cardiac pacing and resynchronisation therapy : the task force on cardiac pacing and resynchronisation therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Développé en collaboration avec l’Association européenne du rythme cardiaque (EHRA). Europace 2013 ; 15(8) : 1070-1118.
- Barold SS, Herweg B : Second-degree atrioventricular block revisited. Stimulateur cardiaque Ther Electrophysiol 2012 ; 23(4) : 296-304.
- Nada A, et al : The evaluation and management of drug effects on the cardiac conduction in clinical development. Am Heart J 2013 ; 165(4) : 489-500.
- Narula OS : Cardiac arhythmias : electrophysiology, diagnosis and management. Baltimore-Londres : Williams and Wilkins 1979.
CARDIOVASC 2016 ; 15(3) : 10-14