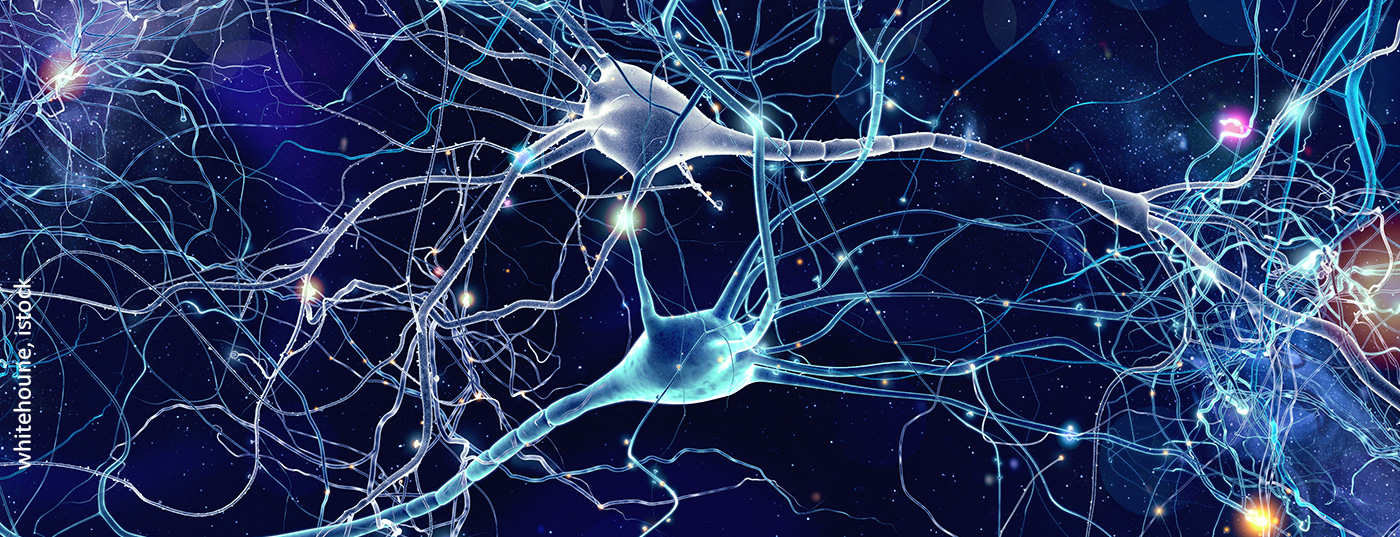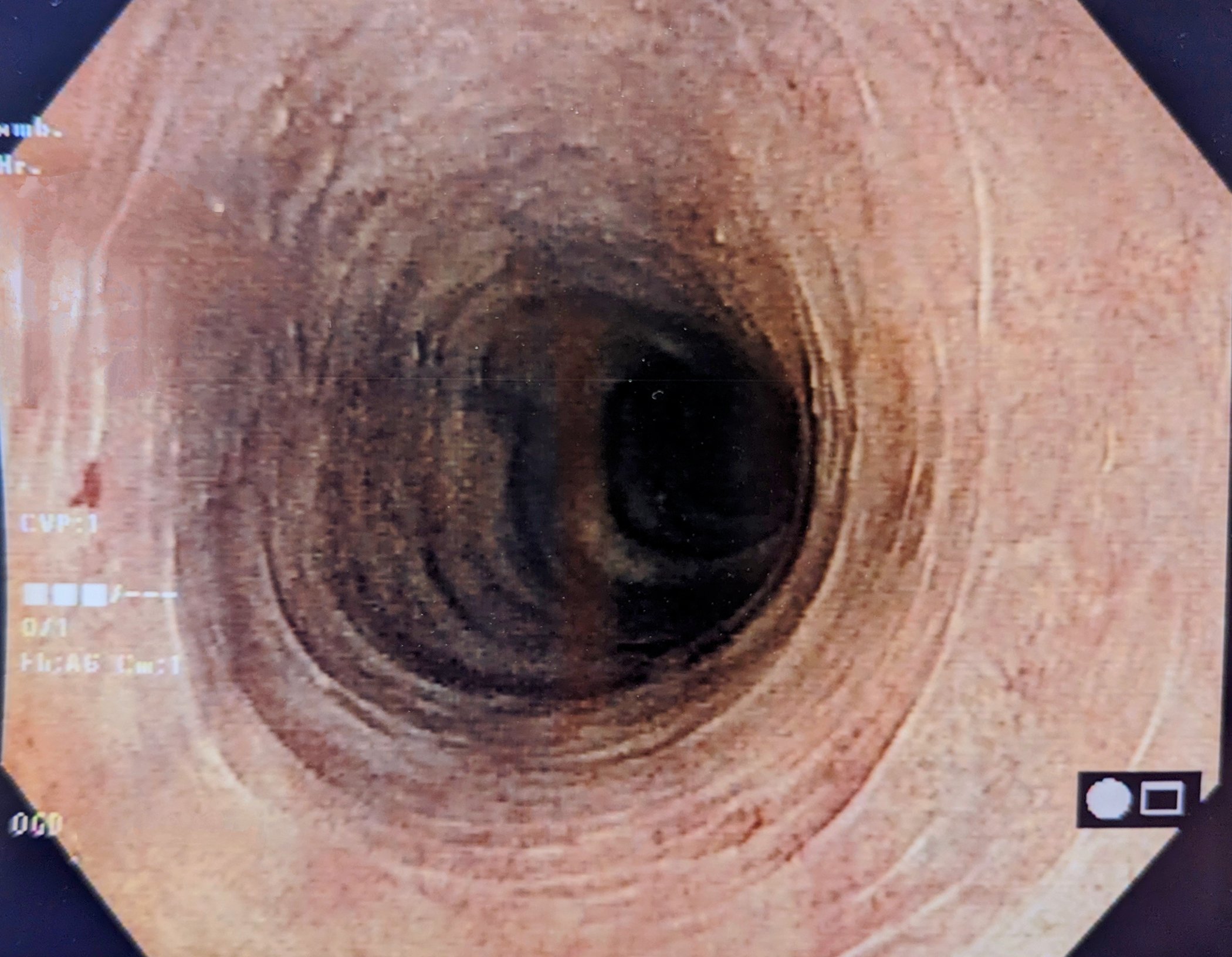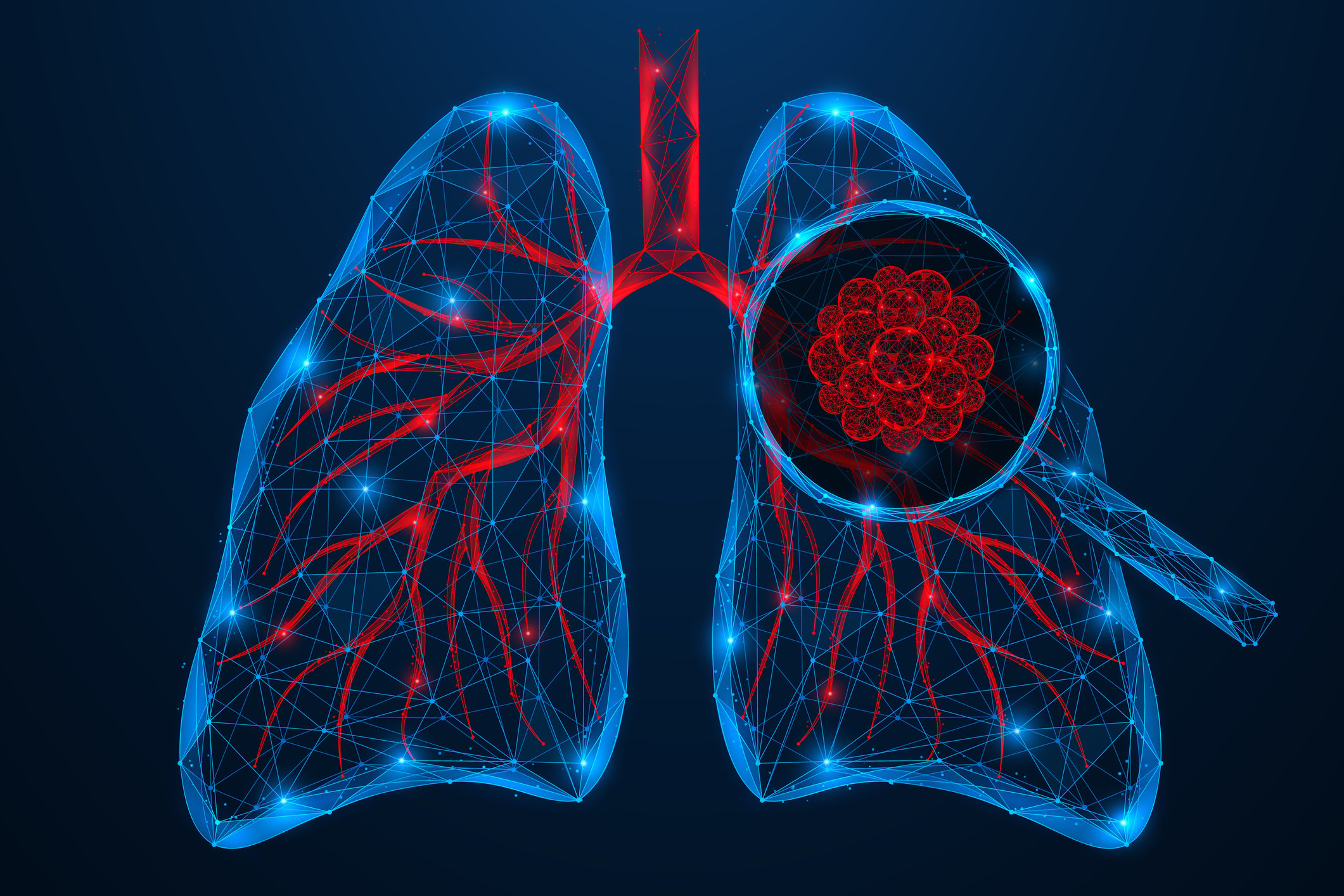La pathogenèse complexe de la sclérose en plaques (SEP) offre une multitude de cibles pour les interventions thérapeutiques. En outre, de nombreuses recherches sont menées afin de pouvoir poser un diagnostic précoce. En effet, la mise en place d’une gestion personnalisée du traitement pourrait réduire considérablement la charge de morbidité des personnes concernées. L’application de l’intelligence artificielle et la détection de biomarqueurs efficaces pourraient mettre cet objectif à portée de main.
La sclérose en plaques (SEP) reste la cause la plus fréquente de handicap neurologique non traumatique chez les jeunes adultes. Heureusement, la découverte de thérapies modificatrices de la maladie (DMT) très efficaces au cours des deux dernières décennies a radicalement changé les perspectives des personnes atteintes de SEP. Cependant, mesurer les résultats des soins médicaux est un défi. Les résultats rapportés par les médecins traitants ne correspondent souvent pas aux attentes des patients atteints de SEP, car certains de leurs troubles ne sont pas détectés par des examens neurologiques de routine. Cela conduit à des malentendus. D’autre part, les médecins traitants sont confrontés à des mesures qui ne reflètent pas de manière optimale l’évolution de la maladie de la SEP. L’échelle clinique EDSS, fréquemment utilisée, en est un exemple clair. Ces dernières années, les résultats d’une intervention clinique basés sur les rapports de patients Outcomes (PROs) ont pris de plus en plus d’importance. Les PRO sont recueillis directement auprès des patients et comprennent les symptômes, la fonction, l’état de santé et la qualité de vie liée à la santé. Cependant, il n’existe pas encore de lignes directrices pour la validation des PRO. L’objectif est de changer cela dans un avenir proche [1].
L’intelligence artificielle au service de la médecine personnalisée
Le diagnostic et la quantification de la charge de morbidité de la SEP reposent traditionnellement sur la reconnaissance de motifs visuels par des cliniciens expérimentés. Compte tenu de la quantité de données scientifiques, de l’hétérogénéité des évolutions de la maladie et du large éventail thérapeutique, de gros efforts ont été déployés pour appliquer l’intelligence artificielle (IA) à la SEP. Les méthodes d’apprentissage automatique (ML) analysent les données pour obtenir des modèles de décision, tandis que les outils d’apprentissage profond (DL) effectuent une sélection automatique des meilleures caractéristiques de résolution de problèmes. Ces deux approches bénéficient surtout de grands ensembles de données et sont donc utiles pour les études multicentriques et les essais cliniques à grande échelle. Les algorithmes ML et DL sont capables d’automatiser des tâches répétitives, d’analyser plus de données en moins de temps et d’atteindre une précision et une reproductibilité supérieures à celles de leur équivalent humain. L’application de l’IA a donné des résultats prometteurs dans le domaine de l’imagerie médicale (notamment l’IRM), permettant la segmentation automatique des lésions et des tissus, la classification des maladies et la synthèse de contrastes à partir de séquences étendues. Une telle approche est également adaptée au monde émergent des “omiques”, dans lequel l’analyse de grandes quantités de données provenant d’un seul patient est essentielle dans la perspective d’une médecine personnalisée [2].
Les biomarqueurs en ligne de mire
La neurodégénérescence et l’activation astrocytaire sont des caractéristiques pathologiques de la sclérose en plaques progressive et peuvent être quantifiées par la chaîne légère du neurofilament (sNfL) et la protéine acide fibrillaire gliale (sGFAP) sériques. Par conséquent, le sNfL et le sGFAP ont été étudiés plus en détail en tant qu’outils de stratification des patients atteints de SEP progressive sur la base de la progression et du statut d’activité de la maladie [3]. Pour ce faire, les valeurs sNfL et sGFAP ont été analysées chez 259 patients dans les six mois suivant le premier EDSS confirmé ≥3 comme ligne de base. Les patients progressifs ont été classés comme actifs/non actifs sur la base de nouvelles lésions cérébrales/médullaires ou de poussées au cours des deux années précédant la ligne de base ou pendant le suivi. Il a été démontré que le sNfL était plus élevé chez les patients progressifs présentant une activité de la maladie au cours des deux premières années de suivi et pendant toute la période de suivi disponible. Les niveaux de base de sGFAP étaient positivement associés à un risque plus élevé de progression de la maladie confirmée à six mois. Cette association était plus prononcée chez les patients ayant une faible valeur de sNfL. Des niveaux élevés de sNfL étaient associés à un déclin cognitif futur. Dans l’ensemble, il a été démontré que des valeurs plus élevées de sGFAP étaient un indicateur de progression, tandis que le sNfL reflétait l’activité aiguë de la maladie dans la cohorte de SEP progressive. Ainsi, les valeurs sGFAP et sNfL pourraient être utilisées pour stratifier les patients atteints de SEP progressive lors de leur inclusion dans des études de recherche clinique et des essais cliniques.
Congrès : 8e Congrès de l’Académie européenne de neurologie (EAN)
Littérature :
- Pot C : Les personnes atteintes de SEP sont au centre : Strategies to implement analogue and digital patient-reported outcomes in routine practice. EAN/ECTRIMS : Avancées scientifiques pour une transition immédiate vers la pratique clinique dans la sclérose en plaques. SYMP02-1. EAN Congress 2022.
- Rocca M : AI & MS diagnostic et diagnostic différentiel. Application de l’intelligence artificielle à l’IRM dans la sclérose en plaques : du diagnostic au pronostic et à la surveillance. FW08-2. EAN Congress 2022.
- Barro C, et al : Serum Glial Fibrillary Acidic Protein : A Biomarker of Disease Progression in Multiple Sclerosis. Présentation orale. OPR-136, Congrès EAN 2022.
InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2022, 20(4) : 36