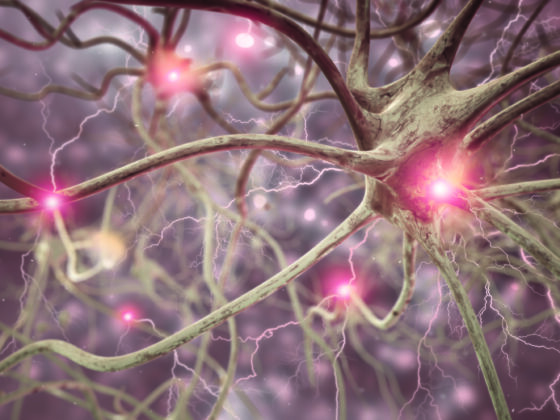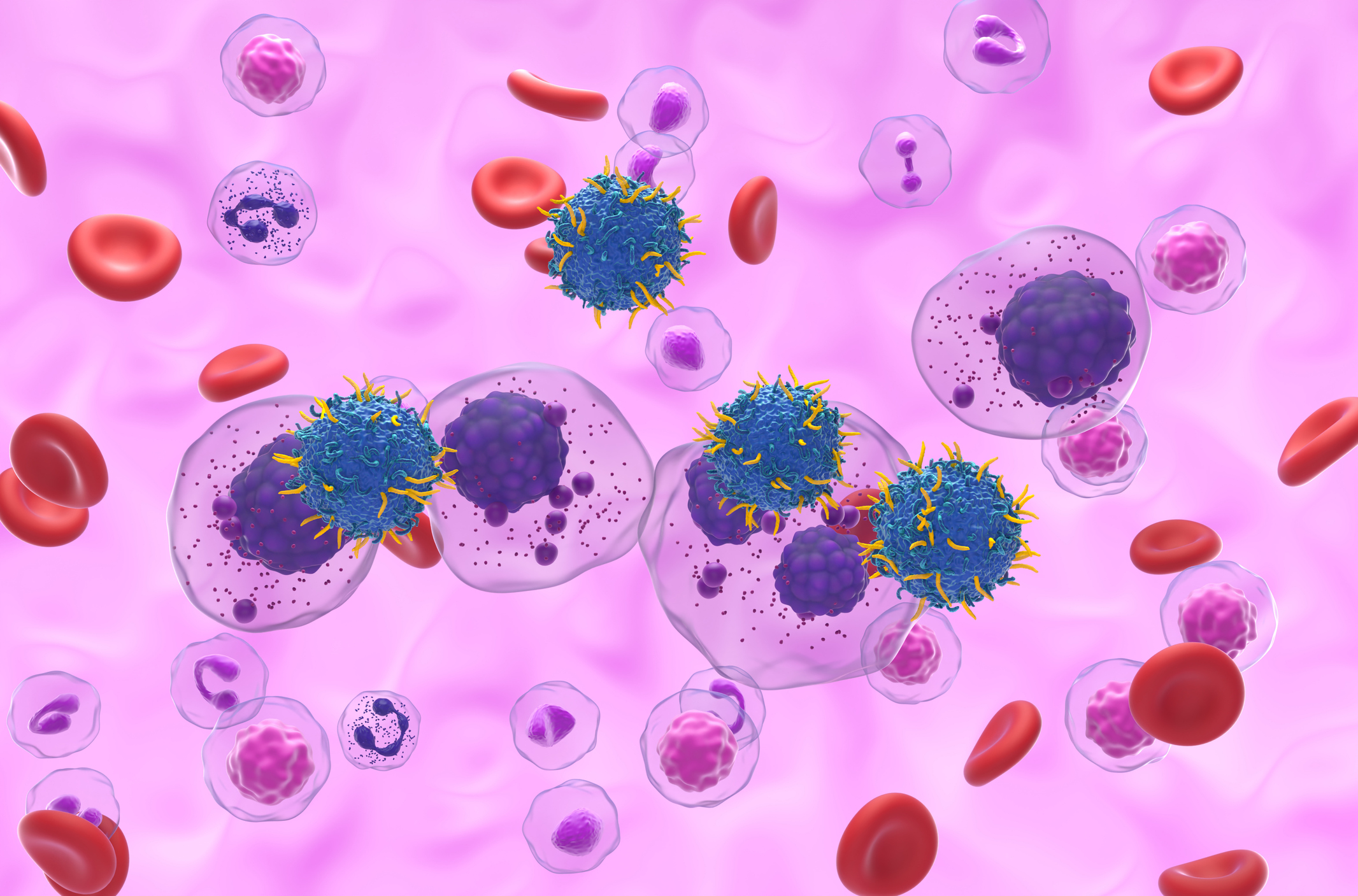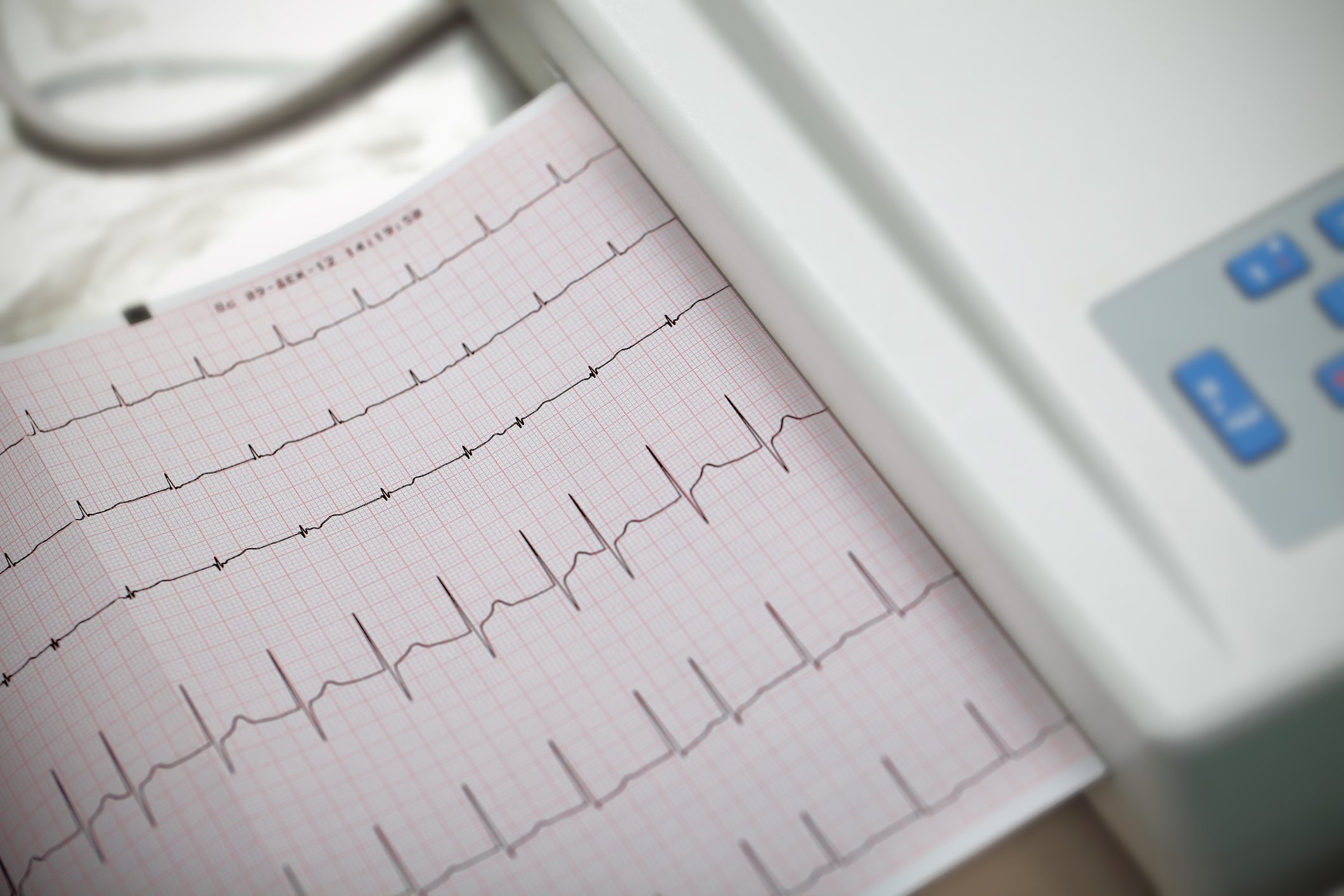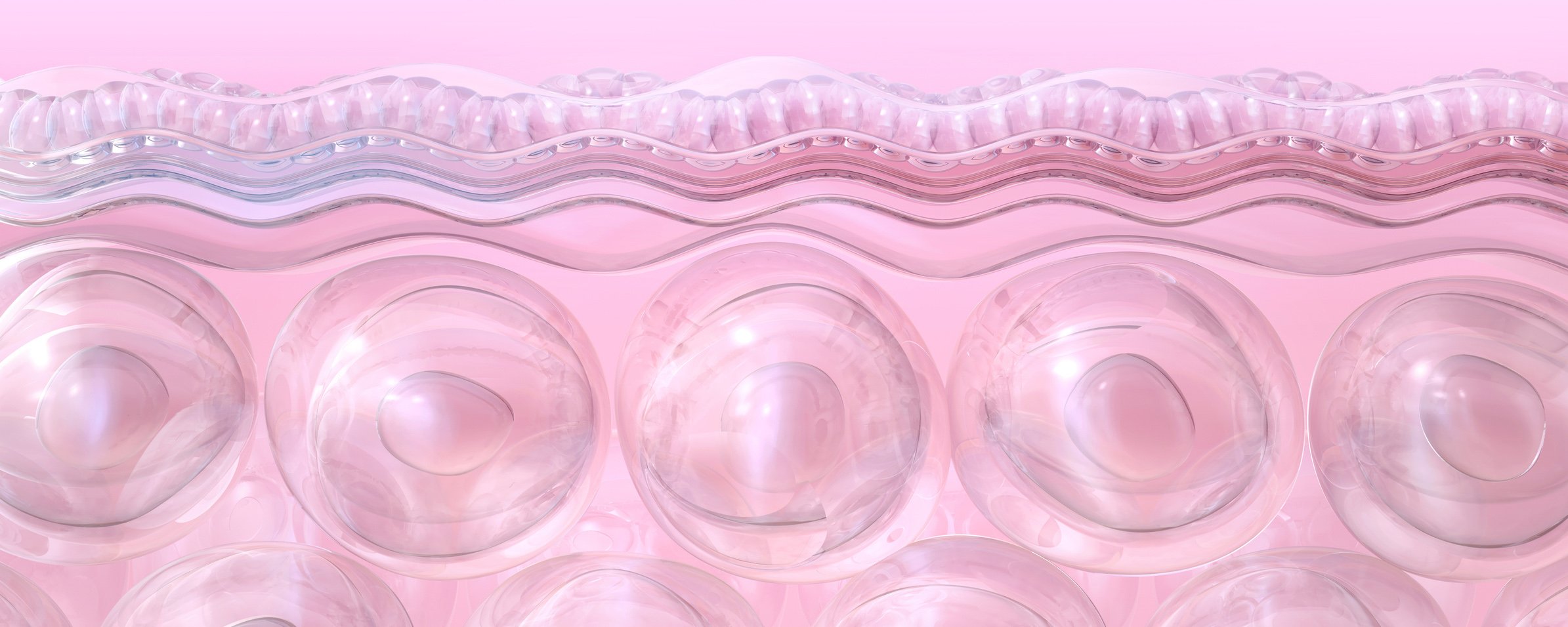Le domaine du diagnostic et du traitement de la maladie d’Alzheimer est devenu, ces dernières années, l’un des domaines les plus passionnants de la recherche médicale. Cela ne fait que 15 ans que l’imagerie moléculaire par TEP-scanner amyloïde a permis pour la première fois de détecter la pathologie de la maladie d’Alzheimer chez des personnes vivantes. Il y a de plus en plus de preuves que les anticorps monoclonaux qui éliminent les plaques amyloïdes semblent ralentir le déclin cognitif. Malheureusement, ces traitements sont également associés à l’ARIA, y compris le gonflement du cerveau et les hémorragies cérébrales. Ce phénomène et d’autres questions ont été au centre du congrès CTAD.
Des progrès récents dans le développement de nouvelles méthodes de mesure de l’amyloïde, de la tau et de la neurodégénérescence dans la maladie d’Alzheimer (MA), et de la neurodégénérescence dans le sang ont ouvert la possibilité de suivre les effets des médicaments dans les essais cliniques sur la maladie d’Alzheimer. Les découvertes d’espèces tau dans le cerveau, le LCR et le sang, telles que les phospho-taou spécifiques (p-Tau) et les espèces tronquées, y compris la région de liaison des microtubules (MTBR), ont considérablement élargi la compréhension de la biologie de la tau, le développement de molécules cibles et le suivi de l’effet des médicaments. Les changements à long terme de l’Aβ, de la tau et de la chaîne légère du neurofilament (NfL), qui étaient auparavant mesurés dans le LCR, peuvent désormais être mesurés avec précision dans le sang. Cela permet non seulement d’étudier et d’inclure des populations beaucoup plus importantes et diversifiées, mais aussi de planifier des études de prévention secondaire et primaire et de mesurer les effets des médicaments. Ces avancées promettent d’accélérer le développement de traitements et de mesures de prévention de la maladie d’Alzheimer.
Une étude a analysé les mesures plasmatiques sanguines d’Aβ42/40, de plusieurs espèces p-tau et de NfL dans la MA sporadique et dans des cohortes de MA à transmission dominante, et a déterminé la concordance avec les mesures du LCR, de l’amyloïde et de l’agrégation amyloïde et tau par tomographie par émission de positons (TEP) et les mesures cliniques et cognitives dans des cohortes cliniques locales et internationales [1]. Certaines de ces mesures ont également été utilisées pour mesurer l’effet des médicaments éliminant la plaque dentaire. Les résultats montrent que le rapport Aβ42/Aβ40 dans le LCR et le plasma sanguin et la phosphorylation de certaines espèces tau (par exemple p-tau217, p-tau181) dans les plaques amyloïdes diminuent en miroir sous traitement anti-amyloïde. En outre, les résultats obtenus à partir du LCR suggèrent que des mesures quantitatives de l’agrégation de la protéine tau peuvent être effectuées avec des espèces de fragments Tau-MTBR spécifiques, ce qui permet de suivre les effets de l’agrégation de la protéine tau séparément des effets amyloïdes. Les résultats montrent que les biomarqueurs de détection de l’amyloïde soluble ou agrégée, et maintenant l’agrégation de tau, sont des mesures très précises de l’amylose cérébrale, de la tauopathie et de la neurodégénérescence. L’utilisation de ces nouveaux biomarqueurs peut permettre de réaliser des études plus importantes et plus variées sur la MA et d’améliorer la compréhension de l’impact des médicaments sur la physiopathologie dans les essais cliniques.
Arrêter le MCI grâce à l’activité physique ?
L’exercice physique peut-il influencer le déclin cognitif chez les patients souffrant de troubles cognitifs légers (MCI) ? Les recherches actuelles suggèrent que l’exercice physique ne peut probablement pas arrêter la dégradation en tant que telle. Cependant, elle a une influence positive sur la cognition. Une étude a été menée auprès de 296 patients MCI [2]. Répartis en deux groupes, 148 patients ont chacun suivi un entraînement aérobie pendant 30 à 40 minutes quatre fois par semaine, tandis que les autres ont effectué des exercices d’étirement, d’équilibre et de mouvement pendant 30 à 40 minutes quatre fois par semaine. Des employés spécialement formés ont motivé les participants à faire du sport, ce qui leur a permis d’effectuer plus de 31 000 séances d’entraînement en 12 mois. En ce qui concerne le critère d’évaluation principal – les résultats sur l’ADAS-Cog-Exec, une version de l’ Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale développée pour cette étude – il n’y a pas eu d’aggravation par rapport au score initial dans les deux groupes, que ce soit à six ou à douze mois. Même après ajustement des covariables, il n’y avait pas de différence entre les groupes. Cependant, il n’y a pas eu non plus de détérioration des capacités cognitives entre la valeur initiale et le mois 12 dans les deux groupes. En revanche, un groupe témoin de participants ayant reçu le traitement habituel et suivis par l’Initiative de neuro-imagerie de la maladie d’Alzheimer a connu un déclin cognitif. Les différences entre les groupes d’étude et les groupes correspondants bénéficiant d’un suivi habituel étaient statistiquement significatives. Ces résultats suggèrent qu’un entraînement assisté régulier d’au moins 120 à 150 minutes (2 à 2,5 heures) par semaine, peut augmenter la résistance au déclin cognitif et aux déficiences cognitives légères.
Développement de nouveaux vaccins
Comme cela a été signalé, les dépôts de rosée sont une caractéristique pathologique essentielle de la MA et d’autres maladies neurodégénératives. La propagation des enchevêtrements de tau neurofibrillaires dans certaines régions du cerveau est associée au déclin cognitif dans la maladie d’Alzheimer. On pense que la tau extracellulaire phosphorylée (pTau) est impliquée dans la propagation de la tau dans le cerveau. L’immunothérapie a le potentiel d’interférer avec la propagation de la neuropathologie tau et de prévenir ou de réduire les troubles cognitifs. En particulier, la vaccination active qui cible les espèces pTau à l’origine de l’agrégation pathologique représente une stratégie attrayante pour le traitement à long terme et potentiellement pour la prévention de la maladie d’Alzheimer et d’autres tauopathies. L’étude clinique de phase 1b/2a, NCT04445831, vise à évaluer deux candidats vaccins anti-pTau de premier ordre, ACI-35.030 (c’est-à-dire à base de liposomes) et JACI-35.054 (c’est-à-dire à base de conjugués). Cette étude multicentrique, en double aveugle, randomisée et contrôlée par placebo, actuellement en cours, évalue l’innocuité, la tolérance et l’immunogénicité de différentes doses de deux des deux vaccins anti-pTau, ACI-35.030 et JACI-35.054, chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer précoce [3].
41 sujets ont été randomisés dans les 3 niveaux de dose de la cohorte 1 et 16 sujets dans les 2 niveaux de dose de la cohorte 2. Les deux vaccins ont été considérés comme sûrs et bien tolérés, car aucun problème de sécurité cliniquement pertinent lié aux vaccins de l’étude n’a été observé au moment de la soumission de l’abstract. Les sujets vaccinés avec le vaccin liposomal ACI-35.030 ont présenté une réponse anti-pTau et anti-ePHF IgG élevée, spécifique et soutenue, avec un effet dose-réponse évident entre la dose faible et la dose moyenne, avec des signes de changement de classe d’immunoglobulines d’IgM à IgG. Les taux de réponse individuels étaient élevés et cohérents, en particulier pour les anticorps anti-pTau et ePHF. Au fil du temps, les données montrent que la réponse IgG mûrit vers une plus grande préférence pour la liaison de l’ePHF, l’espèce la plus pathologique, alors que, dans le même temps, les titres d’anticorps contre la tau non pathologique et non phosphorylée diminuent. Les sujets immunisés avec le vaccin conjugué JACI-35.054 ont présenté une réponse élevée aux IgG anti-EPHF et anti-PTau sans effet de dose apparent entre la dose faible et la dose moyenne. La réaction IgG a montré une capacité de liaison soutenue, à la fois à la pTau et à la tau non pathologique et non phosphorylée. Pour l’ACI-35.030, la réponse IgG des sujets était relativement homogène et montrait une large couverture d’épitopes, car la liaison s’étendait à toutes les séquences pTau testées et, surtout, sans spécificité terminale ni liaison importante aux séquences non phosphorylées. Les sujets ont présenté une réponse plus hétérogène avec une liaison fortement disproportionnée aux anticorps terminaux.
L’étude clinique se déroule avec succès et montre que la vaccination avec ACI-35.030 ou JACI-35.054 est sûre et bien tolérée et qu’elle provoque des réponses IgG au peptide immunisant ainsi qu’à l’ePHF. Cependant, dans l’ensemble, l’ACI-35.030 s’avère être le meilleur candidat vaccin en termes de taux de réponse, de nombre de vaccinations pour atteindre le titre initial d’anticorps, d’homogénéité des anticorps et de maturation des anticorps contre les formes pathologiques de tau.
Le rôle des biomarqueurs dans le plasma
Le déclin cognitif subjectif (DCS) est connu pour être un risque de MA, mais les taux de déclin cognitif varient en fonction de la pathologie sous-jacente. Une étude d’observation longitudinale a donc été planifiée afin d’examiner les caractéristiques initiales et les biomarqueurs associés à l’évolution clinique chez les participants âgés atteints de SCD sur une période de 24 mois. L’étude visait à déterminer si les participants au SCD présentaient des trajectoires cognitives et de biomarqueurs différentes, en fonction des dépôts amyloïdes à l’état initial [4]. Les participants ont été divisés en deux groupes : SCD avec amylose et SCD sans amylose (SUVR global <1,391). Ensuite, les changements cognitifs et atrophiques ont été comparés entre les deux groupes pendant 24 mois.
107 participants ont terminé l’étude. Les participants qui ont terminé le suivi (n=107) ne différaient pas de ceux qui avaient abandonné l’étude (n=13) en termes de caractéristiques initiales, à l’exception de l’éducation. Les scores cognitifs initiaux ne différaient pas entre les groupes, à l’exception des scores SVLT pour le rappel différé. Au bout de 24 mois, les SVLT ont montré des retards de mémorisation, une partie des tests exécutifs frontaux et davantage de déclin cognitif chez les participants SCD Aβ-positifs. Le volume entorhinal gauche initial et les valeurs globales du SUVR étaient des facteurs pertinents en relation avec le déclin cognitif. En ce qui concerne les changements neurodégénératifs, les changements atrophiques hippocampiques et entorhinaux gauches étaient plus importants chez les participants SCD Aβ-positifs.
Congrès : Conférence sur les essais cliniques sur la maladie d’Alzheimer (CTAD)
Littérature :
- Bateman R: Relationship between blood plasma and CSF measures of Aβ 42/40, tau, and NfL species for tracking drug effects in clinical trials of Alzheimer’s disease. S1, CTAD 2022.
- Cotman C, Feldman H, Lacroix A, et al.: Topline results of exert: Can exercise protect against cognitive decline in MCI? OC-12, CTAD 2022.
- Streffer J, Mermoud J, Sol O, et al.: ACI-35.030 and JACI-35.064, two novel antiphospho-Tau vaccines fort he treatment of Alzheimer’s disease: Interim Phase 1B/2A data on safety, tolerability and immunogenicitye. OC1, CTAD 2022.
- Hong YJ, Yang DW, Ho S, et al.: Impacts of amyloid burden on longitudinal cognitive declines in subjective cognitive decline: a prospective cohort study. P90, CTAD 2022.
InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2023; 21(1): 20–21