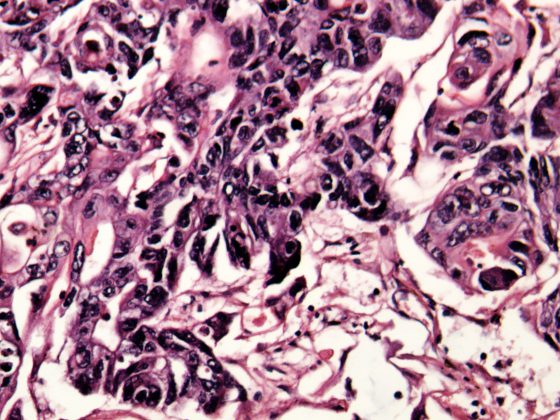La toxine botulique est principalement utilisée pour le traitement des dystonies focales et segmentaires. Pour que le traitement soit efficace, les muscles impliqués dans le schéma de mouvement dystonique doivent être correctement identifiés. Lors d’une injection intramusculaire, une technique de contrôle (sonographie et/ou électromyographie) permet de vérifier que l’aiguille d’injection a bien été placée dans le bon muscle. En cas de spasticité, l’utilisation de la toxine botulique permet de soulager la douleur et de rétablir le mouvement physiologique en réduisant l’activité musculaire pathologiquement élevée. L’utilisation de la toxine botulique peut prévenir les contractures, les mauvaises postures et les lésions articulaires.
La toxine botulique est une toxine bactérienne produite pendant la croissance et la reproduction de Clostridium botulinum. Cette bactérie se développe de préférence dans les conserves de saucisses mal conservées, d’où son nom (du latin botulus, la saucisse). J. Kerner a décrit pour la première fois le tableau clinique du botulisme en 1815, et en 1820, il a établi un lien entre les symptômes et le poison. Dès 1822, il a proposé d’utiliser le poison à faibles doses à des fins thérapeutiques [1]. Il a cependant fallu attendre les années 1940 pour que la substance soit produite sous forme pure, et ce n’est que dans les années 1970 que son utilisation thérapeutique a commencé, d’abord pour le blépharospasme, puis pour la dystonie cervicale [2–4].
Troubles du mouvement dystonique
Les troubles moteurs dystoniques sont classés en fonction de leurs caractéristiques cliniques (âge de début des symptômes, parties du corps touchées, chronologie d’apparition, coexistence d’autres troubles moteurs, apparition dans le cadre d’autres maladies neurologiques) et de leur étiologie (héréditaire, acquise, idiopathique, familiale).
La définition de la dystonie a été établie pour la dernière fois en 2013 : “La dystonie est un trouble du mouvement caractérisé par des contractions musculaires permanentes ou intermittentes qui entraînent des mouvements et/ou des postures anormaux, souvent répétitifs. Les mouvements dystoniques suivent typiquement un schéma, sont rotatifs et peuvent conduire à un mouvement de type tremblement. La dystonie est souvent déclenchée ou aggravée par des mouvements volontaires, les mouvements dyoniques sont associés à une activation disproportionnée des muscles nécessaires aux mouvements et de leurs groupes musculaires adjacents” [5]. La toxine botulique est principalement utilisée pour le traitement des dystonies focales et segmentaires.
Aperçu de la physiopathologie
Alors que jusque dans les années 1970, la dystonie était considérée comme une maladie psychiatrique, la découverte par Charles Marsden que des modifications structurelles dans les ganglions de la base pouvaient entraîner des mouvements dystoniques a révolutionné la compréhension de l’origine des mouvements dystoniques [6].
On sait désormais qu’une diminution de l’inhibition au niveau cortical, striatal et spinal favorise l’apparition de mouvements dystoniques, tout comme une plasticité corticale accrue et une hyperexcitabilité corticale. En outre, on décrit chez les patients atteints de dystonie une diminution de la discrimination temporaire et spatiale des stimuli sensibles et une altération des afférences du fuseau musculaire [7].
Effet de la toxine botulique
La toxine botulique se lie de manière spécifique et irréversible à la membrane cellulaire du neurone. La toxine est absorbée dans la cellule sous forme de vésicule, la protéine porteuse est clivée par protéolyse et la toxine active est libérée dans le cytosol. La toxine active clive SNAP-25, une protéine membranaire nécessaire à la sécrétion d’acétylcholine [8]. La diminution de la sécrétion d’acétylcholine entraîne une chémodénervation avec parésie flasque consécutive du muscle.
L’injection de toxine botulique réduit les afférences du fuseau musculaire du muscle concerné, ce qui entraîne une réorganisation corticale et une normalisation de la plasticité corticale [9]. Pour que le traitement des troubles dystoniques par la toxine botulique soit efficace, il faut identifier correctement les muscles impliqués dans le schéma de mouvement dystonique.
Blépharospasme
Le blépharospasme est la fermeture involontaire et répétée des deux yeux. Les blépharospasmes apparaissent souvent à un âge avancé, commencent par des clignements isolés ou une sensation de corps étranger et sont souvent aggravés par une lumière vive. Dans le cas du blépharospasme, l’identification des muscles dystoniques est simple, il s’agit d’un trouble dystonique du muscle orbiculaire de l’œil. Une petite dose de toxine botulique au départ, répartie sur 4 à 6 points d’injection périoculaires selon le schéma et augmentée progressivement, permet d’aider une grande partie des patients atteints de blépharospame.
Il s’agit rarement d’une variante du blépharospamus qui ne répond pas ou insuffisamment au schéma d’injection classique de la toxine botulique : le blépharospasme dit prétarsal. Dans ce cas, ce sont surtout les fibres du muscle orbicularis oculi proches du bord latéral qui sont impliquées dans le spasme. En injectant très près du bord de la paupière, les patients souffrant de cette forme de blépharospasme peuvent également tirer un bon bénéfice des injections de toxine botulique [10].
Cliniquement, le blépharospasme classique peut être distingué du blépharospasme prétarsal, le patient fermant et rouvrant les yeux de manière volontaire. Le retard dans l’ouverture volontaire des yeux ou la nécessité d’ouvrir les yeux fermés en s’aidant du muscle frontal ou de la main plaide en faveur d’une composante prétarsale [11].
Dans de rares cas, le blépharospamus peut être unilatéral. Le spasme hémifacial, également unilatéral, peut être distingué du blépharospame unilatéral par le signe dit de Babinski II (fermeture involontaire d’un œil accompagnée d’un soulèvement du sourcil ipsilatéral).
Dystonie cervicale
Avant de commencer un traitement à la toxine botulique, il convient de déterminer l’étiologie d’une dystonie cervicale. L’interrogatoire doit porter sur les antécédents familiaux, les antécédents médicamenteux (neuroleptiques ?), le début et l’évolution des symptômes, la dépendance au moment de la journée, les activités déclenchantes, etc. Pour différencier les dystonies idiopathiques des dystonies structurelles ou des troubles dystoniques liés à d’autres maladies, il est recommandé de procéder à un examen clinique détaillé, à un diagnostic de laboratoire avec recherche de troubles métaboliques (par ex. maladie de Wilson, ferritinopathies, troubles du métabolisme des acides aminés et des lipides) et à une représentation morphologique du cerveau par IRM.
Dans la dystonie cervicale, le groupe de muscles impliqués est variable et très différent d’un individu à l’autre. Il est donc important d’observer les schémas de mouvements dystoniques à la fois au repos (position assise détendue avec les yeux fermés, éventuellement sous distraction) et en mouvement (marche), et de préférence de les documenter par vidéo. Il s’agit de déterminer si d’autres parties du corps sont impliquées dans le schéma de mouvement dystonique et comment ce schéma se modifie en fonction du mouvement. La marche fait souvent ressortir des parties de la dystonie qui sont réprimées au repos, et surtout lorsque la tête est appuyée en position assise.
Le choix des muscles à traiter uniquement sur la base de l’inspection et de la palpation peut être trompeur, car les muscles compensateurs peuvent également être fortement hypertrophiés. La paralysie des muscles compensateurs peut aggraver le schéma de mouvement dystonique. Pour identifier les muscles les plus impliqués dans le schéma de mouvement pathologique, l’inspection et la palpation des muscles, une observation minutieuse des mouvements de la tête et du cou ainsi que du positionnement de la tête et du cou et une anamnèse précise concernant le début des symptômes sont utiles.
Avant de commencer un traitement à la toxine botulique, il est préférable de convenir d’un objectif avec le patient (ce qui est le plus gênant ? ce que l’on veut obtenir avec les injections ?) Il est important d’aborder ouvertement les souhaits du patient, les possibilités et les limites de la thérapie à la toxine botulique et d’aborder directement les éventuels effets secondaires au préalable (faiblesse musculaire, dysphagie, infections grippales) afin d’établir et de maintenir une relation de confiance avec le patient. Il n’est généralement pas possible d’obtenir une disparition totale des symptômes. Le soutien physiothérapeutique ciblé pour réapprendre des modèles de mouvements physiologiques et le renforcement ciblé des muscles de maintien et de soutien du cou et du tronc complètent positivement l’effet de la thérapie à la toxine botulique. Une collaboration étroite avec le kinésithérapeute peut améliorer considérablement le succès de la thérapie.
Technique d’injection
Pour l’injection périoculaire, une aiguille sous-cutanée ordinaire peut être utilisée. La piqûre à travers la peau doit être rapide car elle est douloureuse pour le patient, l’injection de la toxine doit être lente car elle peut entraîner une sensation de pression désagréable. En cas d’injection périoculaire, la direction de la piqûre doit toujours être choisie loin des yeux afin de minimiser le risque de blessure. Un bon éclairage permet de ne pas endommager les plus petits vaisseaux lors de l’injection et d’éviter ainsi un hématome monoculaire. Le refroidissement du contour des yeux avant l’injection réduit le risque d’hématome dû à la vasoconstriction provoquée par le froid et diminue la sensation de brûlure après l’injection chez les patients sensibles.
En cas d’injection intramusculaire, une technique de contrôle (sonographie et/ou électromyographie [EMG]) doit être utilisée pour vérifier que l’aiguille d’injection a bien été placée dans le bon muscle [12]. Pour dériver l’activité musculaire par EMG, il suffit d’attacher une pince crocodile reliée à un appareil EMG à l’aiguille d’injection. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients ; l’essentiel est que l’utilisateur soit familiarisé avec elle et puisse identifier rapidement et en toute sécurité les muscles à injecter.
Crise de l’écrivain et crise du musicien
La dystonie de fonction (crampe de l’écrivain/crampe du musicien) représente probablement le plus grand défi pour la thérapie par la toxine botulique. Dans ce cas, il est surtout nécessaire d’analyser précisément les muscles impliqués, c’est pourquoi il est recommandé d’observer attentivement les patients pendant l’activité correspondante et, de préférence, de les filmer. Dans le cas de la crampe de l’écrivain en particulier, écrire avec la main non dominante peut entraîner des mouvements dystoniques chez la main dominante, même si celle-ci n’est pas activement déplacée (mouvements en miroir) [13]. Ces mouvements de miroir sont souvent utiles pour le diagnostic. Pour les dystonies de fonction, le dosage doit être très faible, car un dosage trop élevé peut entraîner une limitation de la fonction de la main.
Dystonie des membres dans d’autres maladies neurologiques
Un autre domaine d’application de la toxine botulique est la dystonie des membres dans le cadre d’autres pathologies neurologiques, par exemple la dystonie du gros orteil dans la maladie de Parkinson. Celle-ci réagit souvent peu à la médication dopaminergique, mais peut provoquer des douleurs et des points de pression en raison du port de chaussures solides. Une injection de toxine botulique dans le muscle extensor hallucis longus apporte souvent un soulagement et permet aux patients de porter à nouveau des chaussures solides sans douleur. La stabilité de la marche peut également être favorablement influencée par le traitement de la dystonie du gros orteil.
Utilisation en cas de spasticité
La spasticité, telle qu’elle apparaît après une lésion de la voie pyramidale, par exemple après un accident vasculaire cérébral, dans le cadre d’une maladie inflammatoire du SNC comme la sclérose en plaques ou l’encéphalite, ou après une lésion cérébrale périnatale, entraîne une suractivation pathologique des muscles des membres. Au niveau des bras, les fléchisseurs sont généralement touchés, tandis qu’au niveau des membres inférieurs, la spasticité en extension et en supination est fréquente, avec une suractivation du muscle tibial postérieur et du muscle gastrocnémien. Dans ce cas, l’utilisation de la toxine botulique peut soulager la douleur et permettre à nouveau le mouvement physiologique en réduisant l’activité musculaire pathologiquement élevée. L’utilisation précoce de la toxine botulique peut prévenir les contractures, les mauvaises postures et les lésions articulaires.
Chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, l’utilisation précoce de la toxine botulique facilite l’apprentissage d’une motricité physiologique. Chez les patients victimes d’un AVC ou d’une sclérose en plaques, la réduction précoce (dès le début) de la spasticité par la toxine botulique favorise la récupération rapide de la fonction motrice physiologique. En Suisse, l’utilisation de la toxine botulique en cas de spasticité est limitée à la paralysie cérébrale et à la spasticité après un accident vasculaire cérébral, de sorte que pour les autres causes, une garantie de prise en charge des coûts doit être demandée à la caisse-maladie.
Malheureusement, la plupart des patients ne sont envoyés en thérapie par toxine botulique que des années après le début de la spasticité. Dans ce cas, les patients ont souvent déjà acquis des schémas de mouvements non physiologiques et des contractures sont parfois déjà apparues, avec des séquelles.
Pour les patients souffrant de spasticité, il est également recommandé d’établir un accord avec le patient. Pour cela, il est important de savoir ce qu’il est possible de faire actuellement avec le membre spastique et ce que la thérapie à la toxine botulique doit améliorer (soulager la douleur, faciliter les soins, améliorer la fonction). Dans le cas de la spasticité, une étroite collaboration avec les physiothérapeutes et les ergothérapeutes est également très utile et peut avoir une influence favorable sur le succès du traitement.
Littérature :
- Erbguth FJ, et al. : Historical aspects of botulinum toxin : Justinus Kerner (1786-1862) and the “sausage poison”. Neurology 1999 ; 53 : 1850.
- Scott AB, et al : Affaiblissement pharmacologique des muscles extraoculaires. Invest Ophthalmol 1973 ; 12(12) : 924-927.
- Scott AB, et al : Botulinum A toxin injection as a treatment for blepharospasm. Arch Ophthalmol 1985 ; 103(3) : 347-350.
- Tsui JK, et al : A pilot study on the use of botulinum toxin in spasmodic torticollis. Can J Neurol Sci 1985 ; 12(4) : 314-316.
- Albanese A, et al. : Phénoménologie et classification de la dystonie : une mise à jour du consensus. Mov Disord 2013 ; 28(7) : 863-873.
- Marsden CD : Dystonia : the spectrum of the disease. Res Publ Assoc Res Nerv Ment Dis 1976 ; 55 : 351-367.
- Grünewald RA, et al. : Dystonie focale idiopathique : un trouble du traitement des afférences du fuseau musculaire ? Brain 1997 ; 120 : 2179-2185.
- Williamson LC, et al : Clostridial neurotoxins and substrate proteolysis in intact neurons : botulinum neurotoxin C acts on synaptosomal-associated protein of 25 kDa. Biol Chem 1996 ; 271(13) : 7694-7699.
- Kojovic M, et al : Les injections de toxine botulique réduisent la plasticité associative chez les patients atteints de dystonie primaire. Mov Disord 2011 ; 26(7) : 1282-1289.
- Albanese A, et al : Pretarsal injections of botulinum toxin improve blepharospasm in previously unresponsive patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1996 ; 60(6) : 693-694.
- Oertel WH, et al. : Syndromes parkinsoniens et autres troubles du mouvement. Thieme-Verlag 2012, 241-242.
- Hong JS, et al. : Elimination de la dysphagie à l’aide d’un guidage échographique pour les injections de toxine botulique dans la dystonie cervicale. Muscle Nerve 2012 ; 46(4) : 535-539.
- Rana AQ, et al : Dystonie focale de la main droite avec mouvements en miroir lors de l’utilisation du bras gauche. J Coll Physicians Surg Pak 2013 ; 23(5) : 362-363.
InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2016 ; 14(5) : 29-32