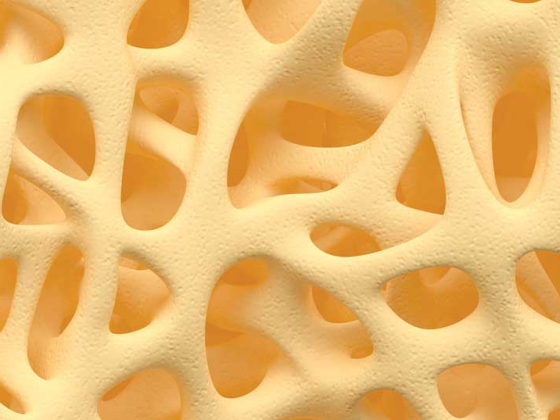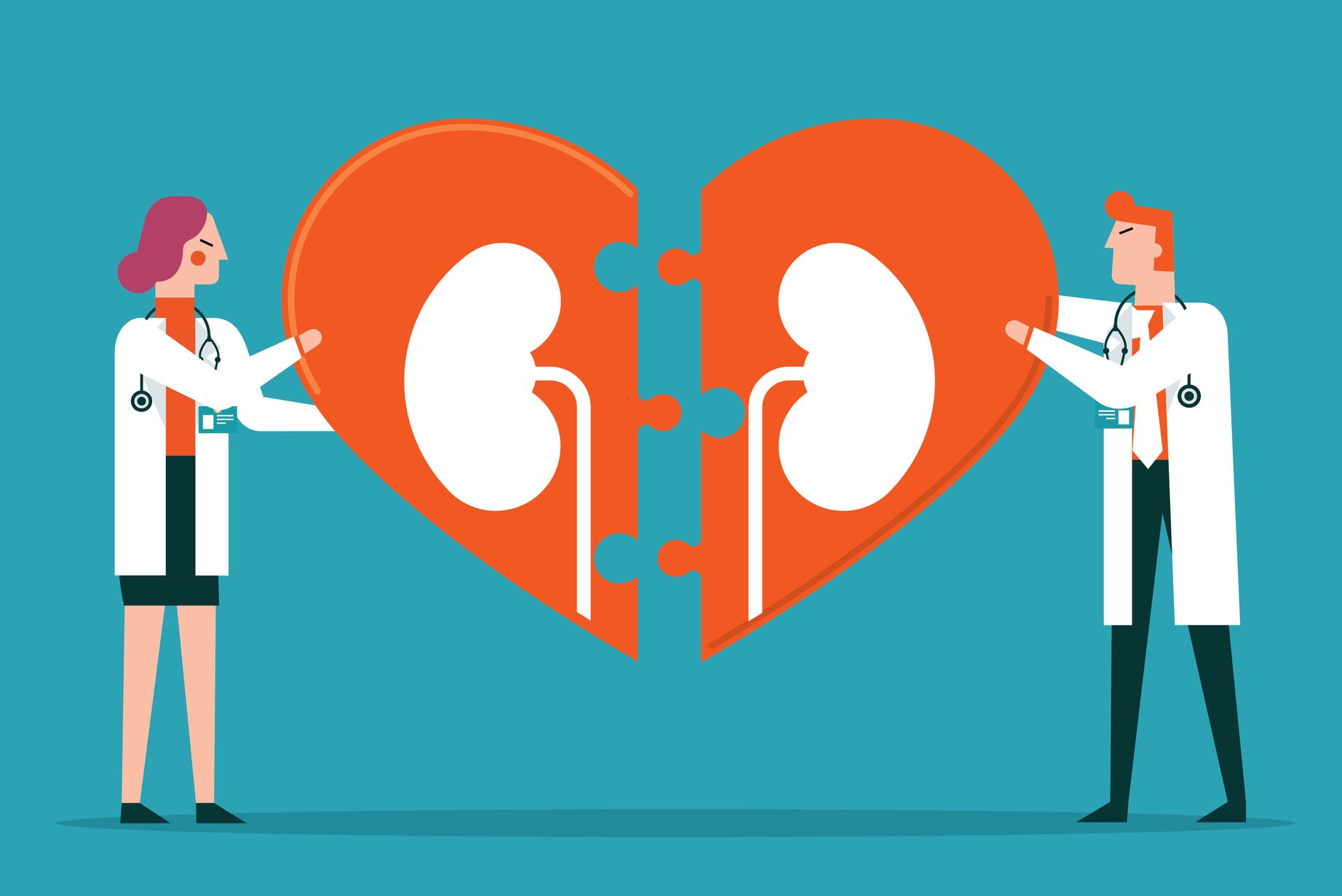Lors de la Journée des médecins de famille de Berne, le professeur Hansjakob Furrer, de la Clinique universitaire d’infectiologie de l’Hôpital de l’Île, a montré, à l’aide de trois exemples, quand une antibiothérapie empirique sans détection de l’agent pathogène est indiquée, dans quels cas des cultures devraient être prélevées et quand il vaut la peine d’attendre que l’agent pathogène soit connu.
(rs) Dans le premier cas, le thème était : attendre ou traiter empiriquement ? Le professeur Hansjakob Furrer, médecin-chef par intérim de la clinique universitaire d’infectiologie de l’Hôpital de l’Île à Berne, a répondu à cette question en présentant le cas d’une patiente de 23 ans qui s’est présentée chez son médecin généraliste à 22 semaines de grossesse avec des brûlures en urinant. Le bilan urinaire montre une couleur trouble et une légère leucocytose (250 leucocytes/μl), les nitrites sont positifs. Le diagnostic serait vite fait chez une femme qui n’est pas enceinte : La patiente souffre d’une infection urinaire non compliquée. “Cela permettrait de faire les deux : watchful waiting ou traitement empirique ex juvantibus (sans détection de l’agent pathogène)”, a déclaré le professeur Furrer lors de la Journée des médecins de famille de Berne. Comme il s’agit d’une infection urinaire compliquée en raison de la grossesse, un traitement est indiqué. Pour cela, il est important de connaître les agents pathogènes les plus courants, leur niveau de résistance et les antibiotiques correspondants. Le médecin généraliste opte pour un traitement empirique par amoxicilline/acide clavulanique, ce qui est correct en ce qui concerne la grossesse.
Cas 2 : germes multirésistants
Quatre jours plus tard, la femme est hospitalisée avec un état général réduit, de la fièvre et des frissons. Le laboratoire montre un déplacement vers la gauche. La sensation de brûlure lors de la miction persiste. “Nous voyons de plus en plus souvent de tels cas où le traitement antibiotique habituel ne fonctionne pas”, a expliqué le professeur Furrer, en se référant à l’aperçu local de la résistance publié chaque année sur le site Internet de l’Hôpital de l’Île. Celle-ci a montré pour l’année 2013 qu’environ 25% des infections causées par E. coli et environ 15% des infections causées par Klebsiella pneumoniae ne pouvaient pas être traitées par amoxicilline/acide clavulanique. “En cas de symptômes d’une infection grave ou d’un risque accru de développer une infection grave, il est essentiel de procéder à des cultures”, explique l’infectiologue. Dès que l’antibiogramme est disponible, l’antibiothérapie doit être adaptée de manière ciblée à l’agent pathogène.
Dans le cas de la jeune femme, il s’agissait d’une urosepsie due à des bactéries intestinales multirésistantes ESBL (“Extended Spectrum Beta-Lactamase”). Dans les cas les plus fréquents, il s’agit de bactéries à Gram négatif comme E. coli et Klebsielles, qui sont résistantes aux antibiotiques β-lactamines comme les pénicillines et les céphalosporines. En Suisse, moins de 5% de la population est actuellement porteuse de bactéries intestinales ESBL multirésistantes. Après un voyage en Asie du Sud, cette proportion peut atteindre environ 90%, comme l’ont montré des données non publiées. “Tant que les personnes concernées n’ont pas besoin d’antibiotiques, ce n’est pas un problème”, a déclaré l’infectiologue. La situation devient dangereuse lorsque les personnes concernées reçoivent un antibiotique β-lactame de premier choix, car les germes multirésistants prennent alors le dessus dans l’intestin. Si celles-ci entraînent ensuite une infection invasive, il existe un risque de septicémie avec des agents pathogènes difficiles à traiter.
Le cas de la jeune femme n’a pas été trop grave. L’antibiothérapie ciblée avec un carbapénème a permis de traiter l’urosepsis avec succès.
Cas 3 : Toxoplasmose cérébrale
Parmi les cas pour lesquels un traitement antibiotique empirique ne devrait pas être initié, l’homme de 50 ans présenté ensuite, porteur d’une valve mitrale artificielle, souffrait depuis plusieurs jours d’une augmentation des troubles de l’élocution et de l’équilibre ainsi que d’une paralysie partielle du fascia.
Sur la base d’une IRM de contraste, on soupçonne fortement un abcès cérébral. Comme le risque d’aggravation aiguë est faible, les infectiologues recommandent d’attendre que l’agent pathogène soit connu ou que du matériel de diagnostic sûr ait été prélevé avant de commencer le traitement antibiotique. Une biopsie du foyer suspect réalisée par la suite donne un résultat surprenant : la personne concernée souffre d’une toxoplasmose cérébrale. Le professeur Furrer a utilisé cette étude de cas pour souligner que plus de 52% des personnes atteintes du VIH en Suisse sont ce que l’on appelle des “late presenters”, c’est-à-dire qu’elles souffrent déjà d’une infection opportuniste définissant le SIDA au moment du diagnostic. Et ce, bien qu’une étude ait montré qu’environ 75% des personnes atteintes présentaient des symptômes évocateurs de la maladie au cours de l’année précédant le diagnostic et que la même proportion consultait un médecin au moins une fois par an. “Si elles sont diagnostiquées à temps, les personnes infectées par le VIH ont aujourd’hui une espérance de vie presque normale”, a déclaré le professeur Furrer. De plus, de nombreuses contaminations pourraient être évitées, car les personnes infectées par le VIH traitées avec succès par des antirétroviraux ne transmettent presque plus l’infection par le VIH.
Source : Journée bernoise des médecins de famille, 13 mars 2014, Berne
PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2014 ; 9(6) : 44-45