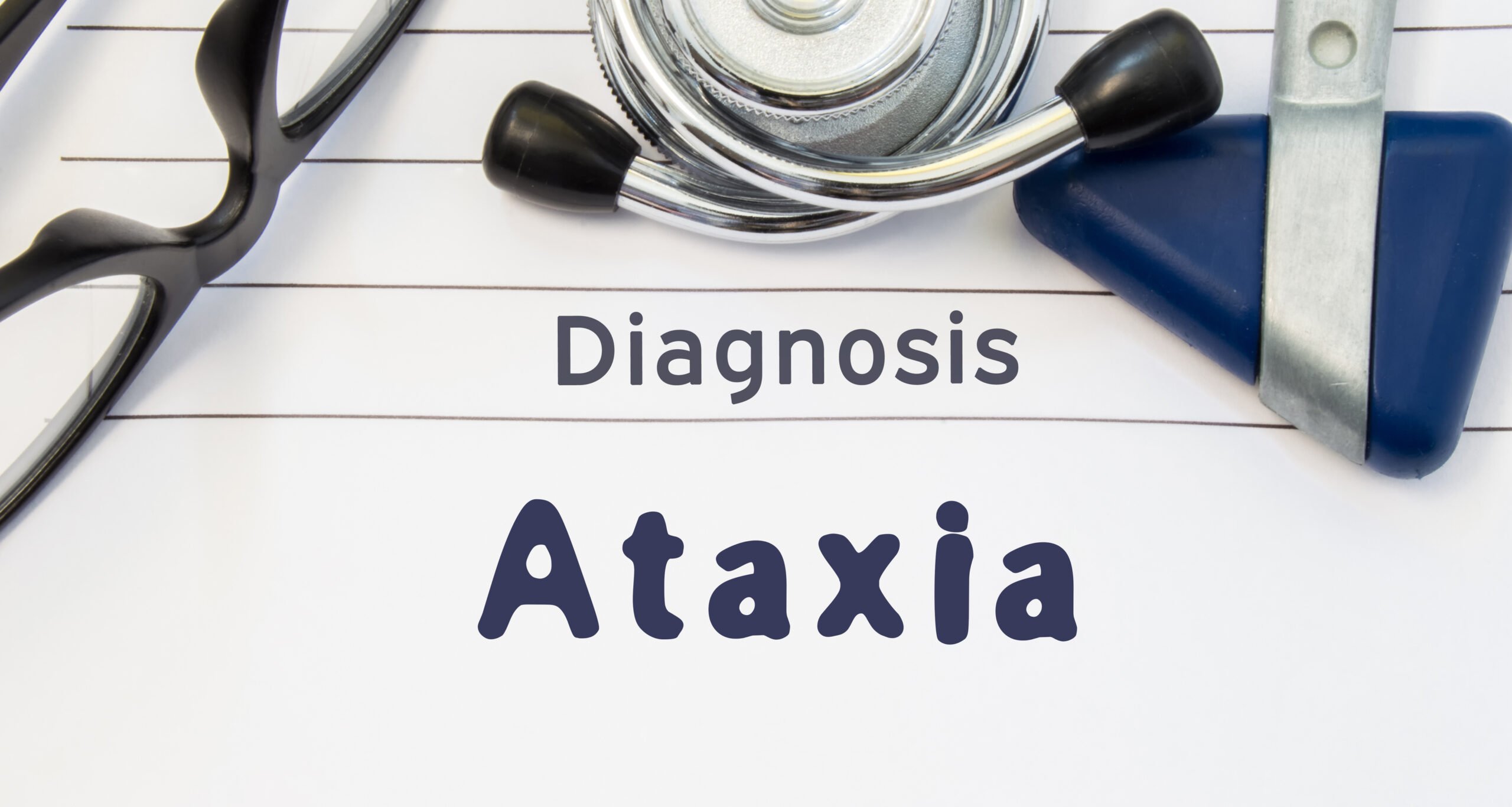Le congrès ECTRIMS s’est tenu cette année à Barcelone. Des aperçus de la recherche et des données récentes ont été présentés, notamment une étude de phase III qui a évalué l’effet d’un antibiotique après un premier événement isolé, plusieurs études consacrées au risque de suicide chez les personnes atteintes de SEP et un travail de moindre envergure qui a démontré que la supplémentation des patients atteints de SEP ayant des taux de vitamine D trop bas a un effet positif sur certains tests cognitifs.
Il n’est pas rare que la sclérose en plaques (SEP) soit précédée cliniquement d’un premier événement démyélinisant (ECD). Un traitement doit être envisagé chez les patients présentant un CIS et des lésions typiques de la SEP à l’IRM, car ces patients développent souvent une SEP cliniquement manifeste. Les médicaments actuellement autorisés dans cette indication sont d’autant plus efficaces qu’ils sont utilisés tôt. Néanmoins, en raison de considérations de sécurité et de coûts, le traitement est souvent retardé jusqu’à ce que les patients subissent un deuxième épisode.
Une étude multicentrique randomisée menée au Canada sur 142 patients ayant connu un premier CIS au cours des 180 derniers jours et présentant au moins deux lésions hyperintenses T2 à l’IRM a maintenant testé une substance bien connue, peu coûteuse et bien éprouvée dans une autre indication : Minocycline. Cette tétracycline orale est actuellement indiquée dans l’acné vulgaire. Des études précliniques avaient déjà montré qu’il pourrait constituer une option possible dans la SEP, tant en monothérapie qu’en traitement complémentaire.
Les participants à l’étude de phase III étaient âgés de 18 à 60 ans (âge moyen : 35,8 ans). 68,3% étaient des femmes. Le score médian sur l’échelle EDSS (Expanded Disability Status Scale) était de 1,5 et 69% avaient >8 lésions T2. Les patients ont été randomisés pour recevoir soit la minocycline par voie orale 100 mg deux fois par jour, soit un placebo. Ce traitement a été poursuivi jusqu’à 24 mois ou jusqu’à ce que le diagnostic de SEP soit confirmé (critères McDonald 2005). Les scanners IRM ont été interprétés par la même personne en aveugle à chaque fois. Le critère d’évaluation principal était le nombre de patients atteints de SEP après six mois.
Risque réduit de près de moitié
Sur la base des critères de McDonald, le risque de développer une SEP clinique dans les six mois était de 61,4% dans le groupe placebo et de 34% dans le groupe minocycline. La réduction absolue du risque était donc de 27,4% et la réduction relative de 44,6% (p=0,001). Le nombre de patients à traiter (NNT) était de 4. Les données à un an étaient les suivantes :
- Réduction absolue du risque avec la minocycline : 25,1
- Réduction relative du risque avec la minocycline : 37,6%.
- NNT : 4 (p=0,002).
18 (minocycline) vs. 6 (placebo) personnes avaient interrompu le traitement pendant toute la période de 24 mois. Le profil d’innocuité était bon et conforme aux attentes d’un traitement antibiotique.
Selon les auteurs, les résultats peuvent être comparés à l’efficacité des médicaments autorisés pour le traitement de la SEP. Compte tenu de ces données, de son faible coût, de sa facilité d’utilisation (par exemple par rapport aux injections) et de son profil de sécurité bien étudié, cet antibiotique peut être envisagé comme traitement initial. Il pourrait faciliter l’initiation précoce du traitement et donc augmenter le succès du traitement dans de nombreux cas. Cette découverte présente également un potentiel pour les pays où l’accès aux traitements actuels de la SEP est difficile ou impossible. Un monitoring de sécurité n’est pas nécessaire sous minocycline. Il est également utile de poursuivre l’étude de la minocycline en combinaison avec d’autres substances.
Limitations possibles
L’onset de l’événement était significativement plus fréquent dans le groupe placebo au niveau de la moelle épinière, ce qui, selon les chercheurs, est un prédicteur d’une transition précoce vers la SEP. En outre, davantage de patients du groupe placebo présentaient des lésions ≥2 enrichies en gadolinium. Ces deux facteurs ont pu influencer les résultats en faveur de la substance étudiée. Cependant, une analyse de régression incluant les deux paramètres susmentionnés a toujours montré un avantage significatif pour la minocycline. D’autres variables ont été étudiées, notamment l’âge, le sexe et l’ethnie. Ils n’ont pas montré d’interaction avec l’outcome.
Les suppléments de vitamine D améliorent-ils la cognition ?
Outre les facteurs de risque génétiques, les paramètres environnementaux jouent un rôle clé dans la SEP, comme en témoigne notamment la répartition différente de la maladie selon la latitude : Plus on se rapproche de l’équateur, plus le risque de SEP diminue. Ceci s’explique en partie par le métabolisme de la vitamine D. Plusieurs études récentes ont également établi une corrélation entre de faibles niveaux de 25(OH)D et un dysfonctionnement cognitif chez les adultes. On sait que des récepteurs de vitamine D sont présents dans le cerveau des animaux et des humains. On peut donc supposer une fonction cognitive.
Dans une étude présentée au congrès, des patients adultes atteints de SEP récurrente-rémittente sous traitement à l’interféron-β et présentant des taux de vitamine D trop bas ont reçu des suppléments de vitamine D pendant trois mois. La performance cognitive a été mesurée au moment de la ligne de base et après la supplémentation. La méthode utilisée était le Montreal Cognitive Assessment (MoCA), le test de Stroop, le Symbol Digit Modalities Test (SDMT) ainsi que le Brief Visual Memory Test delayed recall (BVMT-DR) et immediate. Ensemble, les tests ont duré environ 45 minutes.
41 des participants recrutés avaient des taux sériques de 25(OH)D trop bas au moment de la ligne de base, 48 avaient des taux normaux. Ceux dont les taux étaient trop bas ont reçu une supplémentation, les autres ont bénéficié du suivi médical habituel. L’exposition au soleil de tous les patients a été relevée via un journal.
La durée de la maladie au sein des deux groupes n’était pas différente, mais ceux qui avaient des scores trop bas avaient un score EDSS moyen plus élevé (1,6 vs 1,1 ; p=0,04). En outre, ils faisaient moins d’exercice (ce qui est peut-être lié à l’augmentation du score EDSS), mais buvaient et fumaient davantage. Le niveau moyen d’éducation était élevé dans les deux groupes. Vers les résultats :
- Les patients présentant les taux les plus bas de vitamine D ont obtenu, au moment de la ligne de base, des résultats moins bons que le groupe présentant des taux normaux pour tous les tests mentionnés. L’exception était le test de Stroop. La différence était significative dans le SDMT et le BVMT-DR.
- Après trois mois de supplémentation, le groupe présentant les taux les plus bas de vitamine D a montré une amélioration de la BVMT immédiate (10 et 30 secondes), de la BVMT à rappel différé (20 minutes) et de la MoCA. Comme prévu, le taux de vitamine D avait augmenté de manière significative grâce à la supplémentation.
- Les niveaux sériques de 25(OH)D étaient positivement et significativement corrélés avec le DR de la BVMT (les paramètres importants tels que le niveau d’éducation, l’activité physique, la durée de la maladie, l’EDSS, la dépressivité, l’âge, etc. ont été contrôlés dans l’analyse).
Les chercheurs concluent que la cognition dans la SEP est influencée par de faibles niveaux de vitamine D et peut être améliorée par une supplémentation. Chez les patients atteints de SEP, la vitamine D devrait donc être mesurée et, si elle est trop basse, substituée, conclut-il. Autre enseignement de l’étude : c’est précisément chez les patients atteints de SEP et présentant un faible taux de 25(OH)D qu’il est intéressant de pratiquer une activité sportive. Une corrélation particulièrement forte entre l’exercice physique et la performance cognitive a été observée dans ce groupe.
Patients atteints de SEP – le risque de suicide est élevé
Il est bien connu que les patients atteints de SEP ont un risque accru de suicide. Ce qui n’est pas tout de suite bien étudié, ce sont les tentatives de suicide dans ce collectif. Alors que les données canadiennes ont montré une augmentation significative du risque d’un facteur 3, les chercheurs danois n’ont pas trouvé d’augmentation significative de la probabilité de tentative de suicide chez les personnes atteintes de SEP (ce qui pourrait toutefois être dû au fait que l’étude de 404 patients était sous-évaluée).
Une nouvelle étude, présentée lors du congrès ECTRIMS, a de nouveau montré des valeurs nettement plus élevées. A partir d’un registre suédois, 29 617 patients atteints de SEP ont été identifiés et comparés à 296 164 personnes appariées sans SEP issues de la population générale. Ils ont également cherché à savoir si un niveau d’éducation plus élevé, normalement associé à un risque plus faible de suicide effectif, jouait également un rôle chez les patients atteints de SEP.
- Le risque de tentatives de suicide était multiplié par 2,18 (1,97-2,43) pour les patients atteints de SEP.
- La SEP a également multiplié le risque de suicide par 1,87 (1,53-2,30).
- Si l’on exclut de l’étude les patients qui avaient déjà fait des tentatives de suicide avant le diagnostic de SEP, les résultats n’ont pas changé dans leur déclaration.
- Tant dans le groupe témoin que dans le groupe SEP, les hommes avaient un risque plus élevé de suicide accompli et les femmes de tentative de suicide (augmentation de 30 % par rapport aux hommes).
- Un niveau d’éducation plus élevé (14 ans ou plus) a réduit la probabilité de tentative de suicide dans les deux groupes.
- Un niveau d’éducation plus élevé a montré une association inverse avec le suicide dans la cohorte non-MS (HR 0,68, [0,51–0,91]). Il est intéressant de noter que cette relation était inversée chez les patients atteints de SEP : un niveau d’éducation plus élevé augmentait même légèrement le risque de suicide effectif (HR 1,10, [0,60–2,04]). L’effet “protecteur” du statut éducatif est donc apparemment perdu dans la SEP.
Une autre étude a été consacrée au risque de dommages auto-infligés chez les patients atteints de SEP. Celui-ci semble également être nettement plus élevé : Par rapport au groupe de comparaison, la cohorte SEP a montré un risque 59% plus élevé de dommages que les patients s’infligent à eux-mêmes. Les chercheurs ont obtenu ces résultats à partir des données d’hospitalisation de toute l’Angleterre (1999-2011). Le risque était plus élevé chez les hommes que chez les femmes (RR 1,94 vs 1,48). Les jeunes patients de moins de 45 ans atteints de SEP étaient également moins susceptibles de s’infliger des dommages. Or, il est intéressant de noter que les données de l’autre étude avaient montré que le risque de suicide était nettement plus élevé chez les jeunes patients atteints de SEP que chez les plus âgés.
Dans l’ensemble, les auteurs recommandent de dépister les troubles psychiatriques chez les personnes atteintes de SEP dans la pratique clinique. D’autant plus que ni les suicides ni les tentatives de suicide n’ont diminué ces dernières années. En plus de la dépression, qui est probablement le médiateur le plus important en matière de prévention du suicide, il faut également tenir compte de l’augmentation des comportements addictifs ou de la diminution du contrôle des impulsions, par exemple. En outre, il convient de faire une distinction claire entre les patients qui tentent de se suicider et ceux qui le font. Il s’agit de deux groupes différents. C’est ce que montrent non seulement les différences d’influence de l’éducation, mais aussi la différence entre les sexes, les différentes méthodes de suicide utilisées dans les deux groupes et les différences dans les pathologies psychiatriques. Des études montrent que les personnes qui tentent de se suicider souffrent souvent d’autres troubles psychiatriques, comme le trouble de la personnalité borderline, au lieu de la dépression.
Source : ECTRIMS, 7-10 octobre 2015, Barcelone
InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2015 ; 13(6) : 40-43