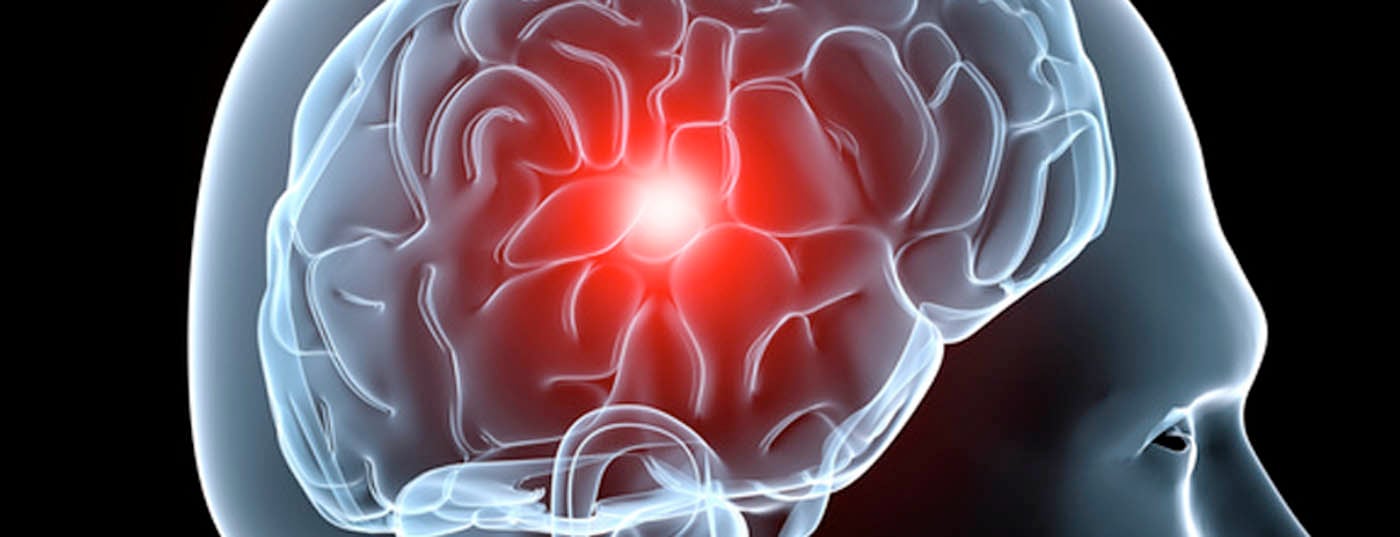Un accident vasculaire cérébral (AVC) est une perte souvent persistante des fonctions du système nerveux central due à une diminution critique de l’apport sanguin. Des millions de personnes dans le monde sont victimes chaque année d’un tel accident cérébral, et des milliers d’autres en meurent ou souffrent d’un handicap permanent. Une maladie rare mais importante à identifier est la maladie de Moyamoya (syn. syndrome de Moyamoya, angiopathie de Moyamoya). Elle entraîne souvent des attaques cérébrales et des hémorragies cérébrales récurrentes chez les enfants, les adolescents et les adultes.
L’angiopathie de Moyamoya, également appelée “occlusion spontanée du cercle de Willisi”, a été décrite pour la première fois en 1957 par Takeuchi et Shimizu [1]. La principale caractéristique de la maladie est un rétrécissement bilatéral et lentement progressif, voire une occlusion des grandes artères de la circulation cérébrale antérieure proches de la base du crâne, à commencer par l’artère carotide interne terminale. En réponse à l’état de sous-perfusion permanente qui en résulte, un réseau vasculaire anormal de collatérales se développe principalement dans et autour des ganglions de la base. En angiographie par soustraction numérique (DSA), ce réseau vasculaire fragile ressemble à un “nuage de fumée dérivant dans l’air”, “moyamoya” en japonais [2].
L’angiopathie de Moyamoya a longtemps été considérée comme une maladie limitée au Japon et à l’Asie de l’Est. En Amérique du Nord et en Europe, elle n’a été reconnue qu’à partir de la fin des années 1960 [3] et fait l’objet d’un suivi épidémiologique depuis les années 1990 [4,5]. L’incidence est d’environ 0,3/100 000 au Japon [6] et d’environ 0,09/100 000 aux États-Unis. En Europe, près de deux cents cas ont été enregistrés dans le cadre de la dernière enquête systématique, avec une prévalence nettement plus élevée chez les enfants et les jeunes adultes (pic de fréquence entre zéro et neuf ans ; deuxième pic entre 20 et 30 ans) [6]. Aux États-Unis et en Europe, environ 50 à 70% des patients atteints de la maladie de Moyamoya sont caucasiens. Alors que chez les enfants, la répartition par sexe est de 1 pour 1, chez les adultes, les deux tiers sont des femmes. La grande majorité des cas de Moyamoya sont sporadiques, et seul un cas sur dix environ est probablement d’origine familiale [7].
Pathologie
L’étiologie exacte et les voies biologiques impliquées ne sont pas totalement élucidées, même si une composante génétique est suspectée. Histologiquement, on observe des modifications de la paroi vasculaire avec un épaississement (hypertrophie) fibrocellulaire concentrique typique de l’intima, un dédoublement de la lamina elastica interna et un amincissement (atrophie) de la média. L’absence d’infiltrats inflammatoires, typiquement constatés dans les maladies de la paroi artérielle (par exemple l’artériosclérose ou l’arthrite), est également caractéristique.
Symptômes
Les patients adultes atteints de la maladie de Moyamoya subissent des épisodes ischémiques récurrents (AIT et AVC) dans 60% des cas et une hémorragie cérébrale dans 15-20% des cas, typiquement au niveau des ganglions du tronc. Des maux de tête chroniques réfractaires peuvent également être présents dans 70% des cas. Elle se caractérise par des ischémies récurrentes souvent inexpliquées au départ. Chez les enfants et les adolescents, l’hémorragie cérébrale est extrêmement rare, les ischémies cérébrales transitoires répétées avec déficit sensorimoteur prédominent. Au cours de l’évolution naturelle, on estime que plus de 60 à 70% des patients subiront un accident vasculaire cérébral dans les cinq ans. Compte tenu de ce taux élevé de morbidité chez les patients non traités, le traitement diagnostique le plus précoce possible suivi d’une intervention préventive visant à rétablir une hémodynamique cérébrale équilibrée est devenu la norme de traitement – du moins dans le monde occidental [8,9].
Diagnostic
Le diagnostic d’une angiopathie de Moyamoya est basé sur les directives modifiées de Fukui [10,11]. Dans tous les cas, la préparation préopératoire commence par une anamnèse détaillée et un examen neurologique approfondi. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) et l’angiographie par résonance magnétique (ARM) permettent souvent déjà de poser un diagnostic de suspicion. Les signes typiques sont des ischémies multiples d’âges différents. L’ARM démontre la sténose ou l’occlusion de l’artère carotide interne proche de la base du crâne ainsi que la néovascularisation pathologique au niveau des ganglions de la base. Pour un examen plus approfondi, une DSA 6 vaisseaux [2,12] est réalisée pour évaluer la situation vasculaire et une tomographie par émission de positons (TEP) ou un scanner au xénon (TDM au xénon) pour déterminer la capacité de réserve hémodynamique.
Traitement
Le but du traitement est de rétablir un apport sanguin suffisant au cerveau (revascularisation) [13,14]. Les techniques chirurgicales établies sont généralement divisées en pontages “directs” et “indirects”. Le pontage direct consiste à anastomoser (pontage EC-IC) une artère terminale de la carotide externe (par exemple l’artère temporale superficielle) sur une artère réceptrice intracrânienne (par exemple l’artère cérébrale moyenne) selon une technique microchirurgicale (Fig. 1) [9,15]. La revascularisation indirecte consiste à transposer l’artère scalp avec le muscle temporal (encéphalomyoarteriosynangiose) ou sans le muscle temporal (encéphalartériosynangiose) à la surface du cerveau de l’hémisphère cérébral le moins irrigué [16,17]. Toutes les techniques dites de dérivation indirecte stimulent la formation d’un nouveau réseau vasculaire à la surface corticale et devraient ainsi contribuer à une certaine supplémentation de l’apport sanguin cérébral. Comme la maladie est typiquement bilatérale, ce traitement doit également être effectué de manière bilatérale, généralement en deux opérations. Le risque de complication neurologique lors de cette intervention entre des mains expertes est de 1 à 2 % [8]. Les techniques endovasculaires avec angioplastie par ballonnet et stent n’ont pas donné de résultats dans la maladie de Moyamoya.
Résultats du traitement
Il est essentiel que la modalité et le moment du traitement soient déterminés en étroite collaboration avec une équipe interdisciplinaire d’experts. Le domaine de la chirurgie de pontage fait partie de la médecine hautement spécialisée (MHS). Une telle équipe est composée d’un neurochirurgien spécialisé – un neurochirurgien pédiatrique pour les enfants -, d’un neurologue et d’un neuroradiologue expérimenté. Compte tenu de la complexité des procédures chirurgicales, cette intervention doit être réalisée exclusivement par une équipe ayant une expérience confirmée en neurochirurgie cérébrovasculaire et dans les techniques de pontage. Selon notre expérience et celle d’autres centres internationaux, on peut s’attendre à de très bons, voire d’excellents résultats dans une majorité de cas, c’est-à-dire à une réduction significative du risque d’AVC (fig. 2) [8,18].

Littérature :
- Takeuchi K, Shimizu K : Hypoplasie des artères carotides internes bilatérales. Brain & Nerve 1957 ; 9 : 37-43.
- Suzuki J, Takaku A : Maladie cérébrovasculaire “moyamoya”. Maladie montrant des vaisseaux réticulaires anormaux à la base du cerveau. Arch Neurol Mar 1969 ; 20(3) : 288-299.
- Picard L, Lévesque M, Crouzet G : Le syndrome “moyamoya”. J Neuroradiol 1974 ; 1 : 47-54.
- Yonekawa Y, et al : Moyamoya disease in Europe, past and present status. Clin Neurol Neurosurg Oct 1997 ; 99(Suppl 2) : 58-60.
- Yonekawa Y, Taub E : Maladie de Moyamoya. Statut 1998. Neurologist 1999 ; 5 : 13-23.
- Suzuki J : Maladie de Moyamoya. Berlin : Springer 1983.
- Fukui M : Etat actuel de l’étude sur la maladie de moyamoya au Japon. Surgical Neurology Feb 1997 ; 47(2) : 138-143.
- Guzman R, et al : Clinical outcome after 450 revascularization procedures for moyamoya disease. Article clinique. Journal of Neurosurgery Nov 2009 ; 111(5) : 927-935.
- Guzman R, Steinberg GK : Techniques de pontage direct pour le traitement de la maladie de moyamoya pédiatrique. Neurosurgery Clinics of North America juillet 2010 ; 21(3) : 565-573.
- Fukui M : Directives de diagnostic pour l’occlusion spontanée du cercle de Willis (maladie de moyamoya). Rapport annuel 1995. The Research Committee on Spontaneous Occlusion of the Circle of Willis (Moyamoya Disease) of the Health and Welfare. Tokyo 1995 : 162-163.
- Fukui M : Lignes directrices pour le diagnostic et le traitement de l’occlusion spontanée du cercle de Willis (maladie de moyamoya). Comité de recherche sur l’occlusion spontanée du cercle de Willis (maladie de Moyamoya) du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Japon. Clin Neurol Neurosurg 1997 ; 99(Suppl 2) : 238-240.
- Mugikura S, et al. : Implication prédominante des circulations antérieures et postérieures ipsilatérales dans la maladie de moyamoya. Stroke Jun 2002 ; 33(6) : 1497-1500.
- Lee M, et al : Analyse du flux sanguin peropératoire des procédures de revascularisation directe chez les patients atteints de la maladie de moyamoya. Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism Jan 2011 ; 31(1) : 262-274.
- Lee M, et al : Quantitative hemodynamic studies in moyamoya disease : a review. Neurosurgical focus Apr 2009 ; 26(4) : E5.
- Donaghy RM, Yasargil MG (éd.) : Micro-Vascular Surgery. Stuttgart : Thieme 1967.
- Matsushima T, et al. : Une méthode de revascularisation indirecte dans le traitement chirurgical de la maladie de moyamoya – différents types de procédures indirectes et une procédure indirecte combinée multiple. Neurol Med Chir (Tokyo) 1998 ; 38 Suppl : 297-302.
- Matsushima Y, et al : Un nouveau traitement chirurgical de la maladie de moyamoya chez l’enfant : un rapport préliminaire. Surgical neurology Apr 1981 ; 15(4) : 313-320.
- Veeravagu A, et al : Moyamoya disease in pediatric patients : outcomes of neurosurgical interventions. Neurosurgical focus 2008 ; 24(2) : E16.
- Hallemeier CL, et al : Caractéristiques cliniques et résultats chez les adultes nord-américains atteints du phénomène de moyamoya. Accident vasculaire cérébral 2006 Jun ; 37(6) : 1490-1496.
PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2015 ; 10(10) : 8-9