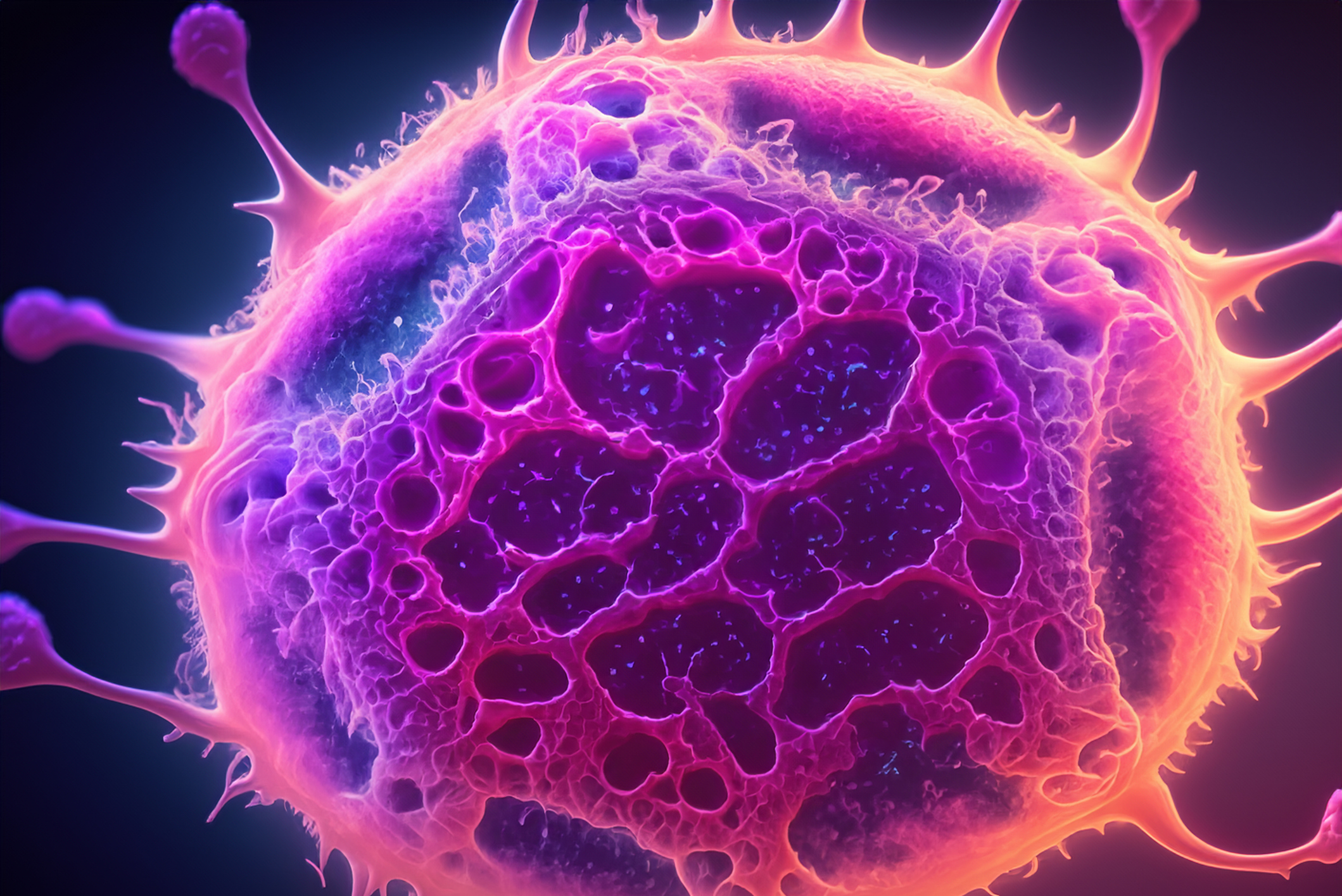Les infections sont des complications fréquentes du traitement systémique chez les patients hématologiques et oncologiques. Cependant, il existe peu de définitions communes et peu d’informations sur la manière de les traiter efficacement.
Le thème des infections a été plutôt négligé en oncologie par le passé. Ils sont associés à une morbidité élevée, ont un impact significatif sur la qualité de vie et peuvent entraîner une mortalité importante. Les infections à herpès-zoster, par exemple, se produisent dans environ 20% des cas de leucémie lymphoïde aiguë. Après une transplantation de cellules souches allogéniques, jusqu’à 80% des patients sont concernés. C’est pourquoi tous les patients doivent être dépistés pour l’hépatite B avant la chimiothérapie, afin qu’une prophylaxie antivirale puisse être administrée si nécessaire. Si cela n’est pas possible ou n’a pas été fait, un suivi doit être effectué au plus tard tous les deux mois. L’hépatite C doit surtout être détectée en cas de maladie lymphatique. Mais un dépistage doit également être effectué en présence de certains facteurs de risque, tels qu’une activité aminotransférase élevée, une hémodialyse, ou chez les receveurs de greffes.
Contrecarrer à temps les infiltrations pulmonaires
La pneumonie est définie comme une infection microbienne du parenchyme pulmonaire. La radiographie du thorax peut montrer des infiltrats nouveaux ou croissants et la personne présente également quelques signes cliniques supplémentaires tels que de la fièvre ou une dyspnée. L’étiologie microbienne reste souvent inexpliquée. Les bactéries multirésistantes, les champignons filamenteux et les virus peuvent tous être responsables d’une infection. Chez 25% des patients atteints de neutropénie fébrile, les infiltrats pulmonaires sont responsables de la mortalité. Il convient donc d’administrer en premier lieu un antifongique actif sur les moisissures, en plus d’un antibiotique à large spectre. Le diagnostic se fait par tomodensitométrie en raison de sa plus grande sensibilité. Une radiographie conventionnelle du thorax n’est pas recommandée, en particulier en cas de signes d’infection des voies respiratoires inférieures. Dans le cas d’une densification, d’une cour, d’un croissant aérien, d’une cour inversée ou d’un arbre en bourgeon, on peut toujours supposer une infection par un champignon filamenteux. En revanche, en présence d’infiltrats périhilaires bilatéraux diffus, d’opacités irrégulières du verre de lait, de kystes et de nodules centrolobulaires, il s’agit d’une infection à Pneumocystis jirovecii.
Source : Congrès annuel des sociétés savantes germanophones d’hématologie et d’oncologie médicale (DGHO) 2019
InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE 2019 ; 7(6) : 24 (publié le 7.12.19, ahead of print)