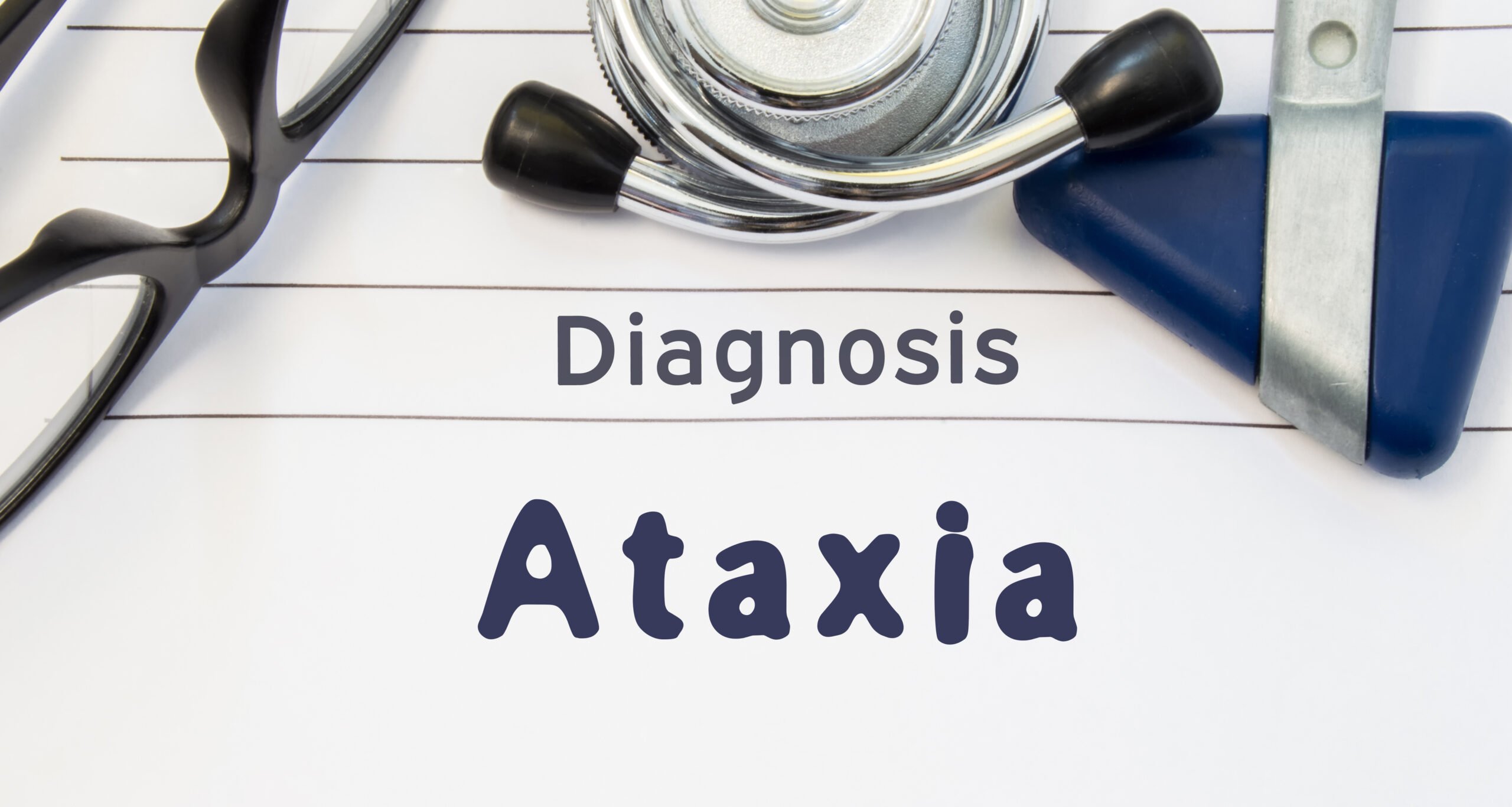Jusqu’à la ménopause, les hormones féminines réduisent le risque cardiovasculaire. Mais le manque de conscience chez les femmes du fait qu’elles peuvent également développer une maladie coronarienne est dangereux.
Les maladies cardiovasculaires restent la principale cause de mortalité chez les femmes, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, malgré les progrès considérables de la médecine au cours des dernières décennies.
Les femmes sont moins conscientes des maladies cardiaques et l’absence fréquente de symptômes typiques, en particulier dans le cas des maladies coronariennes, entraîne souvent un retard dans le diagnostic et donc dans le traitement ou la prise en charge. “Undertreatment” des femmes souffrant d’une maladie coronarienne.
Spécificités de genre en termes de facteurs de risque
Les facteurs de risque d’événements cardiovasculaires existent aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais leur pondération est différente. L’hypertension artérielle, l’obésité et le statut lipidique pathologique contribuent aux complications cardiaques dans des proportions comparables chez les hommes et les femmes, tandis que le tabagisme de longue date et le diabète sucré sont des facteurs de risque beaucoup plus pertinents chez les femmes (fig. 1).

Les hormones féminines ont un effet protecteur jusqu’à la ménopause, ce qui explique que le moment des manifestations des maladies cardiovasculaires survient en moyenne dix ans plus tard chez les femmes. A cet âge, il existe en outre davantage de facteurs de risque, ce qui entraîne un taux de complications plus élevé associé à l’événement cardiovasculaire.
On s’intéresse de plus en plus à l’hypercholestérolémie familiale (FH), qui se caractérise par des taux élevés de LDL-cholestérol et qui, si elle survient dès l’enfance, peut entraîner un infarctus prématuré (20% des infarctus du myocarde survenant avant l’âge de 45 ans sont dus à la FH). Les hommes sont atteints plus tôt, les femmes ménopausées le sont alors très rapidement ; c’est-à-dire que de nombreuses femmes subissent leur infarctus vers 50 ans, voire même au cours de la troisième et de la quatrième décennie.
Plusieurs données indiquent que le tabagisme, en particulier chez les jeunes femmes, est associé à une augmentation significative du risque par rapport aux fumeurs masculins. Dans une étude scandinave, le risque relatif (RR) d’un premier infarctus du myocarde était de 9,4 chez les femmes par rapport aux hommes (RR : 2,9). Des explications ont été trouvées dans une modification significative du métabolisme des lipides ou dans l’effet anti-œstrogène de la fumée de cigarette chez les femmes fumeuses.
Différences dans l’épidémiologie, la présentation clinique et le diagnostic
La maladie coronarienne se manifeste plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes à tout âge, même si la mortalité est plus élevée chez les femmes que dans la population masculine – en raison de leur âge plus avancé. Des différences cliniques entre les sexes sont régulièrement rapportées : Chez les femmes, les symptômes de l’angine de poitrine sont beaucoup plus atypiques et ne sont donc souvent pas reconnus comme étant associés à une maladie coronarienne. Cependant, plusieurs études montrent qu’en cas de syndrome coronarien aigu/infarctus du myocarde, les symptômes spécifiques à l’ischémie sont présents chez plus de 70% des femmes de manière aussi typique que chez les patients masculins. Au stade de la maladie coronarienne stable, les femmes présentent des symptômes tels que l’essoufflement, l’oppression thoracique, les nausées et la fatigue générale.
L’ECG d’effort est la méthode de diagnostic non invasive la plus appropriée pour détecter ou évaluer la dimension d’une maladie coronarienne. La spécificité moyenne est de 70% chez les femmes (77% chez les hommes), ce qui signifie à l’inverse que 30% des personnes examinées présentent des résultats faussement positifs après la mesure de l’ECG d’effort ; la valeur prédictive positive est de 50% chez les femmes et de 70% chez les hommes. La douleur thoracique est un symptôme peu prédictif dans la population féminine. Il existe cependant des paramètres tels que la durée de l’effort ou la capacité d’effort, ou encore la vitesse de récupération de la fréquence cardiaque 1 à 2 minutes après l’arrêt de l’effort, qui permettent de tirer des conclusions valables sur la marche à suivre et le pronostic général. Les techniques d’imagerie pendant l’effort (par exemple l’échocardiographie), les techniques de médecine nucléaire comme la scintigraphie de perfusion myocardique par SPECT ou la tomographie par émission de positons (TEP) augmentent par la suite la pertinence des résultats.
En cas d’indices de la présence d’une maladie coronarienne, en particulier dans le contexte d’un profil de risque correspondant, il convient de procéder rapidement à une évaluation invasive par angiographie coronaire. Des données récentes montrent que le parcours des femmes jusqu’à la preuve ou l’exclusion définitive d’une coronaropathie obstructive par cathétérisme cardiaque est beaucoup plus long (et plus pénible) que celui des hommes.
Bien que l’obstruction des artères coronaires soit également la cause la plus fréquente de coronaropathie chez les femmes, la coronaropathie non obstructive est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes (Fig. 2). Dans ce contexte, plusieurs mécanismes d’action sont discutés, notamment un dysfonctionnement coronarien microvasculaire avec une capacité de dilatation altérée. Le calcul de ce que l’on appelle la réserve de flux coronaire est effectué à l’aide de méthodes non invasives telles que la TEP. Les résultats pathologiques qui en découlent sont clairement associés à un moins bon pronostic. Ces liens entre le dysfonctionnement vasomoteur coronaire et les comorbidités telles que la résistance à l’insuline initient peut-être le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques de revascularisation et pas seulement d’amélioration des conditions anatomiques. Des perspectives tout à fait nouvelles pourraient être ouvertes par l’utilisation de substances fortement hypolipémiantes (inhibiteurs de PCSK9), de substances anti-inflammatoires (par exemple, inhibiteurs de l’interleukine 1) ou de substances modulant le système neurohumoral.

En outre, bien que rares, les femmes présentent plus souvent des situations cliniques de douleur thoracique et d’ischémie myocardique, comme dans le cas de la cardiomyopathie de Tako Tsubo (TCM) ou des dissections coronariennes, en particulier dans la phase péripartum. Le TCM est un tableau certes rare mais dramatique : en cas d’infarctus aigu du myocarde, il s’exprime par échocardiographie ou laevocardiographie sous la forme d’un “ballooning apical” ; il survient principalement chez les femmes ménopausées et souvent en raison d’un stress émotionnel lié à un événement “dramatique”, d’où son appellation de syndrome du cœur brisé. Le pronostic est généralement très bon, les résidus détectables sur le muscle cardiaque sont rares.
Gestion du syndrome coronarien aigu/infarctus du myocarde
Les interventions percutanées (PCI) sont le traitement de choix pour une grande partie des patients afin de réduire autant que possible la perte de fonction du ventricule gauche. La devise “time is muscle” signifie donc que le délai entre l’apparition des symptômes typiques de l’infarctus et la réouverture de la coronaire doit être aussi court que possible. Les villes et les régions bien organisées y parviennent désormais de manière satisfaisante. Néanmoins, les registres internationaux ou le réseau viennois de l’infarctus montrent des différences de temps significatives pouvant aller jusqu’à une heure : les femmes contactent les services de secours beaucoup plus tard que les hommes victimes d’un infarctus, ce qui entraîne globalement un allongement de la durée préhospitalière. Ici aussi, comme pour d’autres aspects du thème “Femmes et maladie coronarienne”, il faut informer et gagner du temps !
La mortalité hospitalière plus élevée en cas d’infarctus aigu du myocarde chez les femmes est principalement due à leur âge plus avancé et donc à leur plus grande multimorbidité. Pour le choc cardiogénique, le sexe féminin, indépendamment des comorbidités associées, est considéré comme un prédicteur indépendant d’une survie nettement moins bonne.
Implications cardiovasculaires des cancers féminins
Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès chez les femmes, suivies par les maladies cancéreuses. D’une part, il existe des facteurs de risque communs aux deux entités pathologiques et, d’autre part, les thérapies anticancéreuses, telles que les chimiothérapies cardiotoxiques, peuvent entraîner une aggravation des maladies cardiaques.
Les facteurs de risque communs sont l’obésité et le syndrome métabolique qui en découle, le diabète sucré en soi, ainsi que des comportements globalement néfastes pour la santé, tels que le manque d’activité physique, les aliments pauvres en nutriments et le faible statut social qui y est souvent associé. Dans le cancer du sein, le type de cancer féminin le plus fréquent, différentes substances potentiellement cardiotoxiques sont utilisées, comme les anthracyclines, les taxanes ou le trastuzumab, dont la toxicité cardiaque varie en fonction, entre autres, des substances administrées en combinaison.
Perspectives
La sensibilisation à la médecine de genre s’est développée dans les années 1970/80 sur la base des différences entre les sexes en matière de perception, de diagnostic et de traitement des maladies cardiaques (fig. 3). Depuis, des recherches intensives sont menées dans ce domaine, ce qui se traduit par le développement de méthodes de diagnostic et de traitement. Il est possible que, malgré l’intérêt académique pour les différences, un facteur de risque majeur subsiste : le manque de prise de conscience parmi les femmes et au sein de la communauté médicale que les maladies cardiovasculaires, basées sur les facteurs de risque que sont l’hypertension, l’obésité, le tabagisme et le syndrome métabolique, représentent un risque nettement plus élevé pour les femmes en termes de morbidité et de mortalité.

Messages Take-Home
- Les hormones féminines naturellement actives réduisent le risque cardiovasculaire.
- Après la ménopause, le risque de maladie coronarienne atteint le même niveau chez les femmes que chez les hommes.
- Les facteurs de risque de développer une maladie coronarienne sont identiques chez les hommes et les femmes, mais certains (par exemple le tabagisme) impliquent un risque cardiovasculaire beaucoup plus élevé pour les femmes par rapport aux fumeurs masculins.
- Le manque de conscience chez les femmes du fait qu’elles peuvent également développer une maladie coronarienne est l’un des plus grands facteurs de risque.
- Dans l’IRC stable, les symptômes sont souvent moins typiques chez les femmes et sont parfois mal interprétés. En cas de syndrome coronarien aigu/infarctus du myocarde, les femmes et les hommes présentent une symptomatologie typique comparable.
Littérature :
- Kannel WB : Clinical Misconceptions Dispelled by Epidemiological Research. Circulation 1995 ; 92(11) : 3350-3360.
- Jespersen L, et al : L’angine de poitrine stable sans coronaropathie obstructive est associée à un risque accru d’événements cardiovasculaires majeurs. Eur Heart J 2012 ; 33(6) : 734-744.
- Mosca L, et al : Tendances sur quinze ans de la prise de conscience des maladies cardiaques chez les femmes. Résultats d’une enquête nationale de l’American Heart Association en 2012. Ciruclation 2013 ; 127(11) : 1254-1263.
Littérature complémentaire :
- Akhter N, et al : Différences de genre parmi les patients atteints de syndromes coronariens aigus subissant une intervention coronarienne percutanée dans l’American College of Cardiology-National Cardiovascular Data Registry (ACCNCDR). Am Heart J 2009 ; 157(1) : 141-148.
- Canoy D, et al : Million Women Study Collaborators. Body mass index and incident coronary heart disease in women : a population-based prospective study. BMC Med 2013 ; 11 : 87.
- Chomistek AK, et al : Relationship of sedentary behavior and physical activity to incident cardiovascular disease : results from the Women’s Health Initiative. J Am Coll Cardiol 2013 ; 61(23) : 2346-2354.
- Glaser R, et al : Effet du sexe sur le pronostic après intervention coronarienne percutanée pour angine de poitrine stable et syndromes coronariens aigus. Am J Cardiol 2006 ; 98(11) : 1446-1450.
- Hansen CL, Crabbe D, Rubin S : Moins de précision diagnostique de l’imagerie SPECT de perfusion myocardique au thallium-201 chez les femmes : un effet de la taille plus petite de la chambre. J Am Coll Cardiol 1996 ; 28(5) : 1214-1219.
- Kwok Y, et al : Meta-analysis of exercise testing to detect coronary artery disease in women. Am J Cardiol 1999 ; 83(5) : 660-666.
- Mosca L, et al : Effectiveness-based guidelines for the prevention of cardiovascular disease in women – 2011 update : a guideline from the American Heart Association national survey. J Am Coll Cardiol 2011 ; 57(12) : 1404-1423.
- Tamis-Holland JE, et al : Différences sexuelles dans la présentation et les résultats chez les patients atteints de diabète de type 2 et d’artériopathie coronarienne traités par un traitement médical contemporain avec ou sans revascularisation rapide : un rapport de l’essai BARI 2. J Am Coll Cardiol 2013 ; 61(17) : 1767-1776.
- Tamura A, et al : Différences de genre dans les symptômes lors de l’occlusion de l’artère coronaire par ballon de 60 secondes. Am J Cardiol 2013 ; 111(12) : 1751-1754.
CARDIOVASC 2018 ; 17(4) : 7-10