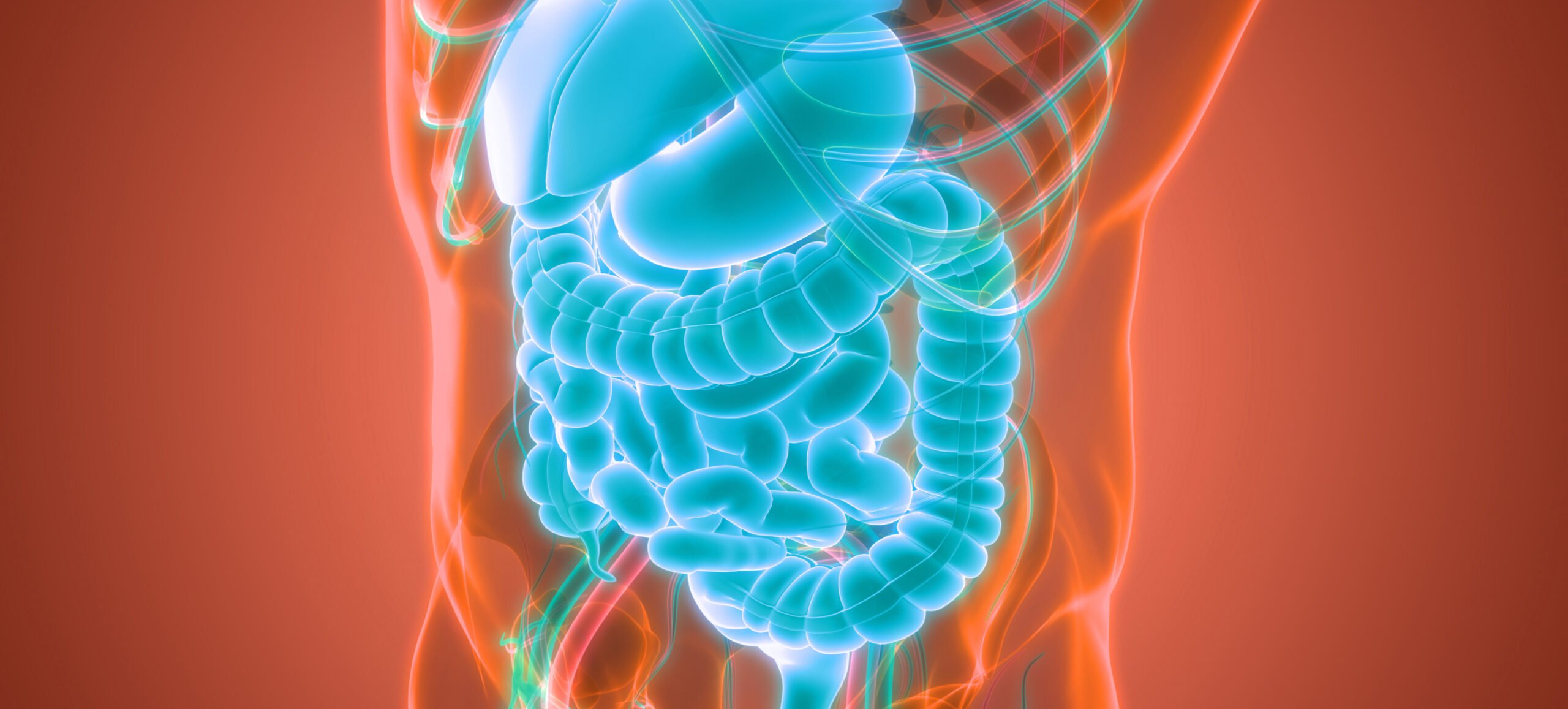Au cours de la maladie d’Alzheimer, les protéines “amyloïde” et “tau” s’accumulent dans le cerveau. Une étude menée par le DZNE auprès de plus de 200 participants fournit désormais des informations sur l’interaction entre ces phénomènes pathologiques. Les données indiquent que la charge de tau dans le cerveau n’affecte les fonctions de mémoire que si la charge amyloïde est également élevée. Ces résultats soutiennent donc les approches thérapeutiques visant à éliminer l’amyloïde du cerveau aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer. Une équipe de recherche dirigée par le professeur Emrah Düzel en fait état dans la revue spécialisée “Brain”.
“On sait depuis longtemps que les dépôts de protéines tau dans ce que l’on appelle l’hippocampe et dans les zones cérébrales voisines affectent la mémoire. En revanche, on n’a pas encore trouvé de lien clair entre l’amyloïde et la mémoire. C’est l’une des raisons pour lesquelles on se demande s’il est utile de s’attaquer à l’amyloïde à des fins thérapeutiques. Nos résultats actuels indiquent que cela pourrait effectivement être utile pour la fonction de mémoire aux premiers stades de la maladie”, explique le chercheur Emrah Düzel, porte-parole du site DZNE de Magdebourg et directeur de l’Institut de neurologie cognitive et de recherche sur la démence à l’Université Otto von Guericke de Magdebourg. “L’aspect décisif est que l’on ne considère pas la tau seule, mais conjointement avec la pathologie amyloïde. C’est là qu’un lien apparaît clairement si l’on étudie un plus grand nombre de personnes”.
Collecte de données sur plusieurs sites
Les données qui viennent d’être analysées proviennent d’une étude à long terme menée par le DZNE (DELCODE) en collaboration avec des hôpitaux universitaires, à laquelle participent dix centres d’étude dans toute l’Allemagne. Les recherches actuelles ont été menées sur 235 personnes âgées de plus de 60 ans. Ce groupe comprenait non seulement des adultes sans troubles cognitifs, mais aussi des adultes présentant des troubles de la mémoire qui étaient soit légers (“troubles cognitifs légers”), soit seulement subjectifs – c’est-à-dire que les tests courants ne permettaient pas de détecter les problèmes de mémoire. Les données concernant les personnes atteintes de démence n’ont pas été prises en compte, car l’accent était mis sur les stades précoces de la maladie d’Alzheimer. L’équipe de Düzel a analysé le liquide céphalorachidien – également appelé “liquide nerveux” – des sujets et a examiné leur mémoire et leur activité cérébrale à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf).
Les concentrations de protéines amyloïdes et tau dans le liquide céphalorachidien sont des indicateurs courants permettant d’évaluer l’exposition du cerveau à ces protéines. Comme les protéines amyloïdes et tau sont également présentes dans le liquide céphalorachidien des personnes en bonne santé, les sujets ont été classés en fonction de valeurs seuils établies, selon qu’ils présentaient des résultats pathologiques, c’est-à-dire anormaux, ou des valeurs dans la fourchette normale. Pour l’étude de la mémoire par IRMf, les participants à l’étude ont été invités à mémoriser des images photographiques, tandis que l’activité cérébrale dans l’hippocampe – le centre de contrôle de la mémoire – était enregistrée simultanément. “Grâce à cette IRM de tâche, nous avons constaté que l’activation de l’hippocampe face à de nouvelles images diminuait avec l’augmentation de la charge de tau, et donc de la mémoire, mais uniquement si la charge amyloïde était également élevée. En d’autres termes, une charge élevée des deux protéines était la cause probable d’une diminution de la mémoire”, explique Düzel. “Les études précédentes n’ont pas permis de démontrer ce lien. L’harmonisation technique nécessaire entre les différents sites d’étude est très coûteuse. De telles études nécessitent une infrastructure telle que celle que le DZNE a mise en place au fil des années”.
Soutien aux thérapies anti-amyloïdes
“Nos données montrent plusieurs corrélations pertinentes. Lorsque la concentration d’amyloïde se situe au-delà du seuil pathologique, et seulement dans ce cas, nous constatons que plus le taux de rosée dans le liquide céphalorachidien est élevé, plus les performances de la mémoire sont mauvaises et plus les pertes d’activité dans l’hippocampe sont marquées”, poursuit Düzel. “Et nous constatons également que si l’on compare les participants à l’étude ayant des données de tau similaires, les performances de la mémoire sont plus altérées chez ceux dont les taux d’amyloïde sont anormaux que chez ceux dont les taux d’amyloïde sont dans la norme”. Les causes de l’interaction entre les pathologies amyloïde et tau sont encore largement incomprises, admet Düzel, mais il conclut : “Nos données montrent qu’il pourrait être utile de réduire la charge tau si la charge amyloïde est élevée en même temps. Mais nos résultats suggèrent également qu’il pourrait être utile de réduire ou de maintenir la charge amyloïde à un faible niveau au début de la maladie, même si la charge tau reste inchangée. On peut déduire de nos résultats que la mémoire pourrait en bénéficier”.
C’est là qu’interviennent les thérapies anti-amyloïdes par “anticorps monoclonaux”, actuellement en phase d’essais cliniques et dont la substance active “Aducanumab” (nom de marque : Aduhelm) a reçu une première autorisation de mise sur le marché aux États-Unis. Celle-ci est toutefois controversée. Düzel : “Indépendamment de l’efficacité clinique de ce médicament particulier, les résultats de notre étude soutiennent le concept fondamental d’endiguement de l’amyloïde. Cette approche devrait continuer à être prise en compte dans le développement des traitements”.
Publication originale :
La pathologie amyloïde mais pas le statut ApoE4 est permissive pour le dysfonctionnement hippocampique lié à la tau ; Emrah Düzel et al ; Brain (2022), DOI : 10.1093/brain/awab405 ; URL :
https://academic.oup.com/brain/article-lookup/doi/10.1093/brain/awab405