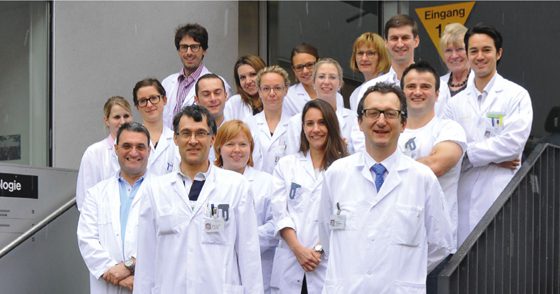“Vive le sport !” – Le titre de ce tube des années 80, à la fois honnête et ironique, résume bien la situation : pour beaucoup, le sport (et pas seulement le football) est sans doute la plus belle chose au monde, mais il comporte aussi des dangers. En Suisse, les blessures sportives sont en constante augmentation ces dernières années, même si elles n’entraînent que très rarement des décès. La majorité des événements fatals dans le sport sont d’origine cardiaque.
Ce fait inquiétant a donné naissance à la notion de “paradoxe du sport” : d’une part, les propriétés préventives et bénéfiques pour la santé d’un entraînement physique régulier ne sont pas contestées, mais d’autre part, le sport a également été identifié comme un “déclencheur” d’arrêt cardiaque soudain et de mort cardiaque. Cela est particulièrement vrai en cas de maladie cardiovasculaire sous-jacente, qui peut multiplier par 100 le risque d’incident cardiaque fatal lié au sport. L’objectif principal est donc d’effectuer un dépistage cardiaque adéquat, qui devrait également toucher autant que possible tous les sportifs.
Cependant, de nombreux sportifs, en particulier dans les sports dits “amateurs et de masse”, ne sont pas dépistés aujourd’hui, et même un dépistage effectué de manière adéquate selon les directives les plus récentes ne peut jamais empêcher tous les événements fatals. Dans ce cas, si des symptômes cliniques typiques, tels que des douleurs thoraciques, apparaissent, il est important de prendre les mesures appropriées sans tarder. Un guide pratique nous est fourni dans ce numéro de CARDIOVASC.
L’athéromatose, qui se développe souvent de manière insidieuse et asymptomatique et peut finalement conduire à une rupture de plaque potentiellement létale, même sous une forme peu prononcée (notamment pendant le sport), est une maladie systémique. Un article de FMC intéressant dans ce numéro traite en complément d’une problématique veineuse pertinente et donc d’un autre aspect important des maladies vasculaires : l’ulcère veineux chronique et les pièges de son traitement, que nous ne connaissons malheureusement que trop bien dans notre pratique quotidienne.
Encouragez donc vos patients (ainsi que votre entourage privé et vous-même, bien entendu) à pratiquer une activité physique régulière. Des mesures préventives visant à réduire les facteurs de risque cardiovasculaire, un dépistage adéquat et un programme d’entraînement sur mesure permettent tout à fait d’atténuer le “paradoxe du sport”. Vive le sport !
Dr. med. Christian Marc Schmied