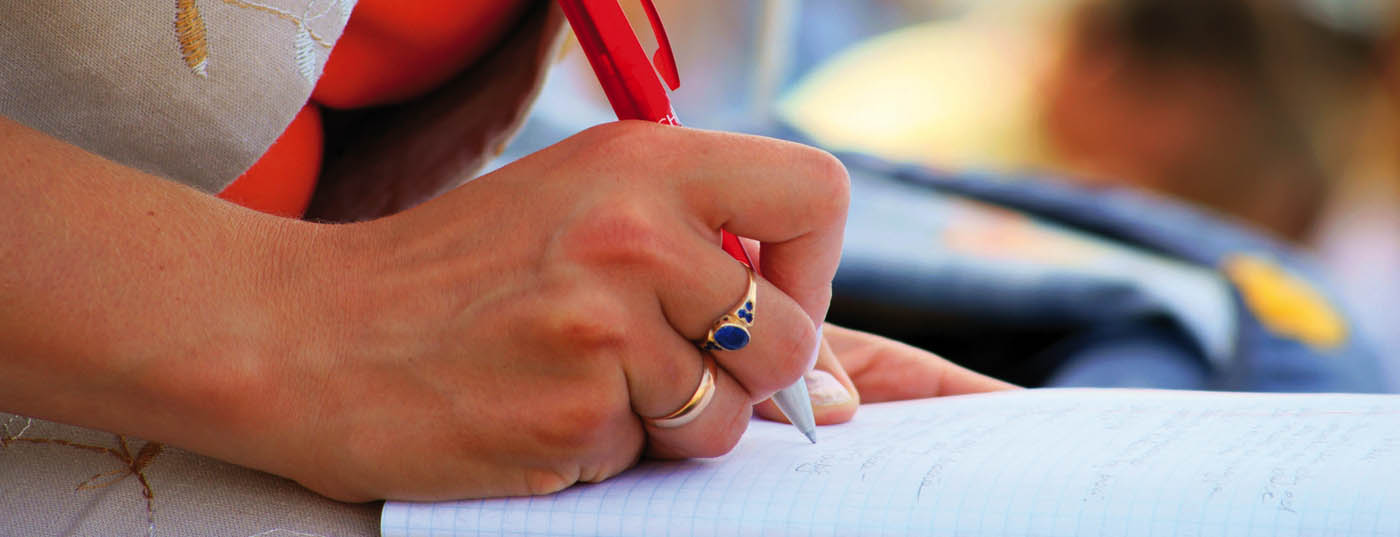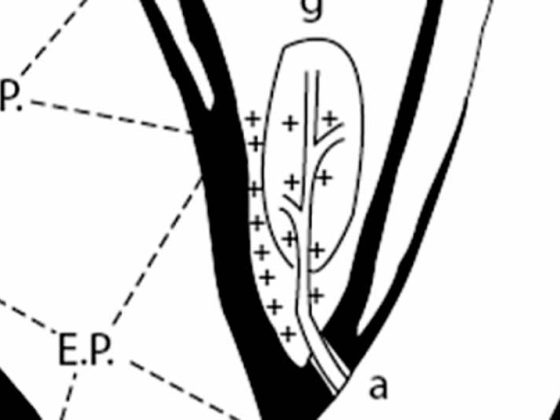Depuis septembre 2014, le “Concept national maladies rares” de l’OFSP est disponible. Il s’agit d’une étape importante compte tenu de l’ampleur des défis et des situations quotidiennes des personnes concernées. Il se lit toutefois comme un bon résumé des mesures prises par nos voisins. Le fait que ces pays aient plus d’une décennie d’avance sur la Suisse en termes de mise en œuvre et de mesures concrètes laisse songeur, notamment compte tenu du fait que nous disposons d’un système de santé bien développé et coûteux.
A Berne, on veut désormais soutenir davantage les maladies rares par le biais d’un concept national. Cela semble tout à fait logique et constitue la bonne approche. En effet, l'”esprit de clocher” aurait plutôt eu un effet de frein sur ce point. Malgré les nouvelles thèses et le document décrit, les quelque 580 000 personnes concernées en Suisse, ainsi que de nombreux praticiens et spécialistes, sont toujours assez perplexes quant à la suite des événements.
Nous pensons qu’un concept reste un concept tant que des acteurs ne lui donnent pas vie. Mais ce n’est pas si simple compte tenu des questions de compétences et de prise en charge des coûts décrites dans le concept. En effet, les thérapies pour les maladies rares ne sont toujours pas prises en charge par les caisses d’assurance maladie dans la majorité des cas. Et il n’y a apparemment pas de soutien alternatif, si l’on en croit les politiciens fédéraux, qui semblent avoir un point aveugle sur ce point.
C’est pourquoi de nombreux professionnels de la santé se demandent légitimement comment les thérapies pour les maladies rares doivent être facturées aujourd’hui et à l’avenir, compte tenu de la jungle de facturation existante. Près de 70% des médicaments, peu nombreux et très coûteux, figurent aujourd’hui sur la liste des spécialités (LS). Mais seuls 120 médicaments orphelins (produits thérapeutiques pour les maladies rares) y sont autorisés par Swissmedic. Le reste des personnes concernées espère être classé dans la catégorie des infirmités congénitales. Cependant, seules une centaine des 7000 maladies rares connues sont concernées. Jusqu’à présent, c’était l’AI qui s’en chargeait, à laquelle les personnes concernées devaient adresser chaque année de nouvelles demandes de prise en charge. C’est fastidieux, cela implique beaucoup de bureaucratie et cela laisse sans réponse les questions des patients qui ne sont touchés par une maladie rare qu’à un âge avancé.
Empowerment – mais comment ?
Le concept montre heureusement aussi que la vulnérabilité et les aspects de l’éthique ont été abordés – avec la question légitime de savoir comment un empowerment des personnes concernées peut contribuer de manière ciblée et par des mesures concrètes à une amélioration de la qualité de vie. Il n’est pas nécessaire d’aller chercher dans les pays voisins pour trouver des concepts viables – comme le programme de promotion de la santé ELFEN HELFEN. Le fait que ce programme reçoive désormais des invitations jusqu’en Amérique du Nord indique qu’il s’agit de bien plus qu’un simple concept.
Prendre en compte les différents acteurs
Compte tenu de l’impact des maladies rares sur la santé des enfants et des familles (les enfants atteints meurent dans les cinq ans), il est important de rassembler les compétences et d’impliquer les acteurs. Nous considérons le médecin généraliste comme un acteur très important, car il bénéficie de la confiance des patients, mais n’a souvent pas encore de réponses aux nombreuses questions que se posent les personnes concernées. Nous aimerions donc que vous nous fassiez part des problèmes que vous rencontrez dans la gestion concrète des maladies rares dans votre cabinet.
Pour ce faire, nous avons ajouté ce sujet à notre blog en ligne et nous attendons avec impatience votre participation active. Sur la base de ces derniers, nous tenterons de déterminer quelles sont les mesures urgentes à prendre pour que vous et vos patients puissiez enregistrer le plus rapidement possible des progrès en matière de thérapie et d’autonomisation. Vous trouverez notre blog ici : http://blog.orphanbiotec-foundation.com.
PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2014 ; 9(12) : 49-50