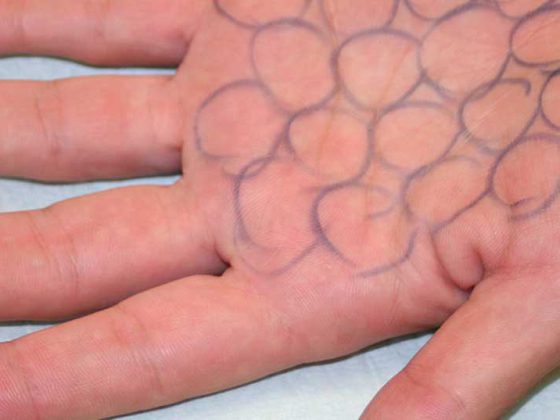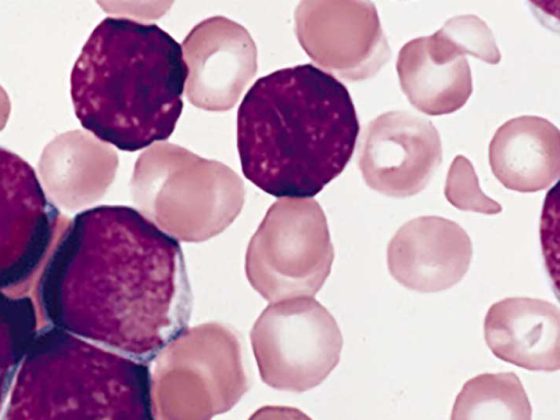“J’aime la combinaison de l’artisanat et de la compréhension intellectuelle des processus complexes ou de la technologie. La chirurgie cardiaque est une spécialité où l’on traite tout le monde, du nourrisson au patient âgé, c’est ce qui m’a plu”. Prof. Dr. med. Dr. h.c. Thierry Carrel, directeur de la clinique universitaire de chirurgie cardio-vasculaire à Berne, répond aux questions de la journaliste Nathalie Zeindler.
Dans “De tout cœur”, les interventions cardiaques sont décrites du point de vue de 20 patients. Le professeur Carrel nous donne son point de vue sur la salle d’opération et sur Dieu et le monde. Lors d’un entretien personnel, le médecin a répondu à des questions très personnelles et plus politiques.
La chirurgie cardiaque est-elle pour vous un acte de routine ou un acte d’art ?
Le professeur Dr Carrel :
C’est un peu des deux. C’est une prouesse que d’arrêter et de redémarrer le cœur pendant l’opération. Il s’appuie sur des connaissances issues des sciences naturelles. Mais il y a aussi une certaine standardisation. La routine est un mot difficile – une opération ne se déroule pas toute seule, mais les interventions se déroulent de manière structurée. Tout est clairement défini. Il n’y a de place pour l’art et la créativité que dans le cas d’interventions pour malformations congénitales.
Le cœur a-t-il aussi un caractère religieux ?
Il y a beaucoup de symbolisme autour du cœur. C’est un organe spécial, car on le ressent mieux et plus souvent que les autres organes du corps dans les situations de vie les plus diverses. Le symbolisme autour du cœur a en outre une grande tradition. Depuis des millénaires, une représentation symbolique est connue dans les cultures les plus diverses. Un caractère religieux ne me semble pas tout à fait compréhensible dans ce contexte. Le siège supposé de l’âme, qui entre de temps en temps en jeu dans le cadre de la force symbolique du cœur, reste également ouvert. Je pense qu’en fin de compte, il y a quelque chose de positif dans le fait qu’il y ait encore des secrets sur le corps humain.
Quel est votre lien avec votre propre cœur ?
Je le ressens comme tout le monde. Je ne suis pas protégé contre les maladies cardiaques parce que je travaille dans le domaine de la cardiologie. Nous avons de longues journées de travail avec des situations parfois stressantes, il doit y avoir une bonne compensation au travail ou à la récupération. Dans mon rôle de médecin, je dois aussi être un modèle. Je fais du sport et je vais de temps en temps chez des collègues pour un check-up. Si j’avais des douleurs cardiaques, je me ferais examiner normalement. En médecine cardiaque, il existe toutefois des maladies insidieuses qui peuvent entraîner la mort sans grands symptômes. En fin de compte, malgré les précautions prises, un certain risque résiduel subsiste.
Dans quelle mesure êtes-vous vous-même vulnérable lorsque vous êtes confronté quotidiennement à des destins de patients difficiles ?
Il y a deux aspects : Celui professionnel en tant que chirurgien, qui doit donner du courage, gagner la confiance, donner de l’espoir et motiver. Sur ce lieu de travail, il faut parfois se surpasser lorsque l’on assiste à des situations terribles. Il faut aussi savoir faire face à la mort. Dans la société actuelle, toutes les possibilités médicamenteuses et techniques font parfois oublier que ce qui nous attend tous sans exception, c’est la mort.
En dehors du lieu de travail, chaque médecin doit pouvoir digérer les émotions en solitaire. Cela fait également partie des tâches. En tant que chef, on est plutôt seul au niveau supérieur de la hiérarchie, mais nous essayons de transmettre le soutien vers le bas, vers les collègues plus jeunes. En fin de compte, chacun doit trouver sa propre façon de gérer ces sentiments.
Est-on de plus en plus seul au fur et à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie professionnelle ?
Oui, cela fait probablement partie des inconvénients d’être chef. J’ai de bons contacts avec tous les collègues de mon équipe, mais je ne veux pas leur imposer mes soucis en plus de leurs propres charges. En tant que chef, vous devez pouvoir traiter certaines choses vous-même.
Pourquoi avez-vous choisi la chirurgie cardiaque ?
J’aime la combinaison de l’artisanat et de la compréhension intellectuelle des processus complexes ou de la technologie. La chirurgie cardiaque est une spécialité où l’on traite tout le monde, du nourrisson au patient âgé, c’est ce qui m’a plu. Mais le hasard a aussi joué un rôle. Pendant les années d’études, une certaine personnalité vous impressionne, ce qui contribue également à la décision. Adolescent, j’ai été fasciné par l’implantation du premier cœur artificiel Jarvik-7 à Salt Lake City. J’ai trouvé cela presque plus impressionnant que la transplantation de cœurs de donneurs. L’un des avantages des cœurs artificiels est leur disponibilité.
De plus, j’aime personnellement être en contact avec les gens. En chirurgie cardiaque, on va vite à l’essentiel d’une personne, les discussions avant une opération du cœur se concentrent souvent sur les questions essentielles de la vie. L’être humain (à de très rares exceptions près) accorde plus d’importance à l’intervention cardiaque qu’à toute autre intervention.
Les personnalités de la chirurgie cardiaque qui m’ont beaucoup influencé sont le professeur Marko Turina et son prédécesseur, le professeur Ake Senning. Ils étaient pour moi des chirurgiens absolument fascinants.
Les opérations lourdes doivent être simplifiées compte tenu de l’âge croissant des patients. Cela se fait-il dans l’esprit d’une intervention peu invasive ?
C’est un défi. L’espérance de vie s’est considérablement allongée. Il y aura une augmentation significative de la population âgée, ce qui soulève la question de savoir quels services le système de santé fournira aux personnes âgées. L’objectif est d’avoir une bonne qualité de vie jusqu’à l’approche de la mort, de rester autonome là où c’est possible et, si possible, de ne pas ressentir de douleur ou de symptômes en présence d’une maladie. D’un point de vue médical, il faut évaluer à un âge avancé si l’intervention est adaptée à la situation spécifique (présence de pathologies associées, motivation du patient). Pour cette évaluation, un entretien personnel approfondi est déterminant, de préférence aussi avec les proches.
A-t-on encore le temps d’avoir des conversations aussi longues ?
On trouve toujours du temps, la seule question est de savoir quelle est la durée de la journée. On est pénalisé par le système de facturation, car l’entretien n’est pas bien rémunéré, contrairement aux traitements. Dans une situation particulière, une conversation peut parfois être plus importante qu’une opération.
Le financement des hôpitaux est-il une mauvaise décision ? Les patients sortent plus tôt et doivent parfois être réadmis, en particulier les patients âgés.
Pour certains départements, le financement actuel est problématique. La question se pose toujours de savoir comment une prestation donnée est rémunérée. En cardiologie, les prestations sont très correctement rémunérées.
En principe, nous avons bien sûr tout intérêt à ne pas garder le patient à l’hôpital plus longtemps que ce qui est médicalement nécessaire, car la phase suivante est une phase de rééducation importante. En outre, en chirurgie cardiaque, si un patient présentant des complications après une intervention est réadmis dans les 21 jours, cela relève du même forfait par cas que l’intervention initiale. Cette réglementation est conçue comme une protection, de sorte que l’on ne regarde pas uniquement l’aspect financier et que les complications soient confiées à d’autres. Il y aura toujours des décisions erronées lors des licenciements, car des complications peuvent se développer plus tard.
Le système actuel, introduit en 2012, pose déjà des problèmes : L’hôpital raisonne en termes de gestion d’entreprise. Le chiffre d’affaires doit être correct, le mieux étant qu’il n’y ait pas de perte ou, mieux encore, un bénéfice à la fin de la période de facturation ! dans le secteur de la santé, c’est la pensée économique qui prévaut. C’est là qu’interviennent rapidement des réflexions sur les traitements douteux ou discutables du point de vue de l’économie nationale à un âge avancé. Ces questions s’inscrivent en même temps dans un cadre éthique. Ce que la médecine ne doit en aucun cas faire, c’est discriminer les patients. Le contexte des interventions chirurgicales chez les personnes âgées a évolué. Aujourd’hui, il est possible d’opérer un patient âgé mais en bonne santé qui, auparavant, n’aurait pas été pris en considération pour cette opération uniquement en raison de son âge.
La médecine hautement spécialisée présente-t-elle aussi des inconvénients, car il faut évaluer plus précisément si une opération spécifique peut encore être effectuée à un certain âge ou non ?
Chaque génération doit faire face à ses propres problèmes et avantages. Une discussion est nécessaire. En règle générale, l’homme peut vivre plus vieux et jouir d’une meilleure santé plus longtemps. Ainsi, de nouvelles questions de traitement apparaissent avec l’âge. L’homme aime tout simplement vivre, tant que la qualité de vie est bonne. Il est très difficile de déconseiller une intervention à un patient qui a encore beaucoup de plaisir à vivre. D’un autre côté, il y a bien sûr des patients qui sont très sûrs de ne plus vouloir de traitement curatif. C’est là qu’interviennent les soins palliatifs. L’importance de cette spécialité doit être davantage prise en compte afin de répondre aux besoins en fin de vie, même en dehors d’EXIT.
Budget global – c’est-à-dire que les tarifs des prestations médicales sont réduits d’un certain facteur à partir d’une certaine croissance des coûts. Qu’en pensez-vous ?
Nous devons contribuer au développement du système de manière constructive. A titre d’exemple, on peut citer la surabondance massive d’hôpitaux en Suisse.
La ville de Berne compte d’innombrables services d’urgence. Des développements raisonnables sont nécessaires dans ce domaine. La coopération est de mise. Entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés, il faut trouver un mode de fonctionnement où l’on se complète. Il n’est pas possible qu’un seul fasse des bénéfices pendant que les autres opèrent des patients compliqués jour et nuit. Les petits hôpitaux doivent soulager les grands pour les interventions/traitements non compliqués.
La médecine personnalisée (Big Data) collecte le plus grand nombre possible de données sur les patients. Que pensez-vous de cette évolution ?
Au final, cela est probablement très positif. Mais le chemin vers un système fonctionnel est très long et, dans le cadre de la collecte de données très personnelles, il est synonyme d’incertitude pour les patients. L’objectif est d’établir un profil de risque numérique de chacun pour certaines maladies en analysant une partie de son patrimoine génétique. La prévoyance pourrait ainsi être encore mieux ciblée. La médecine personnalisée vise à mieux définir un risque afin d’identifier les patients les plus vulnérables ou ceux qui bénéficient le plus d’un traitement donné.
Don d’organes et pénurie d’organes – quelle est la situation actuelle ?
On ne peut pas imposer à une société ce qu’elle ne veut pas. Mais : en Suisse, nous perdons plusieurs dizaines de personnes par an, faute d’organes disponibles en nombre suffisant. Là encore, il existe différents points de vue. Moins de donneurs signifie également moins d’accidents mortels.
Actuellement, le consentement étendu est pratiqué. Le défunt devrait donc avoir exprimé de son vivant un consentement de principe au don ou, si cette décision est inconnue, elle sera transmise à la famille proche après le décès.
L’une des réflexions a été d’introduire la solution de l’opposition : Seule la personne qui s’oppose n’est pas considérée comme donneur d’organes, toutes les autres sont des donneurs potentiels.
Actuellement, une initiative sur le “consentement présumé” est en cours d’élaboration. Cela permettrait de séparer dans le temps le processus de décision du don de celui du décès aigu. Un effet positif de l’absence de donneurs est l’effort de l’industrie pour trouver des solutions de remplacement, par exemple de meilleurs médicaments ou des cœurs artificiels.
Qu’est-ce qui vous a le plus ému lors de la création du livre (“Von Herzen”) ?
Que les patients aient même accepté de parler de leur histoire médicale, sous une forme non anonyme et avec des images. Je pense que beaucoup ont ressenti le besoin de décrire ces interventions du point de vue du patient. Les brochures d’information destinées aux patients sont en effet souvent très neutres et reflètent l’opinion des médecins.
Extrait de l’interview de Nathalie Zeindler
Rédaction Dr. med. Katrin Hegemann
CARDIOVASC 2017 ; 16(6) : 23-24