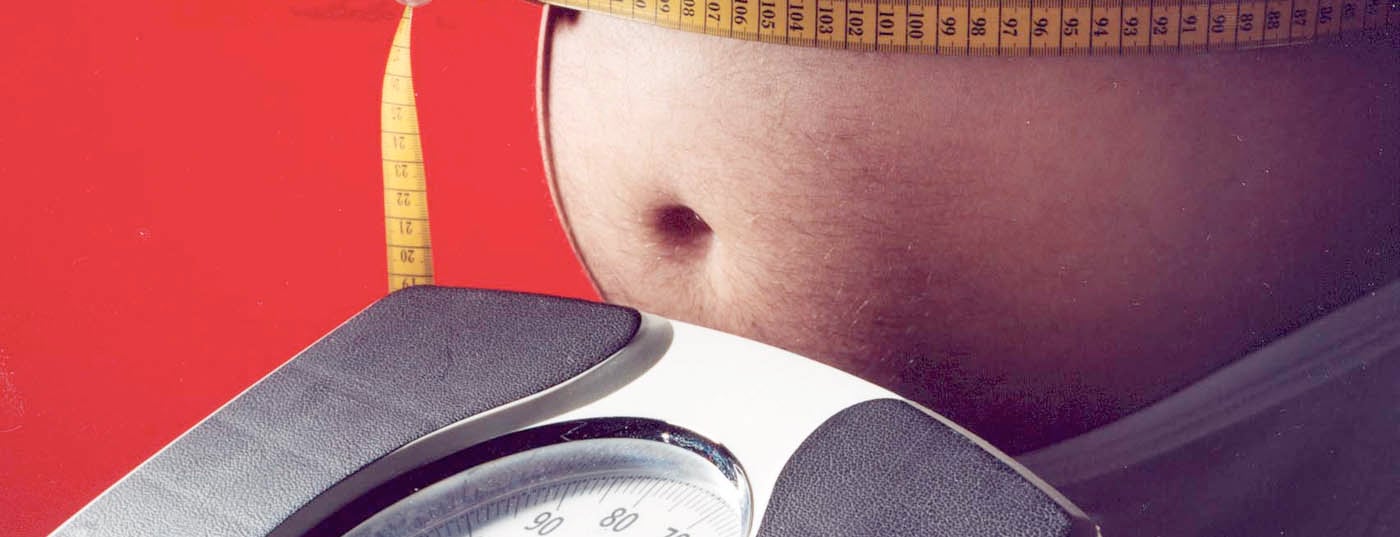Le fait que le surpoids et l’obésité constituent un grave problème de santé dans de nombreux pays industrialisés occidentaux est sans doute largement connu. Mais un IMC élevé est-il associé à un risque de cancer ? Plusieurs études épidémiologiques ont été consacrées à cette question par le passé.
(ag) Une nouvelle étude publiée dans le Lancet a examiné dans quelle mesure le poids ou l’obésité est effectivement associé à l’apparition d’un cancer. Dans le cadre d’une évaluation systématique à grande échelle, les auteurs examinent la relation entre l’indice de masse corporelle (IMC) et les cancers les plus répandus. Ils ont également inclus dans leur analyse des variables potentiellement confondantes. Selon les chercheurs, une telle étude est très pertinente compte tenu de l’augmentation des taux d’obésité dans le monde.
Les études menées jusqu’à présent ne sont pas satisfaisantes
De nombreuses études antérieures sur ce sujet ont manqué de puissance statistique ou ont pris en compte de manière insuffisante ou incohérente les facteurs de confusion. On sait peu de choses sur l’importance de facteurs importants tels que le statut tabagique et l’âge, qui pourraient modifier de manière significative la relation entre l’IMC et le cancer. De plus, les valeurs d’IMC utilisées étaient principalement basées sur des déclarations personnelles, ce qui ne reflète pas complètement la valeur réelle. Néanmoins, une méta-analyse de 2008 avait déjà démontré une forte association entre l’IMC et les cancers de l’œsophage, de la thyroïde, du côlon, des reins, de l’endomètre et de la vésicule biliaire. Les auteurs ont voulu vérifier eux-mêmes ces conclusions à l’aide de données épidémiologiques.
Méthode
La relation (linéaire et non linéaire) entre l’IMC et les 22 cancers les plus fréquents a été étudiée. Ils ont également examiné si les résultats changeaient lorsque des facteurs tels que le sexe, le statut ménopausique et tabagique et l’âge étaient modifiés.
Pas moins de 5,24 millions de personnes ont été incluses dans l’étude de cohorte (basée sur les dossiers numérisés des médecins de premier recours du Royaume-Uni). Ils disposaient d’une période de suivi suffisamment longue et n’avaient pas de diagnostic de cancer antérieur. Les données d’IMC étaient disponibles pour tous. En moyenne, le suivi s’est terminé après 7,5 ans et l’IMC moyen était de 25,5 kg/m2.
Le poids joue un rôle important
166 955 personnes de l’échantillon ont développé l’un des 22 cancers pertinents. Selon l’analyse non linéaire, l’IMC était associé à 17 types de cancer, mais il y avait de grandes différences selon le type de cancer (en termes de direction et de force de l’association).
Pour chaque augmentation de l’IMC de 5 kg/m2, le risque de cancer de l’utérus, de la vésicule biliaire, du rein, du col de l’utérus, de la thyroïde et de leucémie augmentait également de manière linéaire – ceci en contrôlant tous les facteurs confondants potentiels. Les valeurs associées étaient
- Cancer de l’utérus : Hazard Ratio [HR] 1,62 ; 99% CI 1,56-1,69 ; p<0,0001
- Cancer de la vésicule biliaire : 1,31 ; 1,12-1,52 ; p<0,0001
- Cancer du rein : 1,25 ; 1,17-1,33 ; p<0,0001
- Cancer du col de l’utérus : 1,10 ; 1,03-1,17 ; p=0,00035
- Cancer de la thyroïde : 1,09 ; 1,00-1,19 ; p=0,0088
- Leucémie : 1,09 ; 1,05-1,13 ; p≤0,0001
L’IMC était globalement associé de manière positive et hautement significative au cancer du foie, du côlon, des ovaires et du sein post-ménopausique, mais ces effets non linéaires variaient en fonction de la valeur de l’IMC et des caractéristiques individuelles.
Une association inverse avec le risque de cancer de la prostate et de cancer du sein préménopausique a été observée dans la population générale et chez les non-fumeurs. Les valeurs dans la population totale étaient de HR 0,98 ; 0,95-1,00 (prostate) et HR 0,89 ; 0,86-0,92 (cancer du sein). Il s’est avéré que le risque de cancer du sein préménopausique augmentait jusqu’à 22 kg/m2, mais qu’il diminuait à partir de ces valeurs. La même chose s’est produite pour le cancer de la prostate. Les auteurs supposent que cet état de fait est dû à un diagnostic tardif du cancer chez les personnes en surpoids (ce que d’autres études montrent également).
Une telle association inverse a d’abord été observée pour les cancers du poumon et de la cavité buccale, mais elle a disparu lorsque l’on s’est limité au sous-groupe des non-fumeurs. C’est donc plutôt le statut de fumeur qui joue ici un rôle prépondérant.
Si l’on suppose une association causale, cela signifie que 41% des cancers de l’utérus et 10% ou plus des cancers de la vésicule biliaire, des reins, du foie et du côlon peuvent être attribués au surpoids et à l’obésité.
Lien de cause à effet possible
Les auteurs ont calculé qu’une augmentation moyenne de l’IMC de 1 kg/m2 dans la population totale entraînerait 3790 patients supplémentaires par an qui développeraient l’un des dix cancers positivement associés. Les chercheurs concluent que l’IMC est associé au risque de cancer. Si l’on part du principe qu’il existe un lien de causalité, de nombreux cancers peuvent être attribués au surpoids et à l’obésité. Cependant, l’hétérogénéité des effets montre également que différents mécanismes et sous-groupes doivent être pris en compte pour les types de cancer spécifiques.
Source : Bhaskaran K, et al : Body-mass index and risk of 22 specific cancers : a population-based cohort study of 5,24 million UK adults. The Lancet 2014 ; 384(9945) : 755-765.
InFo Oncologie & Hématologie 2014 ; 2(7) : 2