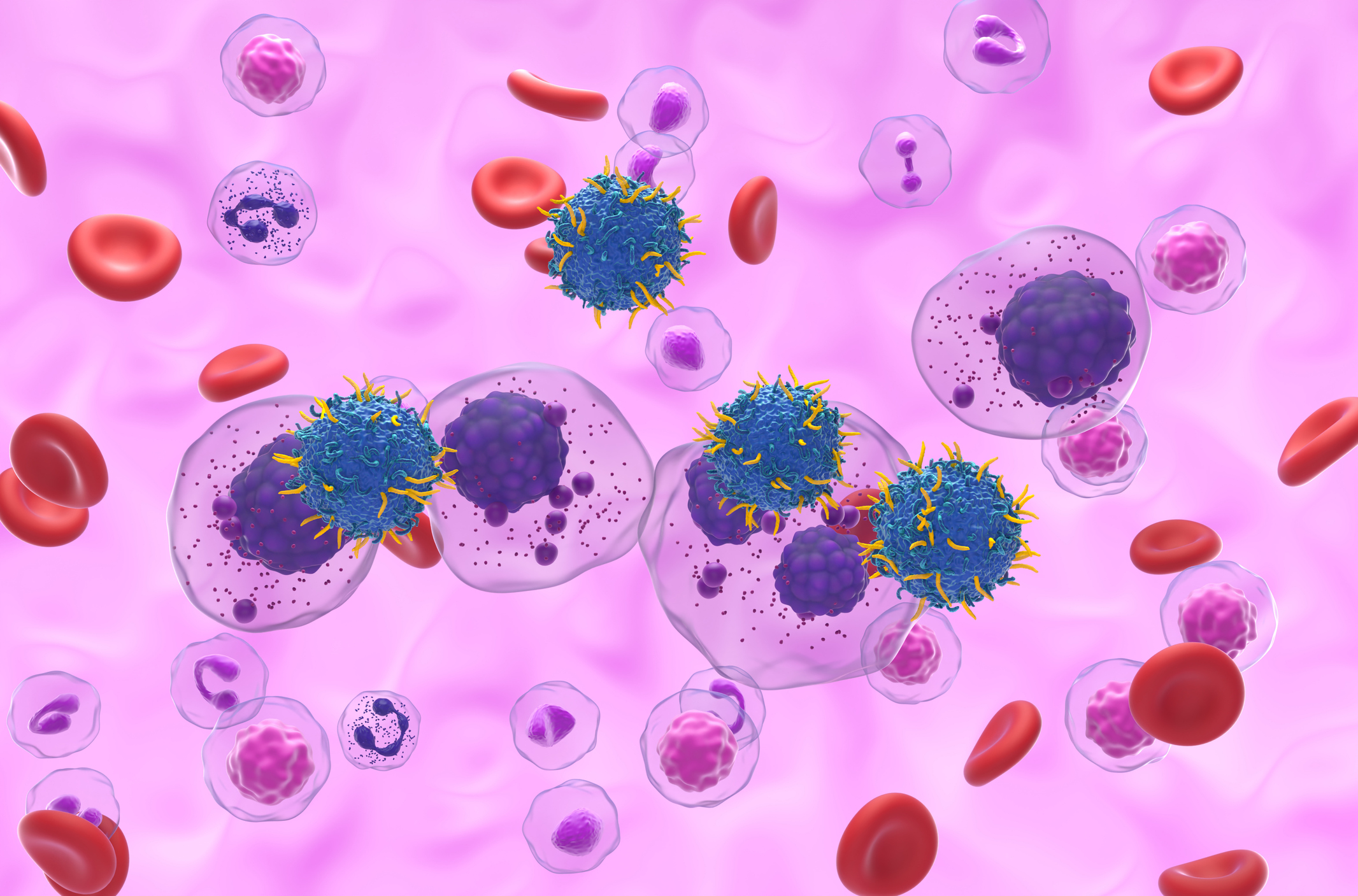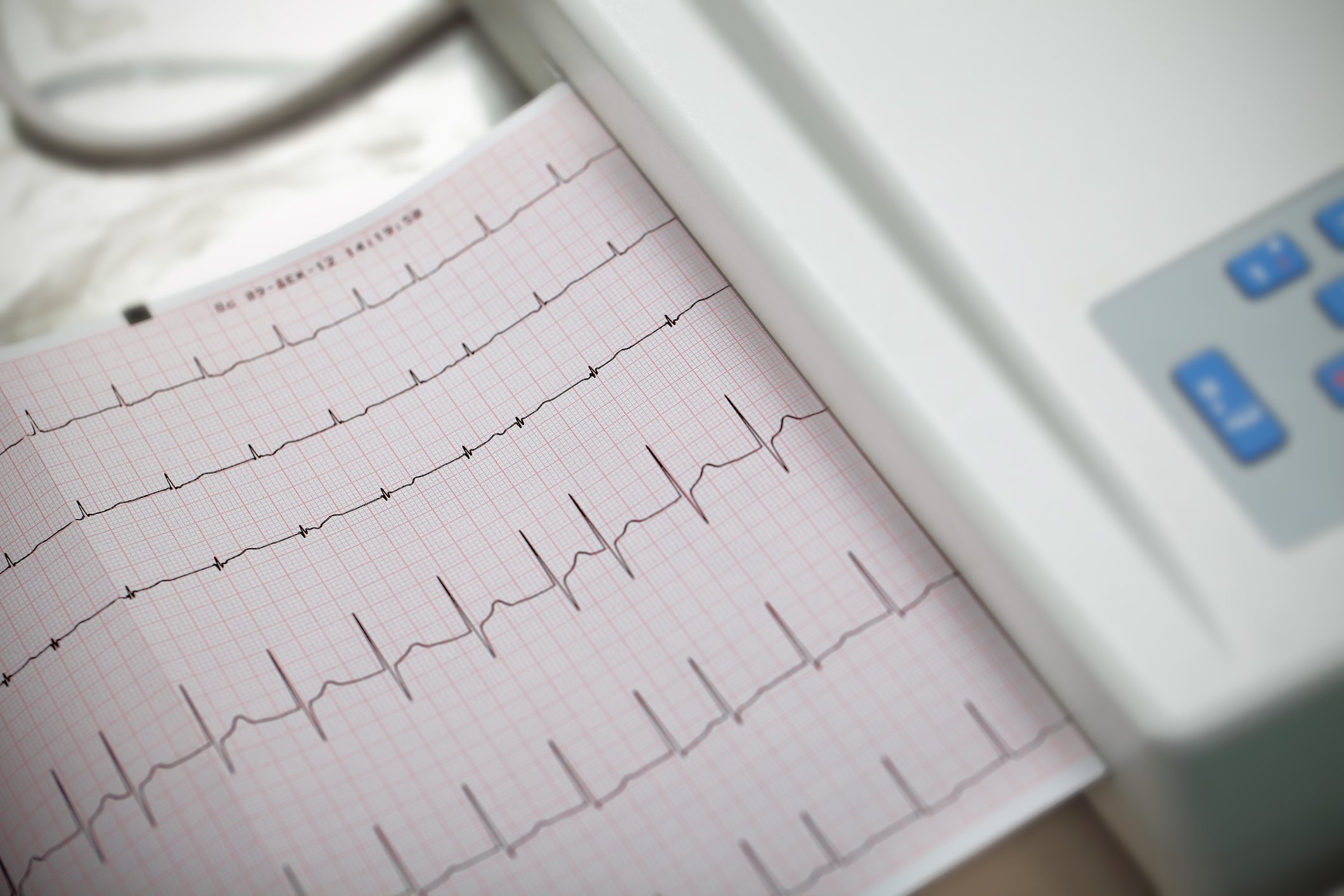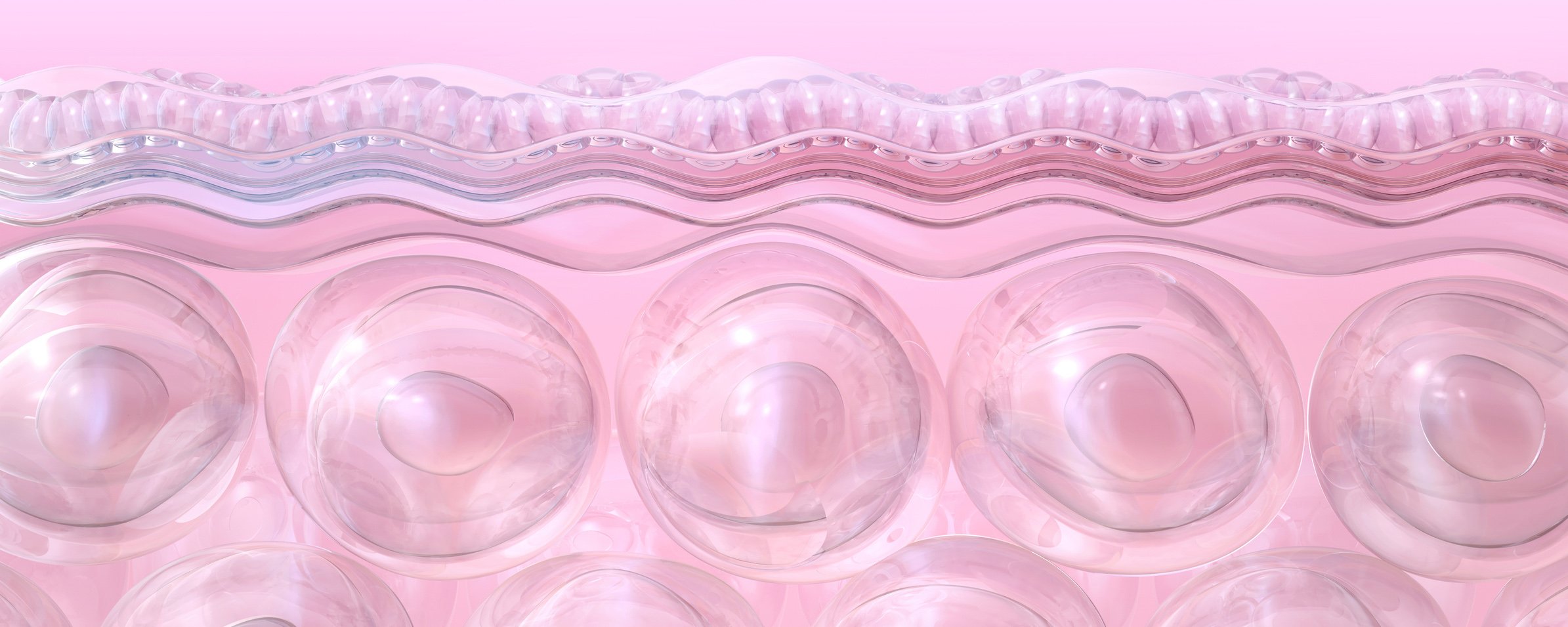Les chiffres de l’enquête suisse sur la santé 2012, une enquête effectuée par l’Office Fédéral de la Statistique, révèle que 5% de la population ont un diabète; ce chiffre néanmoins sous-estime la réalité puisque seules les personnes diabétiques diagnostiquées sont comptabilisées. On sait qu’environ 30% des patients qui ont un diabète l’ignorent. Par conséquent, les chiffres sont plus proches de 7%. L’enquête suisse sur la santé révèle aussi que la prévalence du diabète a augmenté en 15 ans; chez les hommes, seuls 3% se déclaraient diabétiques en 1997 alors qu’ils sont à 6% en 2012.
Chez les femmes, l’augmentation bien que moins importante, est aussi conséquente puisqu’en 1997, 3% des femmes se déclaraient diabétiques. En 2012, ce chiffre était à 4%. Il faut relever encore que la prévalence du diabète augmente considérablement avec l’âge tant chez l’homme que chez la femme. Chez l’homme, cette proportion augmente de trois à quatre fois entre les personnes de 45 à 54 ans et celles de 75 ans ou plus, atteignant une prévalence de 18%. Chez les femmes, la proportion augmente d’environ trois fois pour passer de 2,5% entre 45 et 54 ans à 8,5% au-delà de 75 ans.
La bonne nouvelle est que la population diabétique vit plus longtemps avec une mortalité cardiovasculaire qui a diminué au cours de ces dix dernières années. Ceci peut être mis sur le compte d’une meilleure prise en charge par les soignants. C’est dans ce contexte que ce numéro de CARDIOVASC est placé.
La Doctoresse Maria Mavromati fait tout d’abord le point sur les traitements médicamenteux du diabète de type 2 et offre une comparaison entre les anciens et nouveaux médicaments antidiabétiques. Les traitements évoluent mais la prise en charge reste difficile puisqu’elle est fortement conditionnée par les habitudes de vie qui ont de la peine à changer et même à s’adapter. L’accent des nouveaux traitements est surtout mis sur la diminution des effets secondaires comme les hypoglycémies et la prise de poids qui caractérisaient d’anciens traitements. Ce n’est pas pour autant que les anciens traitements n’ont plus leur place, bien au contraire. La metformine que l’on connaît depuis plus de 60 ans reste le premier traitement antidiabétique et pourrait avoir d’autres bénéfices sur les patients. La grande question est de savoir que rajouter à la metformine; actuellement le choix se fait surtout entre une sulfonylurée, le gliclazide et une gliptine dont quatre sont à choix pour le praticien. Le deuxième enjeu se situe souvent après l’échec thérapeutique d’une trithérapie par rapport au choix de l’insuline ou d’un analogue du GLP-1; les caractéristiques des patients sont déterminantes.
Une des complications les plus redoutées et redoutables chez le patient diabétique est la plaie au niveau du pied, particulièrement lorsqu’il existe une insuffisance artérielle des membres inférieurs et une neuropathie. Dans la grande majorité des cas, ce type de complication est évitable, mais elle reste fréquente et entraîne des coûts émotionnels et financiers énormes pour le patient et pour la société. Le Docteur Giacomo Gastaldi fait le point sur la prévention du pied à risque, sujet sur lequel tout médecin devrait apporter sa contribution. Cette prévention est simple; encore faut-il identifier les facteurs de risque.
Enfin, le Docteur Juan Ruiz aborde un des grands problèmes de la médecine contemporaine, le dépistage. En l’occurrence, la pertinence du dépistage d’une coronaropathie chez le patient diabétique. C’est une préoccupation quotidienne du médecin. Le dépistage coûte cher et il est donc légitime de savoir si il change le pronostic du patient diabétique. Comme vous le constaterez, la réponse n’est pas absolue, mais parfois trop n’est pas la solution.
Nous espérons que la lecture de ces articles consacrés au diabète vous amènera des informations utiles pour votre pratique et puisse bénéficier la prise en charge de vos patients. Bonne lecture!
Prof. Dr méd. Jacques Philippe
CARDIOVASC 2013; 12(6): 1