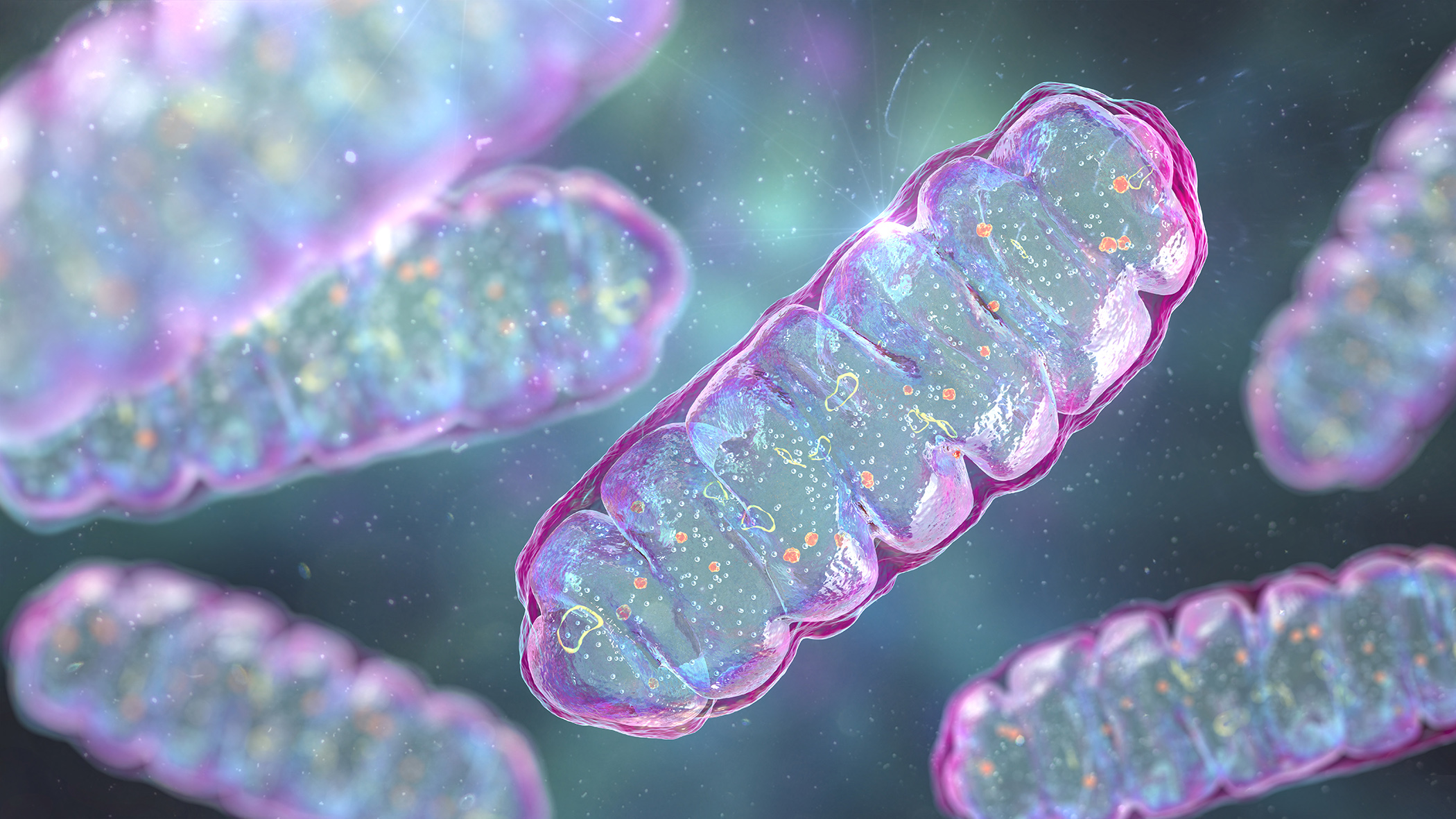Les hémopathies malignes telles que les leucémies ou les lymphomes représentent le quatrième type de cancer le plus fréquent et touchent environ 20/100 000 habitants par an en Europe. Un certain nombre de substances efficaces sont désormais disponibles pour une gestion personnalisée du traitement – mais la recherche se poursuit…
Les maladies malignes du système hématopoïétique, c’est-à-dire les lymphomes et les leucémies, ont pour origine la cellule souche de la moelle osseuse ou ses stades de développement. Aujourd’hui, la norme diagnostique comprend presque toujours une analyse des marqueurs de surface de la cellule tumorale, ainsi qu’un examen cytogénétique et de génétique moléculaire. Les conséquences pronostiques et thérapeutiques sont déduites en fonction des résultats. Les lymphomes sont divisés en lymphomes non hodgkiniens (LNH) et lymphomes hodgkiniens (LH). La fréquence des LNH, en particulier, a considérablement augmenté au cours des dernières années. Le LNH est également, et de loin, l’une des tumeurs malignes les plus fréquentes du système hématopoïétique. Des déficits immunitaires congénitaux ou acquis, des maladies auto-immunes et des maladies infectieuses ont été détectés comme facteurs de risque. Les premiers signes décrits sont des ganglions lymphatiques hypertrophiés et une splénomégalie. Le traitement de cette maladie extrêmement complexe dépend du type et du stade de la maladie.
Le myélome multiple est classé dans le groupe des LNH et est une maladie des lymphocytes B matures. Une seule cellule B transformée se multiplie de manière incontrôlée et produit toujours la même immunoglobuline – généralement des IgG ou des IgA. De grandes quantités de protéines sanguines supplémentaires sont ainsi produites, ce qui entraîne par la suite une glomérulopathie ou une tubulopathie avec un risque d’insuffisance rénale terminale. Les régimes contenant du bortézomib constituent actuellement la norme dans le traitement de première ligne. Une combinaison de bortézomib, de lénalidomide et de dexaméthasone est très souvent utilisée. Les chercheurs ont maintenant cherché à savoir si le carfilzomib, un inhibiteur du protéasome utilisé en deuxième intention, pouvait être utilisé tout aussi efficacement à la place du bortézomib. Cependant, dans l’étude randomisée de phase III, l’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone n’a pas permis de prolonger la survie sans progression. De plus, contrairement au traitement standard, elle a montré un taux plus élevé de toxicité cardiopulmonaire et rénale. Les chercheurs concluent donc que le bortézomib/lénalidomide/dexaméthasone doit rester la norme dans le traitement de première ligne du myélome multiple.
Immunothérapie dans le lymphome de Hodgkin
En revanche, la situation est différente pour le traitement du lymphome hodgkinien. Dans ce cas, une étude de phase III a évalué l’immunothérapie par le pembrolizumab, un inhibiteur de PD-1, par rapport au brentuximab vedotin (BV), le standard actuel, chez des patients atteints de lymphome hodgkinien classique en récidive ou réfractaire. En fait, l’inhibiteur de point de contrôle immunitaire s’est révélé comparativement plus efficace et moins toxique. Des avantages significatifs ont été observés en termes de PFS (13,2 vs. 8,3 mois ; p=0,0027) et d’ORR (65,6 vs. 55,2 pour cent ; p=0,02). De plus, les progressions précoces ou les arrêts de traitement dus aux effets secondaires étant moins fréquents, le traitement a été poursuivi deux fois plus longtemps dans le bras expérimental que dans le groupe témoin. Les investigateurs recommandent donc que le pembrolizumab devienne le nouveau standard dans cette indication.
Leucémie lymphoïde chronique
La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est la leucémie la plus fréquente chez l’adulte dans les pays occidentaux industrialisés et touche principalement les personnes âgées. Le premier symptôme est une lymphocytose sanguine avec de petits lymphocytes morphologiquement normaux. Le nombre de lymphocytes, au lieu des quelque 2000/μl de sang habituels, peut atteindre 200 000 cellules/μl avec une proportion de tous les leucocytes pouvant atteindre 95%, le diagnostic nécessitant au moins 5000 lymphocytes/μl de sang.
Pour les formes agressives et rapidement évolutives, des substances ciblées efficaces sont désormais disponibles pour le traitement. La norme dans le traitement de première ligne est la combinaison de la chimiothérapie et de l’immunothérapie. Entre-temps, en fonction de l’âge et de l’état général, le traitement peut être adapté individuellement. Les discussions actuelles visent à déterminer le rôle que jouent encore les chimiothérapies dans le contexte des substances efficaces et durables. C’est surtout dans les formes réfractaires que les scientifiques voient clairement l’avantage des nouvelles thérapies ciblées.
Source : ASCO20 Virtual
InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE 3/2020 ; 8(3) : 25 (publié le 20.6.20, ahead of print)