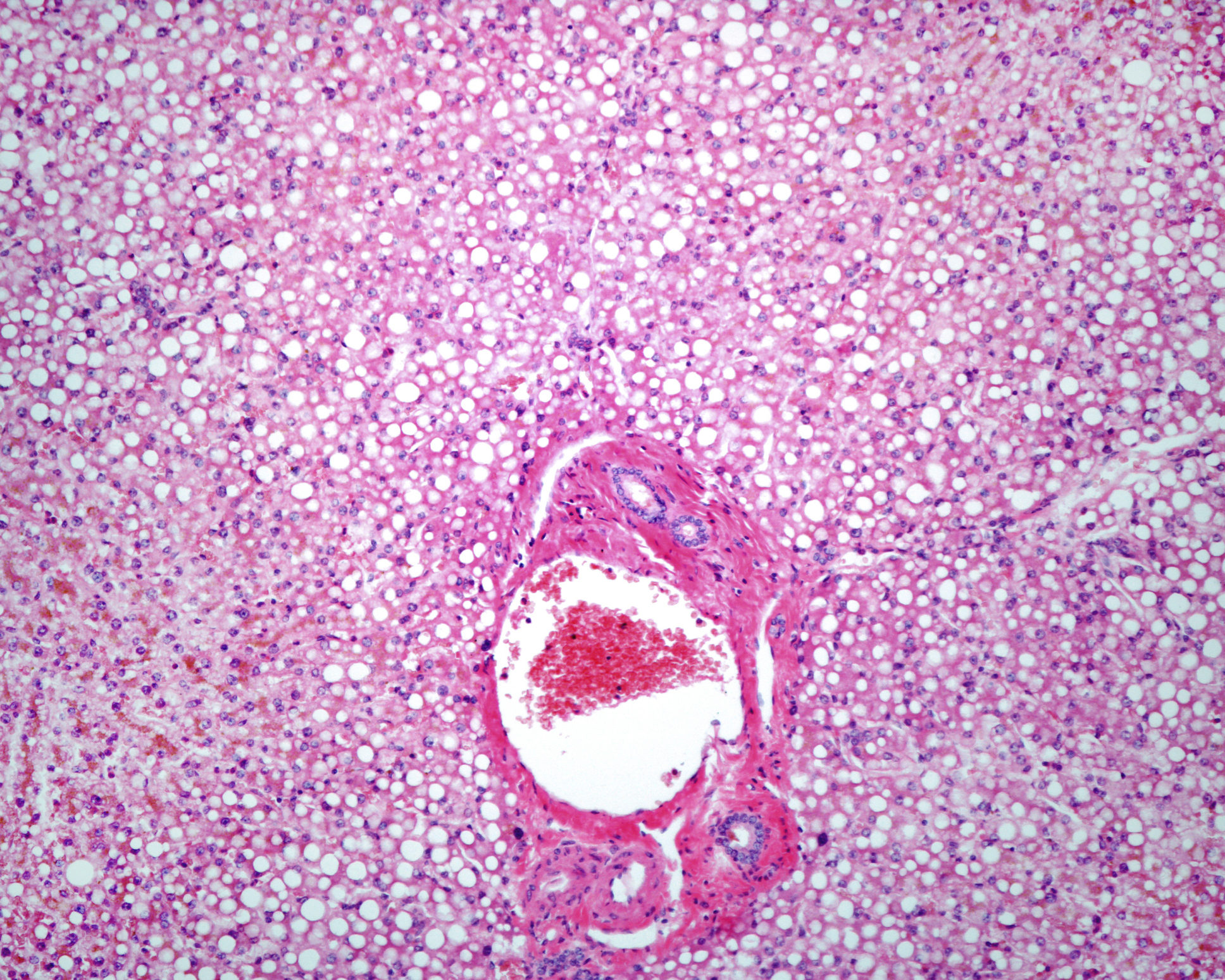Qu’est-ce qui a changé dans le traitement médicamenteux de l’épilepsie au cours des deux dernières années ? C’est ce qu’a expliqué le professeur Hamer d’Erlangen lors de la réunion annuelle des sociétés allemande et autrichienne d’épileptologie et de la Ligue suisse contre l’épilepsie.
Si au moins deux crises non provoquées se produisent à 24 heures d’intervalle, le diagnostic d’épilepsie peut être posé. Il en va de même pour une crise non provoquée, qui est associée à une probabilité de 60% de récidive dans les dix années suivantes (donc un risque de rechute aussi élevé qu’après deux crises) [1]. Toutefois, le risque de récidive de 60% est une donnée statistique difficile à appréhender sur le plan opérationnel. Dans une étude publiée en 2015, Lawn et ses collègues ont ainsi montré que ce risque dépendait fortement du temps : après seulement douze semaines sans crise, aucun des quelque 800 patients épileptiques étudiés ne répondait à ce critère de définition [2]. C’est pourquoi la ligne directrice allemande recommande une approche telle que celle illustrée dans la figure 1.

Quand recourir à un traitement médicamenteux ?
Un traitement après une seule crise d’épilepsie sans résultat supplémentaire n’est pas obligatoire, il n’est initié que si le patient le souhaite – par exemple s’il estime que l’exercice de sa profession est menacé. Pour le professeur Hajo Hamer du centre d’épilepsie de l’hôpital universitaire d’Erlangen (D), c’est le vécu individuel du patient qui compte : “Même si quelqu’un n’a que 30% de risque de récidive : Certains décident qu’ils ne veulent pas courir ce risque”.
Il est également justifié de commencer le traitement dès la première crise si les résultats de l’IRM/EEG ou les antécédents familiaux correspondants indiquent une épileptogénicité accrue. En fin de compte, la recommandation de traitement après une première crise reste une décision prise individuellement, en tenant compte du risque de rechute. En revanche, en cas de crises multiples, un traitement doit être mis en place. En l’absence de traitement, le risque de récidive augmente [1].
Le traitement médicamenteux par anticonvulsivants ne vise pas à “guérir” l’épilepsie, mais à lutter contre les symptômes. L’objectif prioritaire est l’absence de crises et, en même temps, une bonne tolérance au médicament. Les effets secondaires tels que les vertiges, la fatigue, la diplopie, les réactions d’hypersensibilité et les intolérances à long terme doivent être évités au maximum. Les nouveaux anticonvulsivants se distinguent par une meilleure tolérance et moins d’interactions [1,3].
Comparée à d’autres maladies chroniques du cerveau, l’épilepsie peut également être bien contrôlée à long terme. La moitié des patients adultes ne font plus de crises avec le premier médicament et 20% supplémentaires atteignent cet objectif après un changement de médicament. Mais en règle générale, les patients épileptiques doivent suivre un traitement médicamenteux tout au long de leur vie. Avec l’âge, il convient donc d’être plus attentif aux comorbidités ainsi qu’au potentiel d’interaction des médicaments [1].
Le cannabidiol est-il la “Silver Bullet” ?
Depuis quelques années, le cannabidiol (CBD) est étudié dans différents contextes thérapeutiques, notamment dans le traitement de l’épilepsie. Une étude multicentrique randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, récemment publiée, a attesté une efficacité significative du CBD dans le traitement des patients atteints du syndrome de Lennox-Gastaut (LGS). Les patients atteints de LGS, une forme d’épilepsie rare mais grave, sont souvent résistants aux traitements. L’administration de 20 mg/kg de CBD a montré une réduction moyenne de 43,9% des taux d’attaque mensuels chez les patients LGS (n=171) par rapport au placebo (21,8%). Des données à long terme sur l’efficacité et la sécurité sont en cours de collecte [4].
Le cannabidiol s’est également révélé efficace chez les patients atteints du syndrome de Dravet. Sous 20 mg/kg de CBD, la fréquence moyenne des crises convulsives est passée de 12,4 à 5,9, tandis qu’elle a été réduite de 14,9 à 14,1 dans le groupe placebo. La proportion de patients présentant une réduction d’au moins 50 % des crises convulsives était de 43 % sous CBD et de 27 % sous placebo. Sur les 120 patients étudiés, 5% n’ont pas eu de crises avec le CBD, contre 0% avec le placebo [5].
Hamer, même s’il attend avec intérêt l’autorisation européenne du cannabidiol pour le traitement du LGS et du Dravet. La substance active est déjà autorisée aux États-Unis. Il y a toutefois un hic. Le CBD est difficile du point de vue pharmacocinétique, car il a une action hépatique et est un inhibiteur enzymatique, ce qui peut entraîner des interactions indésirables avec d’autres médicaments.
L’espoir du perampanel
La recherche pharmacologique sur le traitement de l’épilepsie a peu évolué au cours des trois dernières années, à une exception près. Le professeur Hamer résume : “A l’avenir, nous devrons connaître cinq à six médicaments. Le pérampanel sera l’un d’entre eux”.
Le pérampanel est un antagoniste sélectif et non compétitif qui bloque spécifiquement les récepteurs AMPA. Ceux-ci sont responsables de la médiation du neurotransmetteur excitateur glutamate. Une étude observationnelle multicentrique rétrospective portant sur 149 patients atteints d’épilepsie généralisée idiopathique a recueilli des données du monde réel sur l’efficacité du perampanel pendant un an. Après 12 mois, l’absence de crises était de 59% pour toutes les crises, de 63% pour les crises tonico-cloniques, de 65% pour les crises myocloniques et de 51% pour les absences. La fréquence a également été réduite de manière significative par rapport à la ligne de base, de 78% (tonico-cloniques), 65% (myocloniques) et 48% (absences). Le perampanel a donc montré un effet pertinent indépendamment du syndrome épileptique concerné. Bien qu’il ait agi indépendamment des anticonvulsivants administrés en parallèle ou précédemment, l’absence de crises était plus élevée lorsque le médicament était administré en tant qu’add-on précoce. Environ la moitié des patients étudiés ont signalé des effets secondaires légers ou modérés tels que l’hypersensibilité, la somnolence et les vertiges [6].
Comme le lacosamide, le perampanel devrait donc devenir un jour l’un des rares anticonvulsivants à large spectre d’action. Actuellement, seuls le lévétiracétam, la lamotrigine, le valporate, le topiramate et le phénobarbital en font partie.
Mais l’étude n’a pas seulement montré un profil d’efficacité prometteur du pérampanel, elle a également montré que même de faibles doses permettent un bon contrôle des symptômes. “C’est tout à fait un changement de paradigme”, a déclaré le professeur Hamer. “Nous pouvons oser les faibles doses”.
Quelle est la meilleure combinaison ?
Dans les épilepsies focales, la lamotrigine et le lévétiracétam sont recommandés en première intention, car ils présentent un potentiel d’interaction plus faible et une meilleure tolérance. Cependant, il n’y a pas de différence significative d’efficacité avec l’oxcarbazépine, l’acétate d’eslicarbazépine, le lacosamide et le zonisamide. Les épilepsies généralisées sont traitées par l’acide valproïque conformément aux lignes directrices. La lamotrigine, le lévétiracétam (comme add-on), le perampanel et le topiramate peuvent également être utilisés [1].
Il n’existe toujours pas de preuve de la supériorité d’une combinaison par rapport à une autre. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé avec le perampanel (figure 2). Le duo lamotrigine/valporate constitue une exception. Cependant, il existe de faibles preuves que les combinaisons de substances actives ayant le même mécanisme d’action sont moins efficaces que celles ayant des mécanismes d’action différents [7]. Si des anticonvulsivants sont combinés, il convient d’être attentif aux potentiels d’interaction pharmacocinétique et pharmacodynamique. Le lévétiracétam est particulièrement bien adapté comme substance de départ, car il peut être combiné avec tous les anticonvulsivants autorisés. Le choix du traitement dépend non seulement de la situation individuelle du patient (souhaits du patient, comorbidités, co-médication, etc.), mais aussi de la situation des crises et des éventuels effets secondaires [1].

Évitez de changer de fabricant !
La pression sur les coûts dans le secteur de la santé oblige souvent à recourir à des médicaments génériques moins chers. Il faut toutefois tenir compte des différences de biodisponibilité entre les préparations. La biodisponibilité d’un médicament générique peut être de 25% supérieure à 20% inférieure à celle du médicament original. Si le patient passe d’un générique à l’autre, il risque de passer au-dessus ou en dessous de cette valeur. Pour éviter cela, le changement doit être préparé par une analyse minutieuse et le patient doit être informé des risques potentiels. Dans tous les cas, il est inadmissible de mettre en péril l’absence de crises pour des raisons financières [1].
Source : Conférence annuelle sur l’épilepsie 2019, Bâle
Littérature :
- Elger CE, et al. : Ligne directrice S1. Première crise d’épilepsie et épilepsies de l’adulte. 2017. www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/030-041.html, dernière consultation 28.05.19.
- Lawn N, et al. : Est-ce que le premier épisode épileptique – et quand ? Epilepsia 2015 ; 56(9) : 1425-1431.
- Perucca P, Gilliam FG : Effets indésirables des médicaments antiépileptiques. Lancet Neurol 2012 ; 11(9) : 792-802.
- Thiele EA, et al. : Cannabidiol in patients with seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (GWPCARE4) : a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet 2018 ; 391(10125) : 1085-1096.
- DevinskyO, Cross JH, Wright S : Essai de cannabidiol pour les seizures résistants aux drogues dans le syndrome de Dravet. N Engl J Med 2017 ; 377(7) : 699-700.
- Villanueva V, et al. : Perampanel in routine clinical use in idiopathic generalized epilepsy : The 12-month GENERAL study. Epilepsia 2018 ; 59(9) : 1740-1752.
- Margolis JM, et al : Efficacité de la thérapie combinée de médicaments antiépileptiques pour les seizures partielles-onset basée sur les mécanismes d’action. JAMA Neurol 2014 ; 71(8) : 985-993.
- Mølgaard-Nielsen D, Hviid A : Médicaments antiépileptiques de nouvelle génération et risque d’anomalies congénitales majeures. JAMA 2011 ; 1996-2002.
- Tomson T, et al : Risque comparatif de malformations congénitales majeures avec huit médicaments antiépileptiques différents : une étude de cohorte prospective du registre EURAP. Lancet Neurol 2018 ; 17(6) : 530-538.
InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2019 ; 17(4) : 26-27 (publié le 20.6.19, ahead of print)