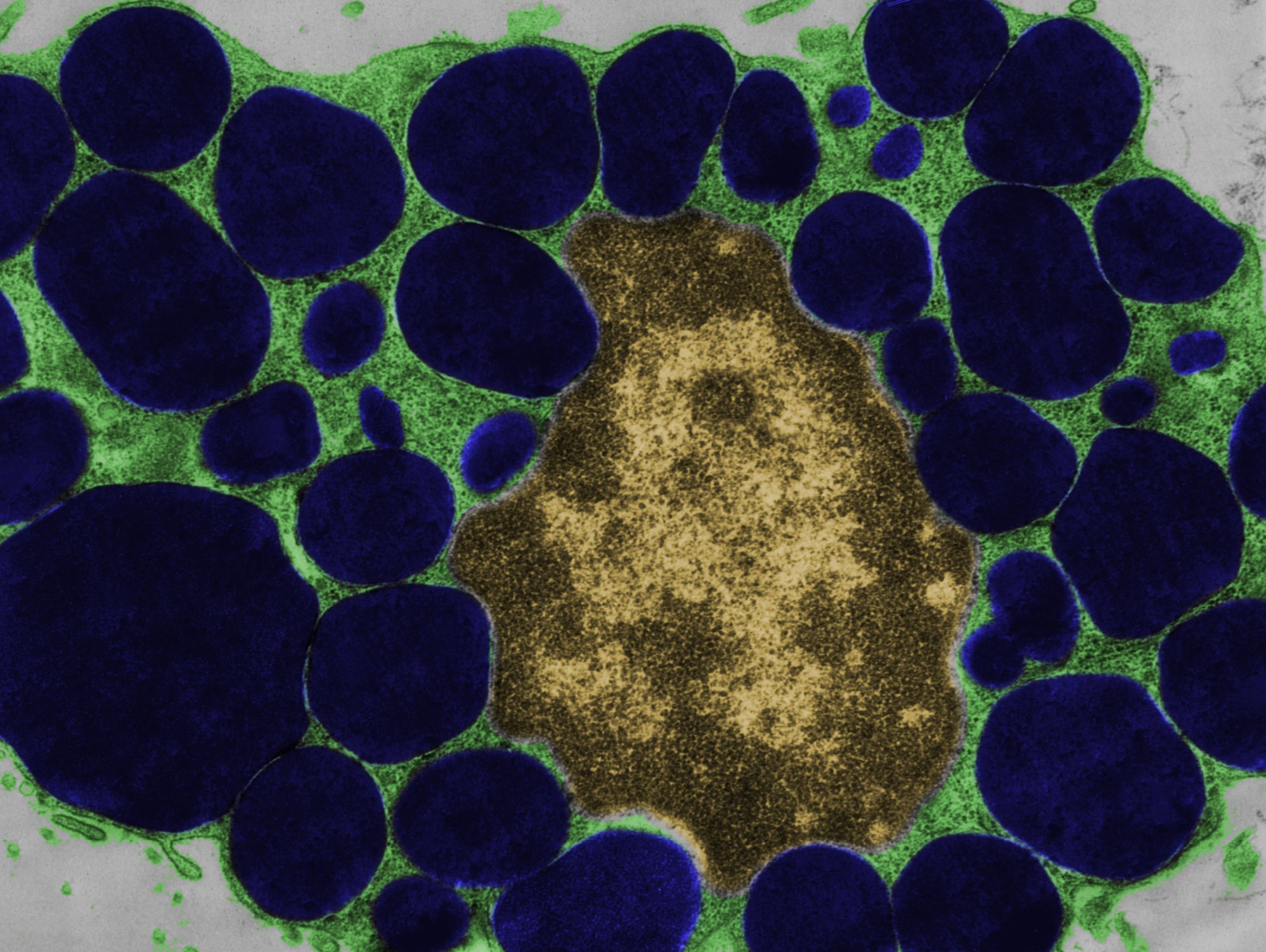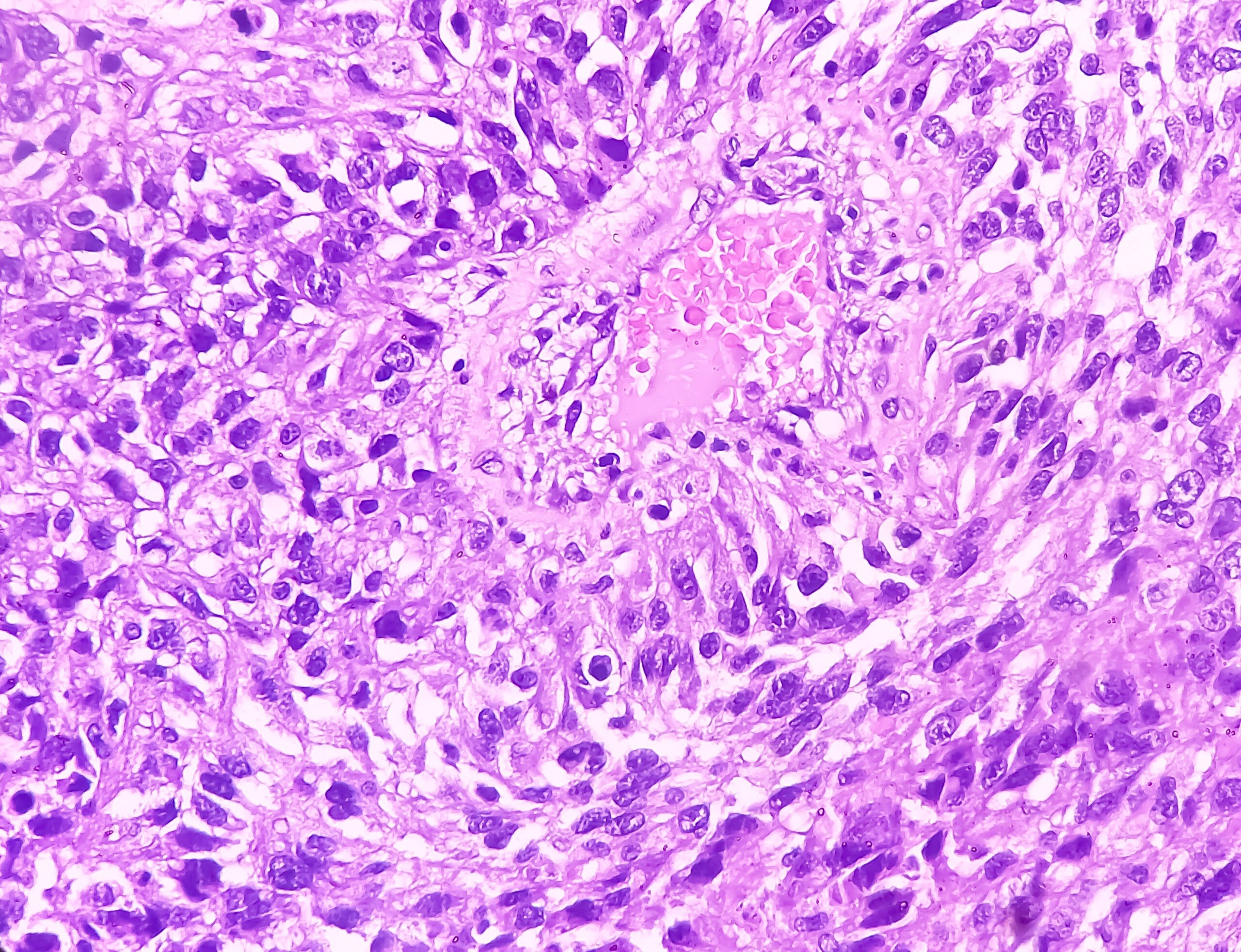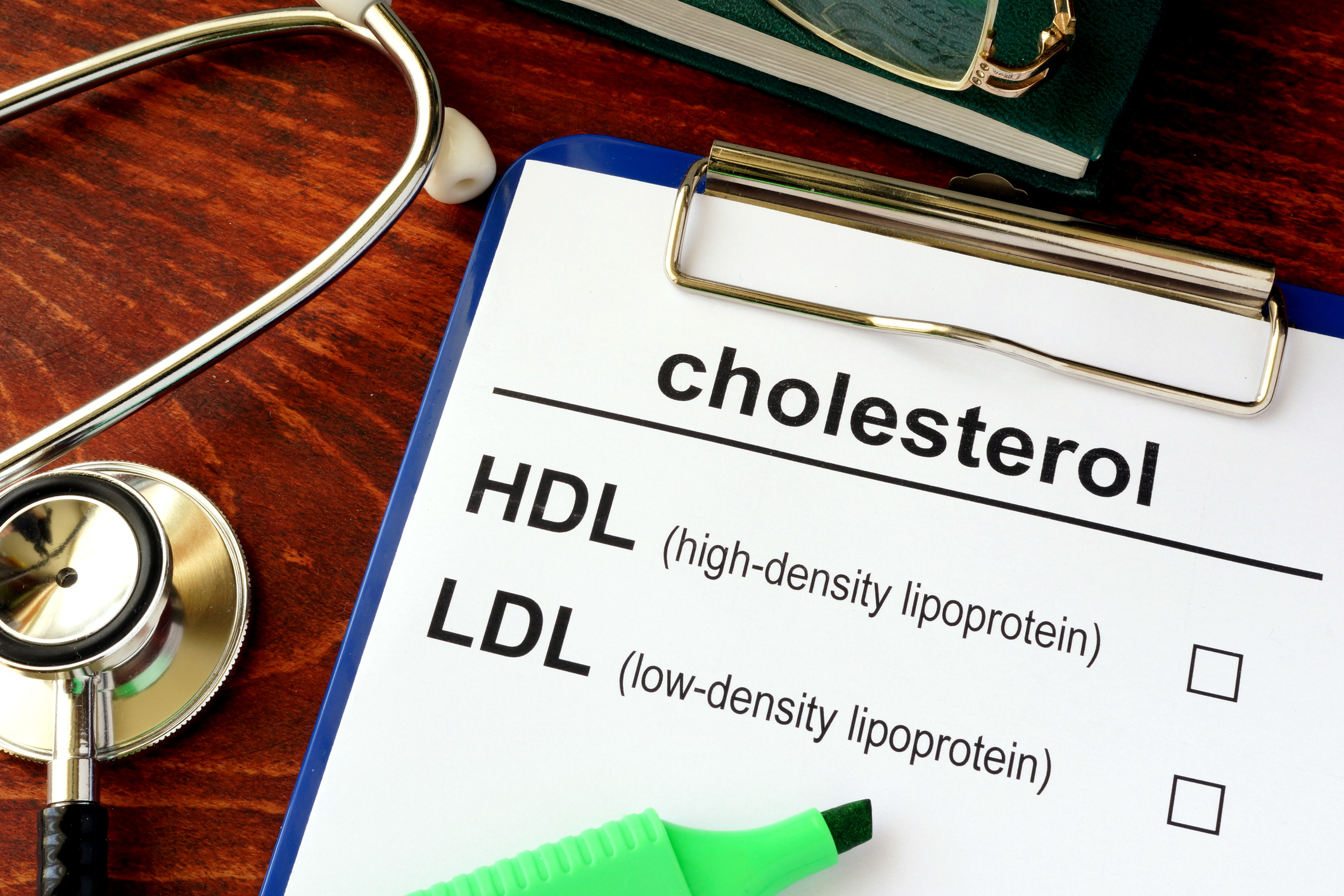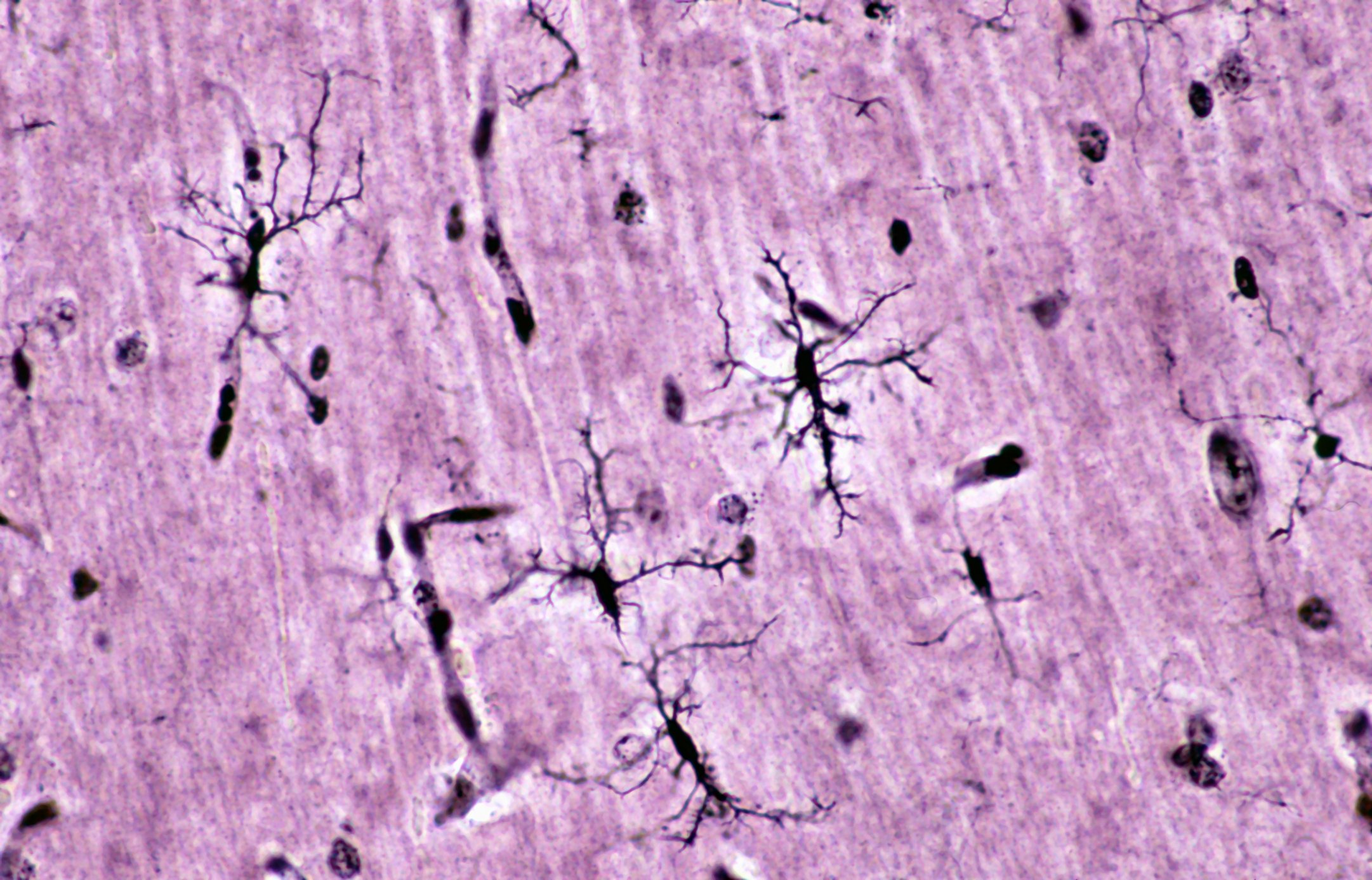La transformation numérique est en marche. Des recherches intensives sont menées sur les nouvelles applications de la réalité virtuelle. La psychiatrie, en particulier, pourrait tirer profit de la nouvelle technologie. Les addictions et le TDAH, souvent comorbide, ont des options diagnostiques et thérapeutiques limitées. De nouvelles voies numériques peuvent-elles être explorées dans ce domaine ?
Les modes de vie virtuels occupent une place de plus en plus importante. Depuis longtemps, l’immersion assistée par ordinateur et la présence virtuelle ont quitté le monde du jeu pur. La science fait elle aussi de plus en plus souvent appel à ce monde d’expérience. La réalité virtuelle (VR) permet d’étudier la perception de soi et du corps, les situations sociales et l’expérience des espaces ou des contextes. Les possibilités sont nombreuses, a montré Kornelius Kammler-Sücker, Mannheim (D). Il est ainsi possible de standardiser les expériences, d’augmenter la motivation à l’aide du caractère ludique, d’utiliser des techniques d’imagination dans un cadre protégé et de permettre des situations impossibles. A l’avenir, la numérisation de la société conduira les individus à évoluer de plus en plus dans des environnements virtuels. Toutefois, cela peut aussi comporter des risques, en particulier dans le contexte psychiatrique. En effet, l’environnement généré par le numérique ne doit pas se substituer à l’environnement physique et social réel. De plus, la science n’en est qu’à ses débuts et les résultats sont souvent difficiles à interpréter. Une interdisciplinarité critique est ici nécessaire pour exploiter les avantages des nouvelles voies de traitement sans laisser de place aux inconvénients. Mais il est certain que cela en vaut la peine.
Traitement des addictions interdisciplinaire
La consommation de tabac est sans aucun doute l’une des addictions les plus courantes. Chaque année, il cause la mort de huit millions de personnes dans le monde. Même après avoir arrêté de fumer, l’abstinence durable est rare. En d’autres termes, le taux de récidive est élevé. Les mesures thérapeutiques visant à augmenter le taux d’abstinence sont toutefois très limitées. En effet, les mécanismes psychologiques et biologiques qui sous-tendent le comportement tabagique dans le contexte de facteurs environnementaux divergents ne sont pas encore suffisamment compris. Les résultats d’études suggèrent que les fumeurs sont plus susceptibles de prendre une cigarette lorsqu’ils sont en présence d’autres personnes qui fument. En revanche, les personnes présentes non-fumeuses réduisent la probabilité de fumer. Katharina Eidenmüller, Mannheim (D), a constaté que l’envie implicite de fumer, le comportement d’approche et le biais d’attention vis-à-vis des stimuli liés à la cigarette, ainsi que le craving explicite et les processus hormonaux pourraient être les médiateurs de ces relations.
Parmi les médiateurs possibles, on trouve notamment une hypersensibilisation aux effets incitatifs de la motivation. L’augmentation du wanting de la substance est due à des changements dans les systèmes dopaminergiques pertinents pour la motivation. En outre, le biais attentionnel joue également un rôle. L’attention automatiquement sélective portée aux stimuli associés à la substance est un prédicteur important des résultats d’un objectif d’abstinence tabagique. Le biais d’approche constitue le troisième aspect. Il définit la tendance automatique d’approche vers des stimuli associés à une substance et peut être mesuré à l’aide de la tâche d’évitement d’approche. En outre, dans le contexte du stress et des interactions sociales, il existe des hormones pertinentes qui servent de médiateurs entre les facteurs environnementaux et le comportement. Il s’agit par exemple du cortisol, de l’arginine-vasopressine et de l’ocytocine.
Que peut faire VR que la vie normale ne peut pas faire ?
Il existe des outils permettant d’étudier tous ces médiateurs. Pourquoi la RV devrait-elle entrer en jeu ? L’une des raisons est la grande validité écologique associée à une grande capacité de standardisation, selon l’experte. De plus, le craving pour les cigarettes peut être généré dans la simulation et ne doit pas être consommé réellement. En effet, l’environnement VR avec des repères de fumée génère des pensées et le tabagisme et une attention accrue aux stimuli associés à la cigarette. Par exemple, il a été constaté que les interactions avec des avatars fumeurs dans les salles de RV déclenchaient un craving plus important que dans les cues fumeurs sans avatars. C’est ce que cherche à savoir une étude qui vient d’être lancée. L’étude examine les hypothèses selon lesquelles la présence d’un avatar fumeur déclenche chez les fumeurs un désir implicite de cigarettes plus important, une tendance plus forte à se rapprocher des stimuli liés à la cigarette, un biais attentionnel plus fort et un craving plus important pour une cigarette. Après avoir fumé une cigarette, on s’attend à ce que ces mêmes médiateurs diminuent. De même, on s’attend à ce que la vasopression de l’arginine diminue, alors que le cortisol et l’ocytocine augmentent.
Aide au diagnostic et au traitement du TDAH adulte
La réalité virtuelle peut également apporter un soutien dans le cadre de la gestion du diagnostic et du traitement du TDAH adulte. En effet, bien que le TDAH soit défini par l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité, ces symptômes ne peuvent souvent pas être détectés ou traités par les méthodes neuropsychologiques courantes, a expliqué le Dr. med. Niclas Braun, Bonn (D). La cause de ce paradoxe est probablement la faible validité écologique des méthodes neuropsychologiques existantes. La RV permet de créer un environnement de test proche de la réalité et pertinent pour les symptômes, tout en restant hautement standardisable. Inspiré des environnements de classe virtuelle pour les enfants atteints de TDAH, un environnement de salle de séminaire virtuelle pour les adultes atteints de TDAH peut être utilisé, entre autres, pour une caractérisation multimodale de l’inattention et de l’impulsivité. Dans une étude feasibility portant sur 26 sujets sains, les performances aux tests, l’échantillonnage d’expérience, les ratios thêta-bêta EEG, les amplitudes P300 EEG et les mouvements/rotation de la tête ont été examinés, entre autres. Les sujets ont effectué une tâche de performance continue directement dans la salle de séminaire virtuelle, tandis que différents événements distrayants étaient diffusés simultanément. Il s’est avéré qu’il était possible d’étudier simultanément la performance comportementale, l’EEG et l’actigraphie en RV. De plus, les contrôles sains ont bien toléré cette configuration et ont été compliant. L’étape suivante consiste à tester le paradigme sur des patients atteints de TDAH.
Source : “Les technologies de réalité virtuelle dans la (recherche) thérapie de la dépendance et du TDAH”, 27.11.2021
Congrès : dgppn 2021
InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2022 ; 20(1) : 30-31