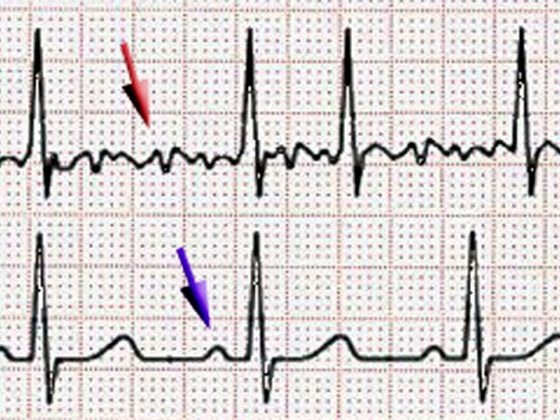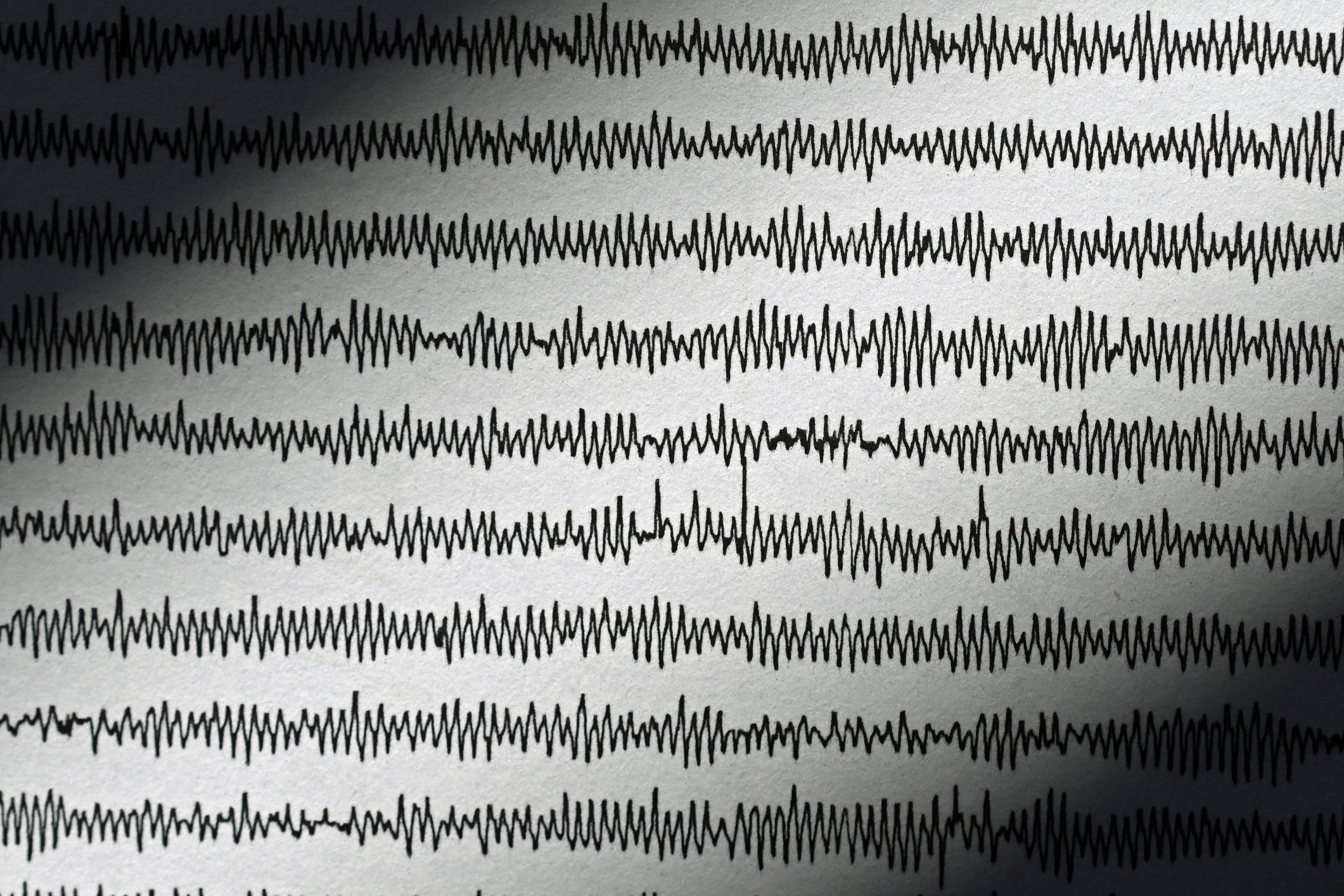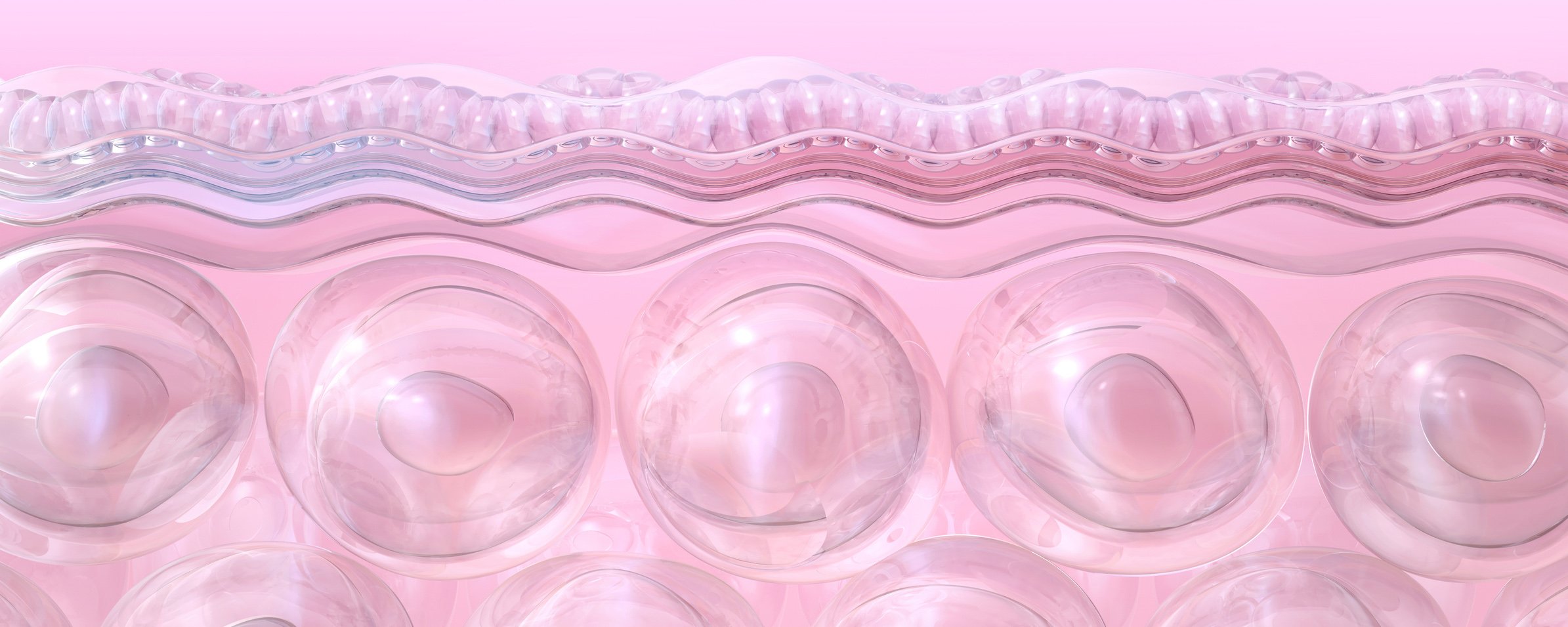Lors du congrès de l’EHA à Milan, des experts ont discuté des possibilités de traitement pour les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë. Les patients âgés, en particulier, continuent d’avoir un mauvais pronostic sous chimiothérapie intensive. De même, la transplantation de cellules souches allogéniques n’est ici envisagée que dans des cas sélectionnés. Ce qui reste, c’est la chimiothérapie palliative. Quels succès peut-on espérer ici ?
La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est un sous-type de leucémie qui prend naissance dans la moelle osseuse et se propage rapidement dans le sang et d’autres parties du corps. On peut distinguer différentes formes de LAM, en fonction du stade de maturité des cellules cancéreuses au moment du diagnostic et de la différence par rapport aux cellules normales. La LMA est principalement une maladie de la vieillesse et est légèrement plus fréquente chez les hommes. La pathogenèse est en grande partie inconnue. On trouve souvent des mutations de l’ADN dans les cellules LAM, qui pourraient être dues, entre autres, à des radiations ou à des substances chimiques. Les facteurs de risque possibles sont donc
- Exposition aux rayonnements
- Traitement antérieur par chimiothérapie ou radiothérapie
- Traitement antérieur pour la leucémie lymphoïde aiguë de l’enfant
- le tabagisme, surtout après 60 ans
- une maladie sanguine antérieure telle que les syndromes myélodysplasiques
- Certains troubles génétiques tels que le syndrome de Down, l’anémie de Fanconi, le syndrome de Shwachman et le syndrome de Diamond Blackfan.
Deux approches thérapeutiques principales sont utilisées pour traiter la LAM : la chimiothérapie et la greffe de cellules souches/moelle osseuse. 2013 a marqué le 40e anniversaire du schéma dit 3+7 : cytarabine et une anthracycline dans le traitement d’induction. “Les jours 1 à 3, la daunorubicine est administrée, par exemple, à la dose standard de 45 mg/m2, et les jours 1 à 7, la cytarabine est administrée, par exemple, à la dose de 100 mg/m2. sont administrées. Peu d’approches thérapeutiques des maladies malignes ont été aussi constantes que celle-ci. Cette longévité est due à la constellation de modèles génétiques dans la LAM, qui pourrait expliquer le manque de succès de nombreuses nouvelles approches. Les essais randomisés contrôlés actuels sont-ils donc suffisamment convaincants pour changer le statu quo ?”, telle est la question posée par le professeur Adriano Venditti, Rome, lors du congrès de l’EHA à Milan.
Le traitement d’induction, qui vise à détruire toutes les cellules leucémiques dans la moelle osseuse et le sang, est suivi d’un traitement post-rémission pour prévenir la récidive. Celle-ci est déterminante pour la survie à long terme sans maladie.
Que faire chez les patients âgés ?
La limite entre les patients “âgés” et “jeunes” atteints de LAM est souvent fixée à 60 ans. La chimiothérapie intensive a un bien meilleur pronostic chez les patients jeunes que chez les patients plus âgés : Cela est principalement dû à certaines caractéristiques de risque de cette seconde population. Par exemple, on y trouve une prévalence plus élevée de constellations cytogénétiques de mauvais pronostic ou la surexpression de gènes qui conditionnent la résistance aux médicaments. En outre, les comorbidités et les toxicités attendues peuvent être des contre-indications à la chimiothérapie intensive. L’allogreffe de cellules souches est également associée à une augmentation de la mortalité et de la morbidité chez les patients âgés. Elle n’est donc envisageable que pour des personnes sélectionnées et peu nombreuses dans cette population. En fin de compte, l’âge lui-même reste un facteur pronostique indépendant dans la LAM.
Des substances telles que l’azacitidine ont donc été étudiées en tant que chimiothérapie palliative pour les patients âgés atteints de LMA faiblement proliférative (blastes de la moelle osseuse ≤30%). Il s’est rapidement imposé comme la norme pour les personnes âgées atteintes de LAM, présentant 20 à 30% de blastes dans la moelle osseuse et une dysplasie multiligne, et ne pouvant être traitées de manière intensive. Des recherches sont en cours pour déterminer si l’azacitidine est également efficace chez les patients LAM âgés ayant plus de 30% de blastes dans la moelle osseuse ou si elle a un effet supplémentaire en combinaison avec la chimiothérapie intensive.
L’une de ces études multicentriques randomisées de phase III a également été présentée au congrès de l’EHA : l’étude AML-001 [2]. Elle a étudié l’effet de l’azacitidine par rapport aux régimes conventionnels chez des patients présentant une LAM de novo ou secondaire (>30% de blastes de la moelle osseuse) nouvellement diagnostiquée. Les participants étaient âgés de plus de 65 ans et n’étaient pas éligibles pour une greffe de cellules souches allogéniques. Avant la randomisation, les 488 patients ont chacun été assignés à l’un des trois régimes conventionnels (choix du meilleur traitement individuel) : chimiothérapie intensive (3+7), cytarabine à faible dose ou “meilleurs soins de support” (BSC). Ils ont ensuite été randomisés pour recevoir
Groupe 1 (n=241) : Azacitidine (75 mg/m2/jour, par voie sous-cutanée pendant sept jours à chaque cycle de 28 jours)
Groupe 2 (n=247) : le régime conventionnel sélectionné précédemment (45 ont reçu la BSC, 158 la cytarabine à faible dose et 44 la chimiothérapie intensive).
Résultats : Le critère d’évaluation principal était la survie globale, dont la médiane était de 10,4 mois dans le groupe 1 et de 6,5 mois dans le groupe 2 (p=0,829). Alors que ce point n’a donc pas atteint la significativité statistique, une analyse de sensibilité pré-spécifiée a montré un bénéfice significatif pour la survie globale : 12,1 vs 6,9 mois (p=0,019). La survie à 1 an était de 47 vs. 34% pour l’azacitidine et l’azacitidine, respectivement. pour les régimes conventionnels.
Selon le Dr Hervé Dombret, Paris, responsable de l’étude, il s’agit des meilleures données de survie globale et à 1 an observées à ce jour sous un traitement de faible intensité pour les patients âgés atteints de LAM. Les effets indésirables hématologiques de grade 3 et 4 étaient plus fréquents avec l’azacitidine qu’avec la BSC et aussi fréquents qu’avec les deux autres régimes conventionnels.
Source : Congrès EHA 2014, 12-15 juin 2014, Milan
Littérature :
- Fenaux P, et al : L’azacitidine prolonge la survie globale par rapport aux régimes de soins conventionnels chez les patients âgés atteints de leucémie myéloïde aiguë à faible taux de blast de la moelle osseuse. J Clin Oncol 2010 Feb 1 ; 28(4) : 562-569.
- Dombret H, et al : Résultats d’une étude de phase 3, multicentrique, randomisée, en ouvert, de l’azacitidine (aza) vs les régimes de soins conventionnels (ccr) chez les patients âgés atteints de leucémie myéloïde aiguë (aml) nouvellement diagnostiquée. EHA 2014 #Abstract LB2433.
SPÉCIAL CONGRÈS 2014 ; 44-46