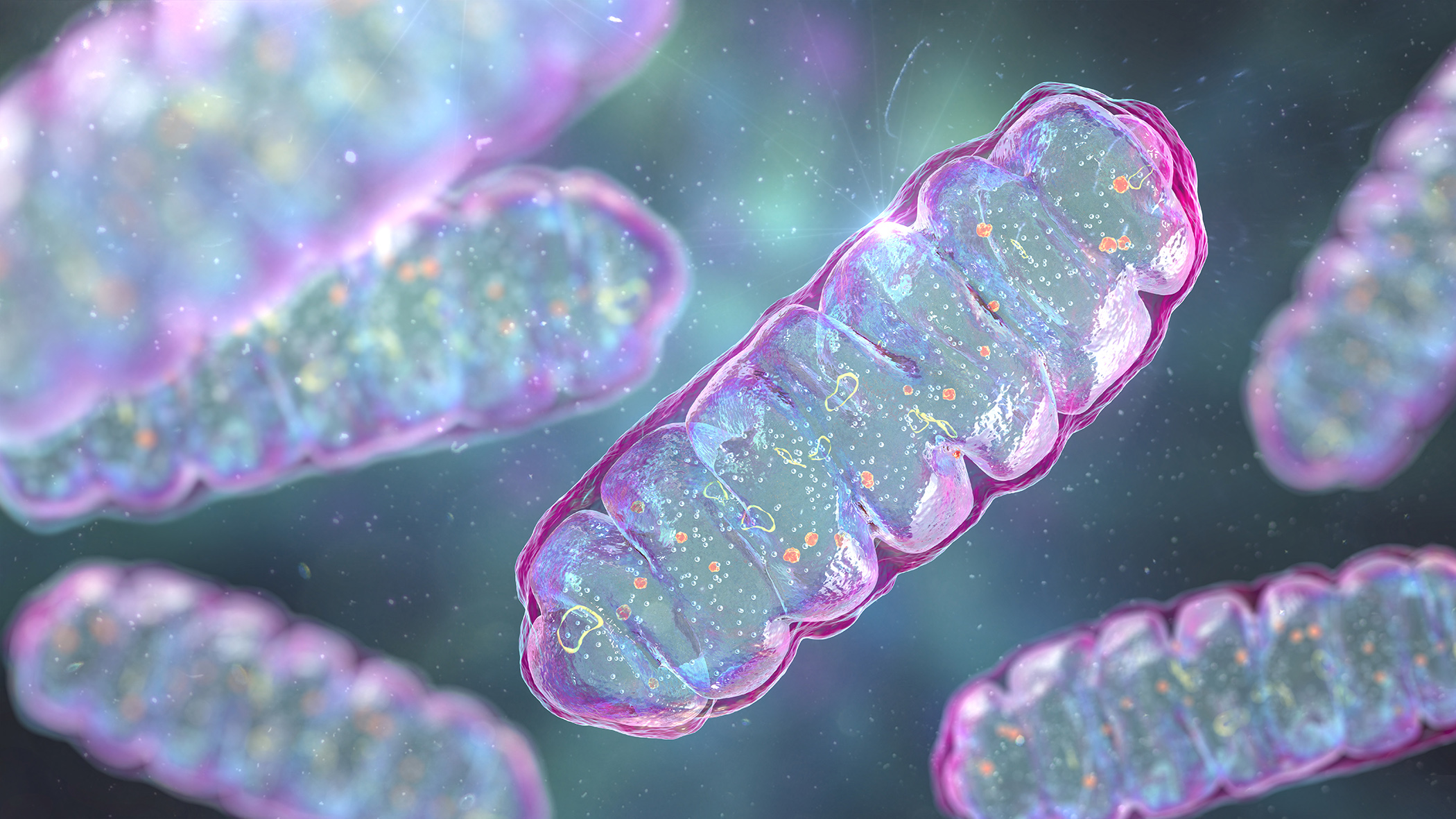Avec une prévalence au cours de la vie pouvant atteindre 30%, les vertiges sont un symptôme très fréquent dans les consultations de différentes disciplines, de l’ORL au neurologue en passant par le médecin généraliste. Il n’existe pas de traitement idéal pour tous les types de vertiges. Les concepts thérapeutiques s’orientent plutôt étroitement vers la physiopathologie : la combinaison de la thérapie physique, c’est-à-dire des exercices d’équilibre, et de la thérapie médicamenteuse varie selon la cause de la maladie.
La névrite vestibulaire, également appelée vestibulopathie unilatérale aiguë, décrit une défaillance aiguë unilatérale d’un organe de l’équilibre dans l’oreille interne. Cette défaillance entraîne fonctionnellement un déséquilibre du tonus vestibulaire, “la balance bascule donc et un déséquilibre apparaît”, comme l’a illustré le PD Dr Andreas Zwergal, Deutsches Schwindel- und Gleichichtszentrum & Neurologische Klinik, Ludwig-Maximilians-Universität München [1]. En raison des projections des impulsions d’équilibre vers l’œil, la moelle épinière, le cortex cérébral ou les régions de déclenchement des nausées, il en résulte un syndrome complexe, à savoir le syndrome vestibulaire aigu, qui se caractérise par différents symptômes :
- déséquilibre vestibulo-perceptif : vertige rotatoire
- déséquilibre vestibulo-oculaire : nystagmus
- déséquilibre vestibulo-spinal : tendance à la chute
- déséquilibre végétatif : nausées/vomissements
On pense que la cause est une inflammation de l’afférence d’équilibre, peut-être due à la réactivation de virus herpès dans la zone de la partie vestibulaire du 8e nerf crânien. Cependant, la cascade de symptômes du déséquilibre vestibulaire aigu s’améliore généralement spontanément en quelques jours ou semaines chez les personnes en bonne santé.
Différentes approches thérapeutiques
En ce qui concerne le traitement pharmacologique, il convient de distinguer différentes approches. Sur le plan symptomatique, le Dr Zwergal conseille d’administrer initialement des antivertigineux (par exemple le dimenhydrinate). “En phase aiguë, lorsque le patient souffre de nausées sévères, par exemple”. L’expert a toutefois fait remarquer que “l’administration de médicaments supprimant les symptômes entrave le processus de compensation vestibulaire centrale. C’est pourquoi les médicaments ne doivent être donnés qu’en cas de besoin et pour une courte durée, 3 jours maximum”. En tant que Thérapie causale des corticostéroïdes (p.ex. méthylprednisolone p.o.) peuvent être envisagés pour réduire la réaction de gonflement dans le nerf. Il n’est toutefois pas judicieux de commencer le traitement après le cinquième jour de l’ensemble des symptômes. L’étape suivante consiste à trouver un moyen d ‘aider la compensation vestibulaire, c’est-à-dire la sensibilité du cerveau à réagir de manière plastique à cette défaillance. Ce que l’on recherche, c’est donc une thérapie de neuroenhancement qui soutienne la plasticité physiologique. L’extrait de ginkgo biloba EGb 761 a été bien étudié à cet égard, et il existe au moins des preuves de laboratoire pour la bétahistine et l’acétyleucine.
Syndromes vertigineux épisodiques
Les quatre syndromes vertigineux épisodiques les plus fréquents sont le vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB), la maladie de Menière, la migraine vestibulaire et la paroxysmie vestibulaire.
Le vertige positionnel bénin est connu pour être facilement diagnostiqué par des manœuvres positionnelles et sous les lunettes de Frenzel sous la forme d’un nystagmus positionnel typique. Ce syndrome est dû à l’éclatement de cristaux de calcium/calcite qui tombent des organes otolithiques, sont entraînés dans les canaux semi-circulaires et provoquent une irritation des organes sensoriels dans l’extrémité aveugle du canal semi-circulaire lors d’un changement de position de la tête. L’ensemble est perçu par le patient comme un vertige rotatoire. Certains collègues se demanderont certainement dans quelle mesure le VPPB est accessible à une quelconque forme de traitement pharmacologique. “Bien sûr, le vertige positionnel bénin est d’abord le domaine de la thérapie physique”, a également déclaré le Dr Zwergal. Il a toutefois abordé un aspect qui a été récemment décrit à nouveau dans une grande étude sud-coréenne : Une substitution en vitamine D et en calcium pourrait constituer une prévention des récidives chez les patients qui se plaignent de crises récurrentes de vertiges positionnels bénins.
En fait, l’effet sur l’ensemble du groupe ne s’est avéré que très modéré, dit-il. Dans des sous-groupes, il a toutefois été démontré que les patients >65 ans et ceux qui présentaient un taux sérique de vitamine D réduit (<20 mg/ml) ou une ostéoporose bénéficiaient particulièrement de ce traitement. Sur la base de ce constat, le neurologue a conseillé d’envisager cette prophylaxie des récidives par la vitamine D, en particulier chez les patients âgés qui se plaignent de VPPB récurrents.
La maladie de Menière est une maladie qui se caractérise par l’apparition simultanée de signes audiologiques et vestibulaires. Le contexte pathomorphologique est celui d’un hydrops endolymphatique, c’est-à-dire d’une congestion du liquide endolymphatique de l’oreille interne, qui peut désormais être visualisé de manière renforcée par imagerie au moyen de procédés IRM et de produits de contraste. La maladie est définie par la survenue d’au moins deux crises au cours desquelles des symptômes auditifs et des vertiges sont présents pendant au moins 20 minutes et, si possible, une perte de seuil des moyennes et basses fréquences doit également être détectée par audiométrie. Les patients se plaignent de crises récurrentes de vertiges rotatoires, de pertes d’audition, d’acouphènes et de sensations de plénitude dans l’oreille.
Il existe différents principes thérapeutiques pharmacologiques pour cela : par voie systémique, la bétahistine s’impose en premier lieu. “Il est important de se rappeler ici qu’une administration à haute dose d’au moins 3× 48 mg/j sur une période >6-12 mois serait importante, car la biodisponibilité orale est problématique”, a expliqué le Dr Zwergal. Cela serait dû au mécanisme de premier passage associé à la voie de l’enzyme MAO. Il faut en outre reconnaître que les études sur ce produit sont hétérogènes, une grande étude prospective étant effectivement négative par rapport au placebo. L’expérience clinique est toutefois positive, de sorte que l’expert espère que d’autres formulations du groupe actif de la bétahistine seront testées à l’avenir, soit via des préparations à libération prolongée, soit via des préparations intranasales, afin de voir si l’effet serait mieux classé avec une meilleure biodisponibilité.
Les alternatives à la bétahistine sont les traitements topiques, par exemple les corticostéroïdes par voie intratympanique, mais là encore, les études sont hétérogènes. La gentamicine n’est conseillée qu’en dernier recours, plutôt comme procédure de réserve, car son utilisation est une procédure destructrice : En fin de compte, les cellules ciliées du labyrinthe sont désactivées, ce qui réduit les vertiges. En revanche, il existe un risque de perte d’audition dans l’oreille concernée. Et bien sûr, il ne faudrait traiter qu’une oreille à la fois (comme pour les glucocorticoïdes). “Car la maladie de Menière change souvent de côté au cours de son évolution”.
Bonne réponse thérapeutique
La migraine vestibulaire se présente comme un couplage de syndromes de vertiges et de céphalées. Elle peut survenir à différents âges, souvent chez les enfants, mais aussi au cours de la 4e-5e décennie et occasionnellement chez les personnes âgées. Souvent négligée, elle est pourtant assez facile à diagnostiquer : La migraine vestibulaire est définie par au moins 5 épisodes de vertiges qui doivent durer de 5 minutes à 72 heures en cas de migraine préexistante (selon les critères internationaux des céphalées), et au moins 50% des cas de vertiges doivent également être accompagnés de symptômes typiques de la migraine, c’est-à-dire d’une céphalée intense unilatérale, d’une phonophobie ou d’une aura.
Il n’existe pas d’étude spécifique sur la migraine vestibulaire, de sorte que la pharmacothérapie s’oriente pour l’instant vers la migraine sporadique, avec un traitement par analgésiques – soit ASS, soit d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens – et antiémétiques en cas de crise. Si les crises sont relativement fréquentes, il convient d’envisager une prophylaxie avec différentes substances telles que le magnésium, la rivoflavine/Q10, les bêtabloquants, l’amitriptyline, le topiramate ou l’acide valproïque. Trois attaques graves ou plus en seraient l’indication. Le Dr Zwergal a décrit l’effet comme étant généralement très bon.
La paroxysmie vestibulaire résulte d’un contact vaisseau-nerf et peut déclencher des crises de vertige très brèves, stéréotypées et fréquentes en raison d’une pulsation. Ceux-ci peuvent se manifester des dizaines de fois par jour. Le traitement de cette maladie rare, mais dont le diagnostic et le traitement sont importants, repose sur l’administration d’antiépileptiques. De manière comparable à la névralgie du trijumeau, il existe des “anciens” bloqueurs des canaux sodiques – par exemple la carbamazépine ou l’oxcarbazépine – pour lesquels il faut tenir compte des effets secondaires courants tels que l’hyponatrémie et les interactions. Le lacosamide a récemment fait l’objet d’une série de cas ; les coûts du traitement sont plus élevés, mais le potentiel d’interaction est plus faible. Selon le Dr Zwergal, il existe une bonne réponse thérapeutique pour toutes les substances actives.
Congrès : DGIM 2021 (en ligne)
Source :
- Symposium industriel “Tourner quelle vis quand tout tourne ?” dans le cadre du 127e Congrès de l’Union européenne. Congrès de la Société allemande de médecine interne (DGIM), 17 avril 2021 ; Organisateur : Schwabe Pharma.
InFo DOULEUR & GERIATRIE 2021 ; 3(1) : 28-29 (publié le 3.7.21, ahead of print)