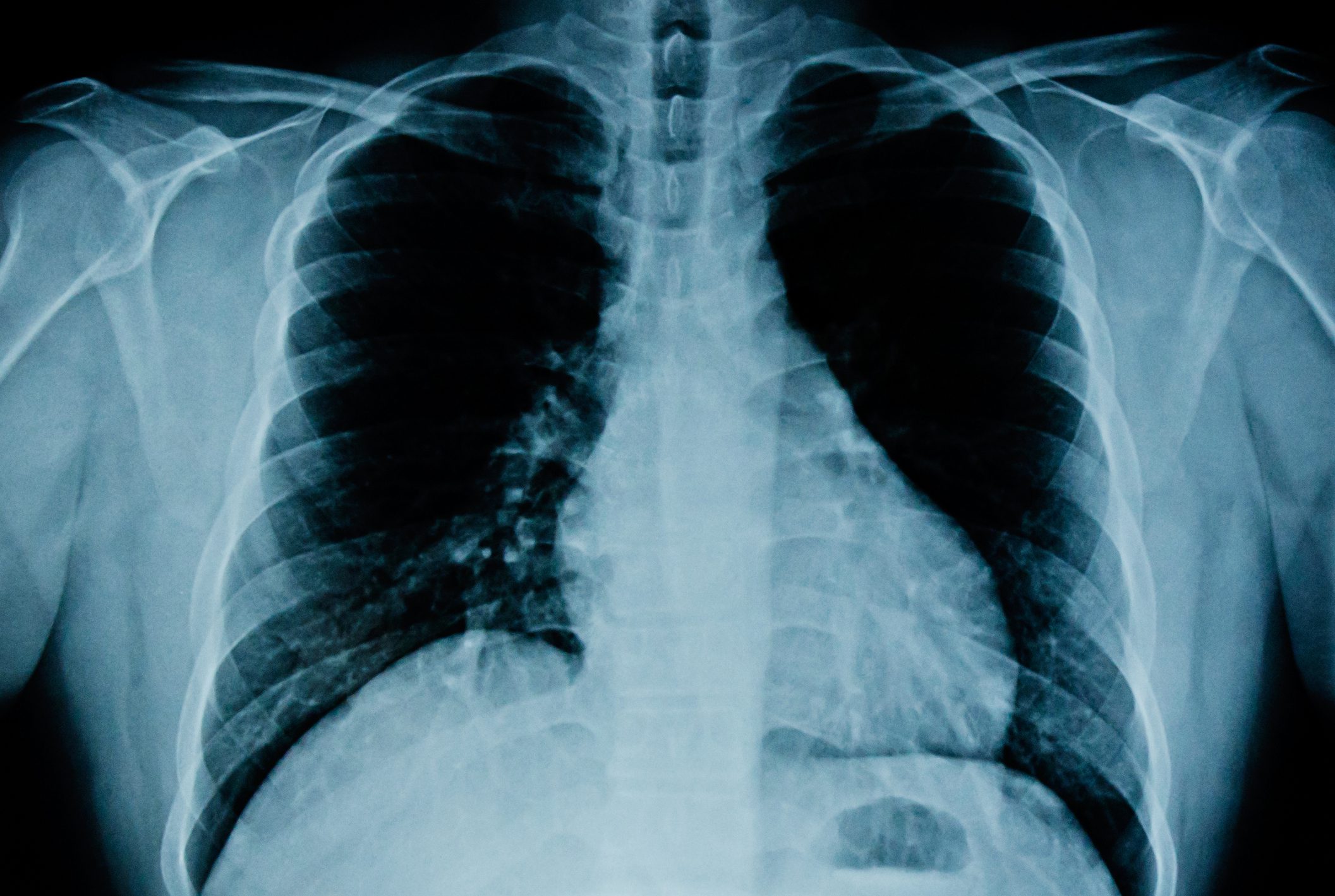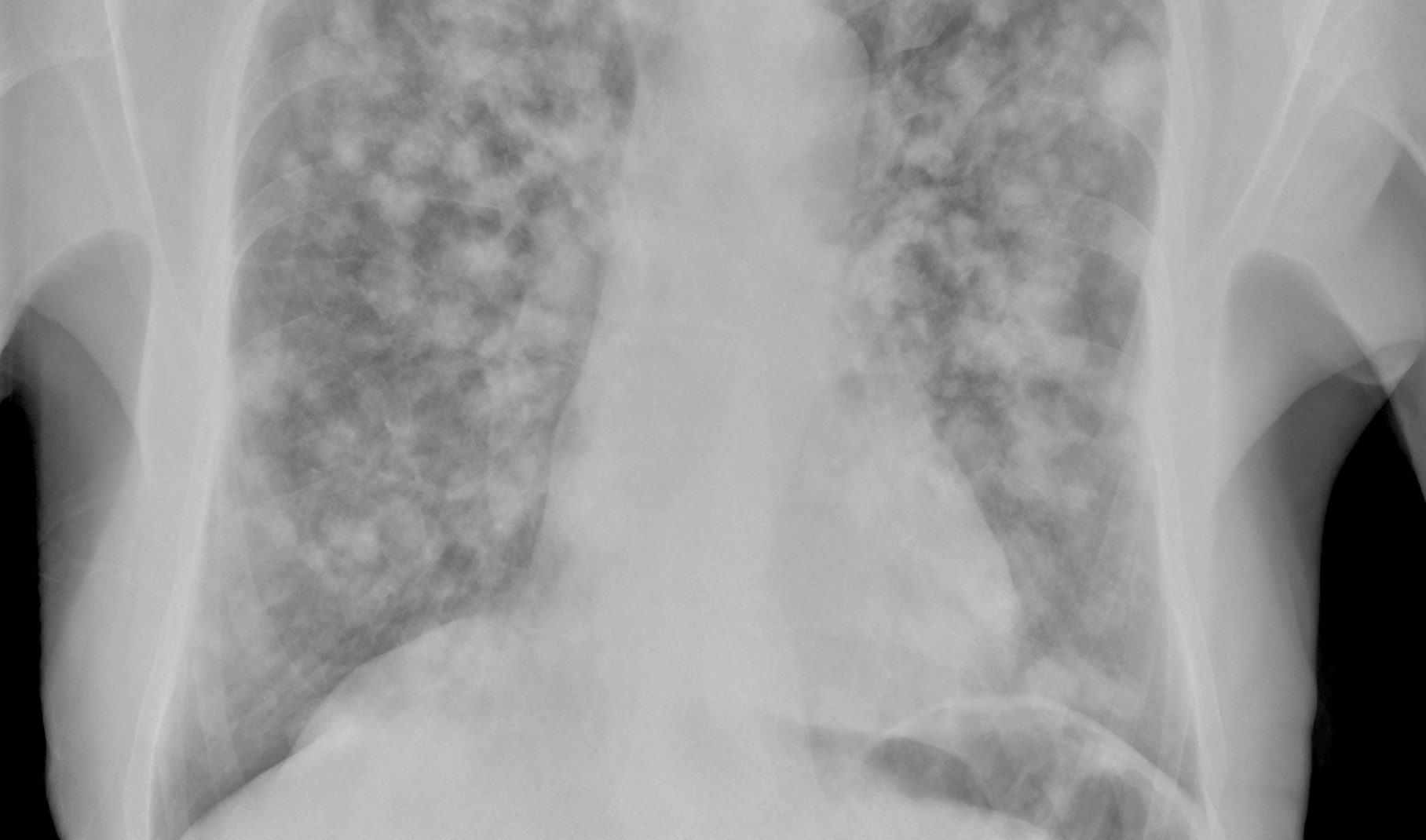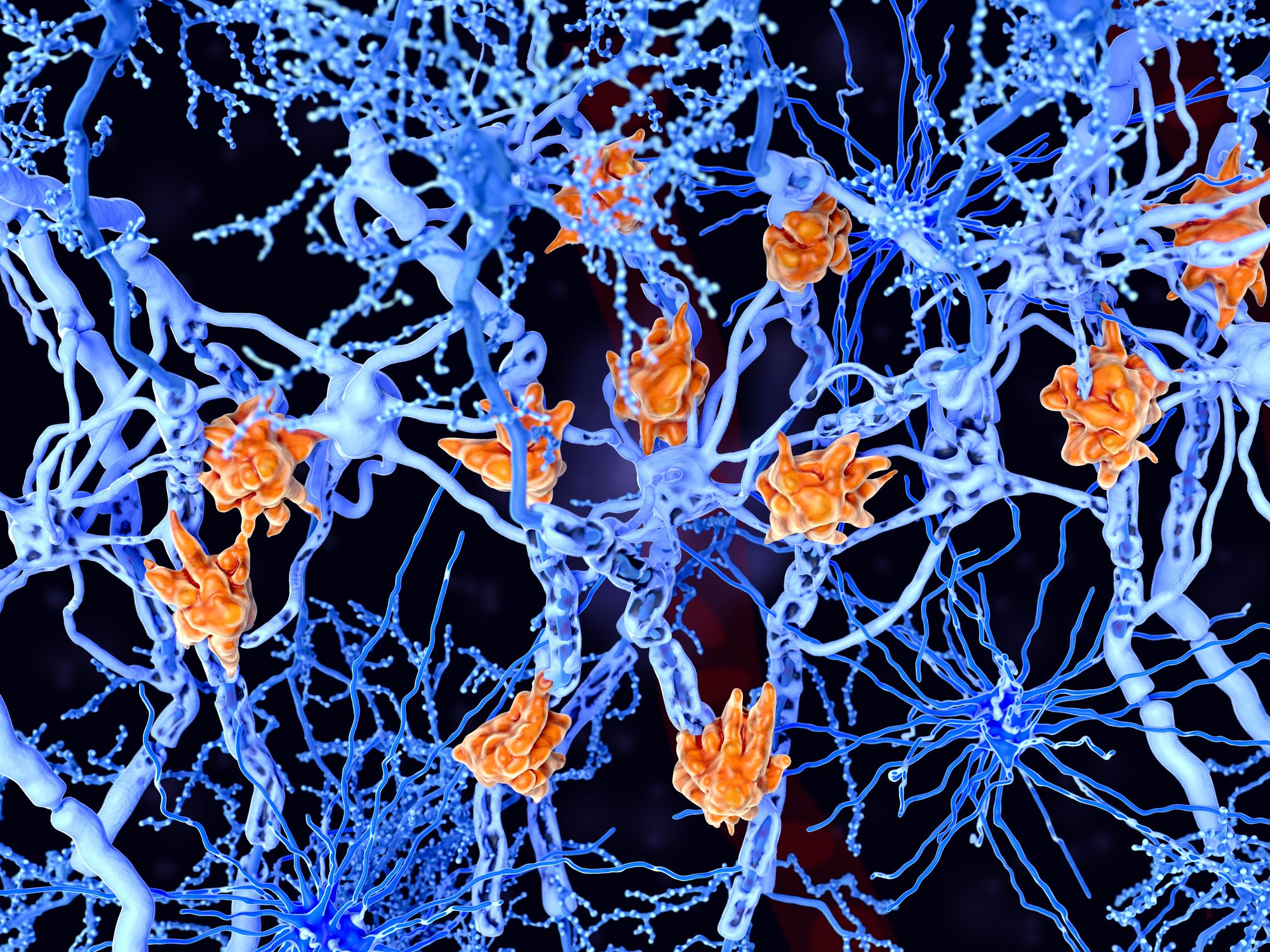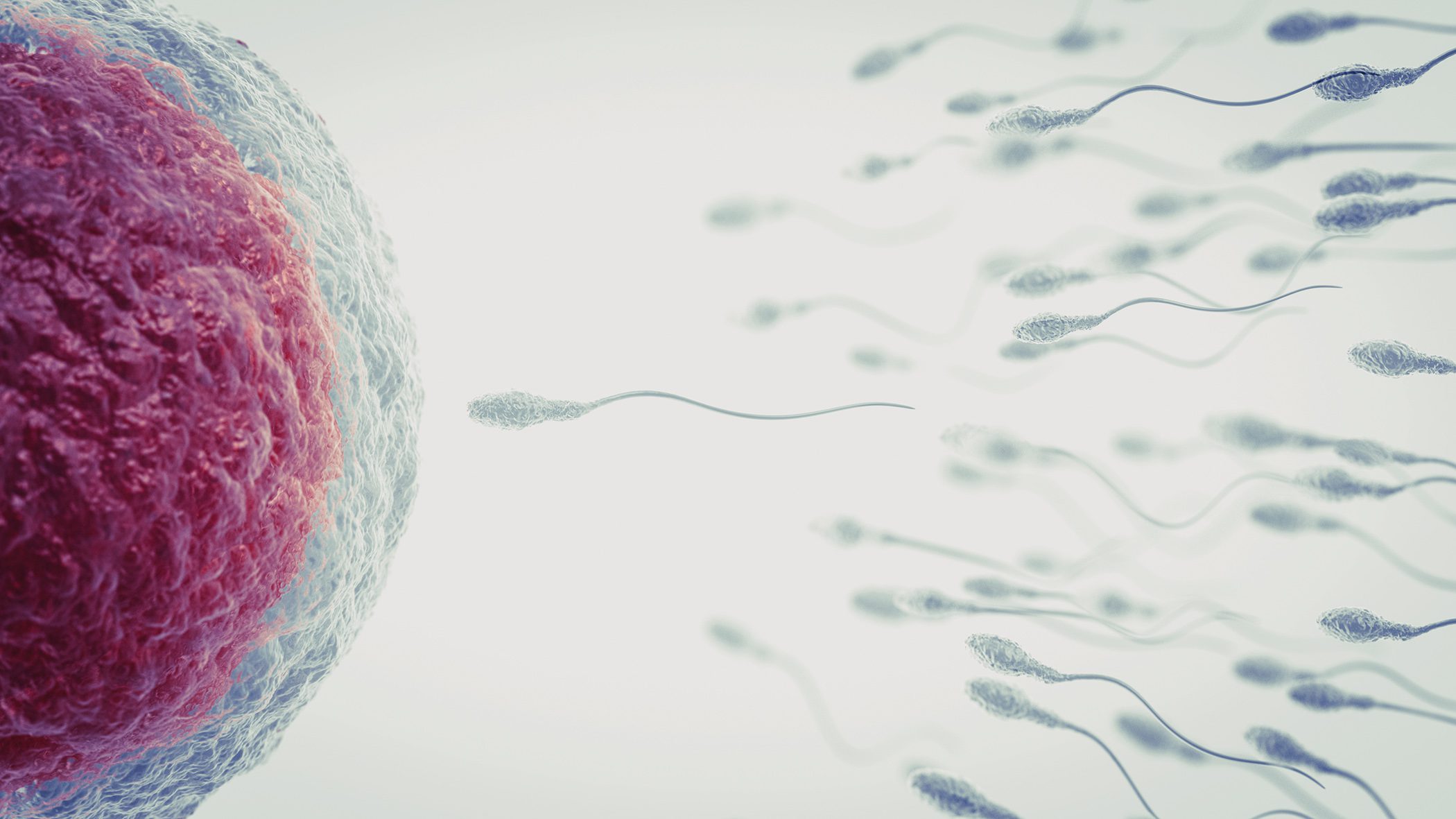Selon l’article 9 de la loi sur la transplantation, une personne est morte lorsque la fonction du cerveau, y compris du tronc cérébral, a cessé de manière irréversible. En principe, le diagnostic de mort cérébrale ne peut être posé qu’en présence d’une lésion cérébrale aiguë. D’autres troubles doivent être exclus avec certitude comme cause ou cause partielle essentielle des résultats cliniques. Le diagnostic de mort cérébrale est généralement établi de manière purement clinique par l’examen de deux médecins selon le principe du double contrôle, l’un des médecins ne devant pas être directement impliqué dans la prise en charge du patient et les deux devant être qualifiés et expérimentés dans le domaine du diagnostic de mort cérébrale. Pour le déroulement du diagnostic de mort cérébrale, il est important de savoir s’il s’agit d’une lésion cérébrale primaire ou secondaire due à un arrêt circulatoire persistant.
Le 1er juillet 2007, la loi sur la transplantation est entrée en vigueur, dotant ainsi la Suisse de la première réglementation fédérale complète dans le domaine de la médecine de la transplantation. Cette loi définit les conditions dans lesquelles les organes, tissus ou cellules peuvent être utilisés à des fins de transplantation. La condition préalable au prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur une personne décédée est le constat de la mort, pour lequel des directives médico-éthiques ont été formulées par l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) et approuvées par le Sénat de l’ASSM en 2011. Ces directives peuvent être consultées sur www.samw.ch/de/Ethik/Richtlinien. En vertu du régime dit du consentement élargi, les organes peuvent être prélevés après le constat de la mort si le donneur ou un tiers autorisé à le représenter a donné son consentement.
L’objectif de cet aperçu est de présenter les bases en vigueur en Suisse pour le diagnostic de la mort cérébrale.
Principes généraux du diagnostic de la mort cérébrale
Selon l’article 9 de la loi sur la transplantation, un être humain est mort lorsque la fonction du cerveau, y compris du tronc cérébral, a cessé de manière irréversible, même si, à ce moment-là, les autres organes et tissus présentent encore les signes de la vie et peuvent donc faire l’objet d’une transplantation. Ce critère de décès ne s’applique que lorsque la question de la transplantation ou de l’évaluation du pronostic se pose. La définition de la mort cérébrale est liée à l’hypothèse qu’après la défaillance du cerveau en tant qu’organe de contrôle central, la mort des organes, des tissus et des cellules est amorcée.
La mort cérébrale, en tant que défaillance irréversible de toutes les fonctions cérébrales (il n’existe pas en Suisse de “mort du tronc cérébral” comme en Grande-Bretagne), est le résultat de la médecine intensive moderne, car en cas de défaillance complète de toutes les fonctions cérébrales, la respiration spontanée s’arrête également et, dans ces conditions, la fonction cardio-vasculaire ne peut être maintenue que par une ventilation contrôlée. En principe, le diagnostic de mort cérébrale ne peut être posé qu’en présence d’une lésion cérébrale aiguë. D’autres troubles (intoxications, hypothermie, choc circulatoire, troubles métaboliques graves, influence de médicaments sédatifs, etc.) doivent être exclus avec certitude comme cause ou cause partielle essentielle des résultats cliniques.
Le diagnostic de la mort cérébrale est avant tout clinique.
Il est important de souligner que le diagnostic de mort cérébrale est généralement purement clinique et résulte de l’examen de deux médecins selon le principe du double contrôle, l’un des médecins ne devant pas être directement impliqué dans la prise en charge du patient et les deux devant posséder une qualification et une expérience dans le domaine du diagnostic de la mort cérébrale, comme par exemple une spécialisation en neurologie ou en médecine intensive (pour le constat de la mort chez les enfants : spécialiste en neuropédiatrie ou en médecine intensive pédiatrique). Selon les critères actuels, la répétition de l’examen clinique après un certain intervalle de temps n’est plus exigée que pour le diagnostic de mort cérébrale des nourrissons au-delà de la période néonatale.
Ce n’est que si l’imagerie neuroradiologique ne permet pas d’expliquer la perte de fonction du cerveau ou si l’examen des nerfs crâniens n’est pas possible cliniquement que la preuve de l’irréversibilité de la lésion cérébrale doit être apportée par un examen technique complémentaire autorisé à cet effet et qui, en Suisse, doit démontrer l’absence de circulation sanguine cérébrale. Cela peut se faire par échographie Doppler transcrânienne ou duplex couleur, par angiographie par tomographie informatisée (CTA), par angiographie par soustraction numérique intra-artérielle ou par imagerie par résonance magnétique avec angiographie (ARM). L’examen complémentaire doit être effectué par des spécialistes qualifiés pour ce type d’examen. En Suisse, la documentation de la perte de l’activité électrique cérébrale par EEG comme preuve de l’irréversibilité de la lésion cérébrale n’est pas utilisée selon les directives actuelles.
Lésions cérébrales primaires ou secondaires ?
Pour le déroulement du diagnostic de mort cérébrale, il est important de savoir si l’on est en présence d’une lésion cérébrale primaire (par ex. hémorragie intracrânienne, infarctus du myocarde avec envahissement de l’espace, tumeurs avec envahissement de l’espace, traumatisme crânien grave, méningo-encéphalites, etc.) ou d’une lésion cérébrale secondaire due à un arrêt circulatoire persistant, à la suite duquel, faute d’irrigation cérébrale, la fonction cérébrale est irréversiblement interrompue. Dans les deux situations, la constatation cumulative des signes cliniques mentionnés est exigée selon le principe du double contrôle. Dans le cas de la mort cérébrale en cas d’arrêt circulatoire persistant et documenté par échocardiographie transthoracique pendant plus de 10 minutes, un autre examen technique complémentaire n’est pas requis, car cela exclut une irrigation cérébrale suffisante.
La distinction entre une lésion cérébrale supratentorielle (lésion du cerveau) et une lésion cérébrale infratentorielle (lésion du cervelet et/ou du tronc cérébral) n’est pas exigée en Suisse. Or, c’est ce qui est exigé en Allemagne par exemple ; une lésion cérébrale infratentorielle entraîne obligatoirement un examen technique complémentaire.
Considérations finales
Le constat de la mort cérébrale est en principe clinique, sur la base d’un examen complet avec mise en évidence de l’absence de réflexes du tronc cérébral et de la respiration spontanée chez les patients comateux présentant des lésions cérébrales aiguës, selon le principe du double contrôle. Le diagnostic peut être posé sans ambiguïté dans n’importe quelle unité de soins intensifs pour la majorité des patients, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des examens complémentaires à l’aide d’appareils.
Les directives suisses permettent, sur la base de paramètres purement cliniques, d’établir avec certitude la perte totale et irréversible des fonctions cérébrales et le pronostic infondé qui en découle pour le patient. La question de savoir dans quelle mesure la preuve de la mort cérébrale est un signe de mort certain, au même titre que l’arrêt cardiaque et respiratoire, qui indique la mort de l’être humain dans son ensemble, est en fin de compte une question philosophique et spirituelle sur la nature de la mort, qui est aussi très largement influencée par les traditions culturelles et qui ne peut pas être résolue uniquement par la médecine.
Il faut toujours garder à l’esprit que le moment de la constatation de la mort cérébrale est d’une importance et d’une portée biographiques majeures, car, en raison du lien avec la médecine de transplantation, la fin de vie d’une personne peut être en même temps le début d’une nouvelle vie pour une autre personne. En conséquence, le traitement des personnes en état de mort cérébrale représente un défi et une responsabilité particulière pour toutes les personnes concernées (médecins, soignants, familles), et ce de différentes manières.
Littérature complémentaire :
- Wijdicks EFM, et al : Evidence-based guideline update : Determining brain death in adults : Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2010 ; 74 : 1911-1918.
- Wijdicks EFM : Le diagnostic de la mort cérébrale. Concepts actuels. N Engl J Med 2001 ; 344(16) : 1215-1221.
InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2015 ; 13(4) : 26-27