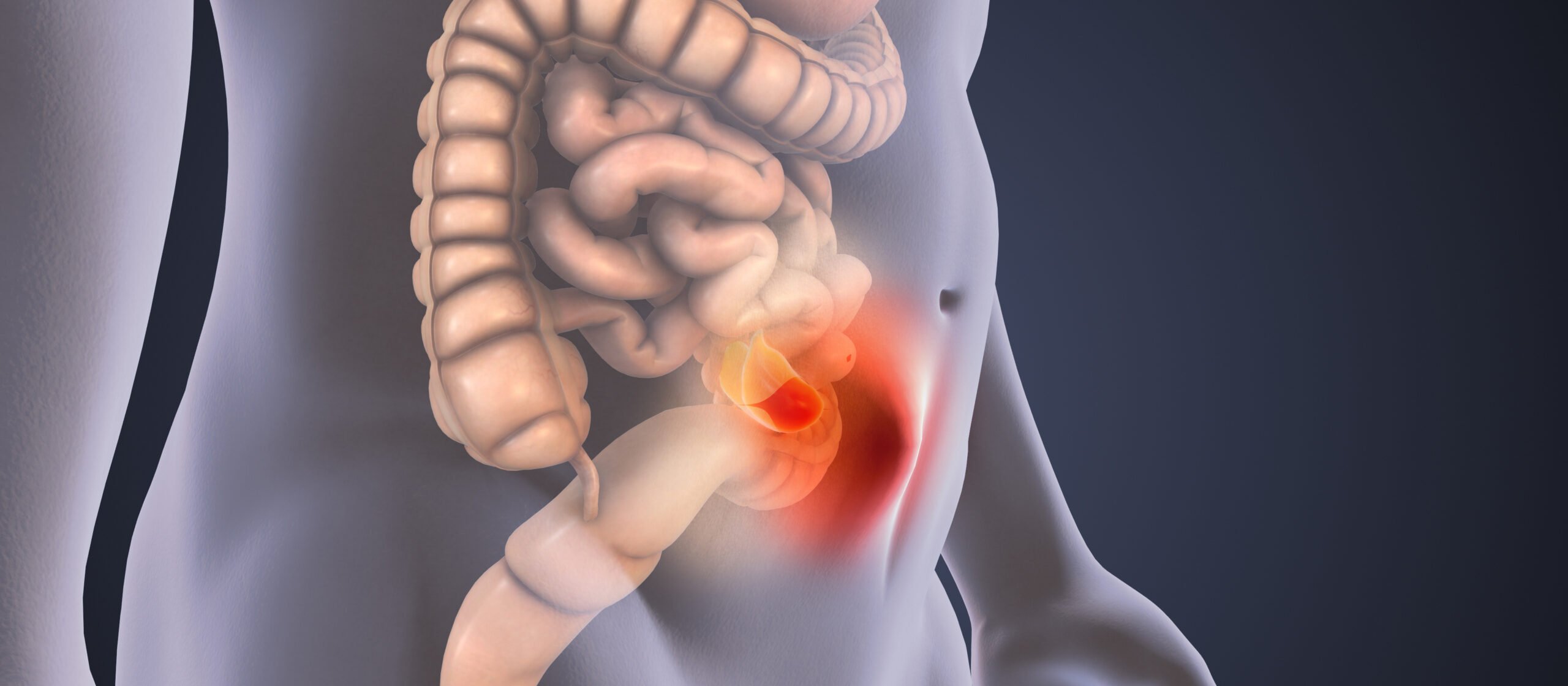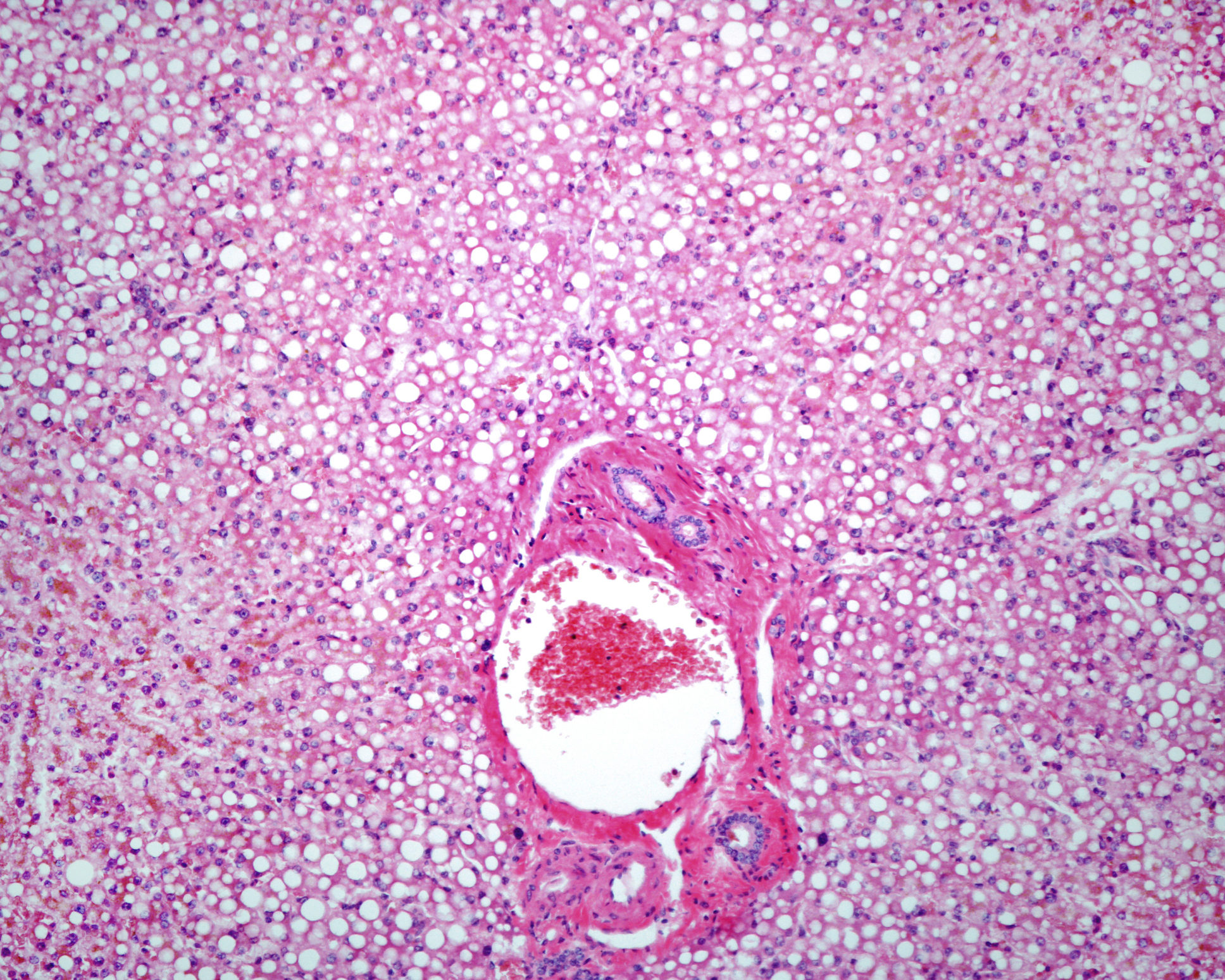Les allergies sont un sujet quotidien dans la pratique de la médecine générale. Jusqu’au début de ce millénaire, on estimait qu’environ un tiers de la population occidentale souffrait d’allergies, qu’il s’agisse d’allergies cutanées, respiratoires, médicamenteuses ou même aux venins d’insectes. Récemment, de nouvelles données épidémiologiques provenant d’Autriche et d’Allemagne ont montré que plus de la moitié de la population est sensibilisée à un allergène inhalé tel que le pollen ou les acariens de la poussière de maison, respectivement. présente des anticorps IgE contre des protéines spécifiques.
Le diagnostic de l’allergie repose sur l’anamnèse, les tests cutanés, la détection d’anticorps IgE spécifiques dans le sérum et, le cas échéant, des tests de provocation. L’anamnèse est la partie la plus importante du diagnostic et c’est également elle qui détermine si un résultat cutané ou sérologique positif est cliniquement significatif ou non. Les diagnostics moléculaires des allergies permettent aujourd’hui de mieux comprendre l’allergie en distinguant les sensibilisations primaires des réactions croisées ou en différenciant les protéines potentiellement dangereuses des protéines moins dangereuses sur la base de la détection des anticorps. En outre, le diagnostic d’allergie basé sur les composants peut être utile pour poser l’indication d’une immunothérapie spécifique (SIT). Il est désormais possible d’expliquer scientifiquement une entité clinique telle que le syndrome pollen de bouleau-noix-pierre-graines ou le syndrome acariens-coquillages.
Le traitement a également connu quelques nouveautés, bien que les corticostéroïdes topiques et les antihistaminiques constituent la base du traitement symptomatique, tant chez les adultes que chez les enfants. Par ailleurs, le seul traitement causal à ce jour, à savoir la SIT ou désensibilisation – bien que reconnu par l’OMS – fait encore figure de parent pauvre en Suisse. Parmi les personnes allergiques au pollen, à peine 2% bénéficient d’une SIT. L’indication d’une ITS doit être posée par un allergologue, mais elle peut être réalisée par un médecin généraliste. Le patient étant au centre des préoccupations, il devrait être possible pour le médecin généraliste et le spécialiste de travailler main dans la main.
Bien que ces deux articles ne reflètent que des aspects partiels de l’activité allergologique, ils devraient aider le médecin généraliste à mieux comprendre les interprétations ou les procédures allergologiques.
Bonne lecture !
Pr Dr. med. Arthur Helbling
PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2014 ; 9(2) : 10