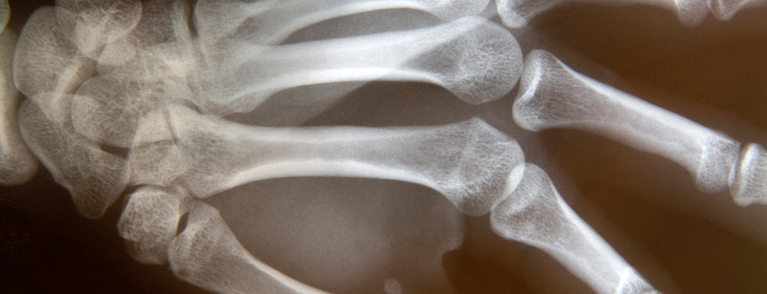De nombreux patients atteints de rhumatisme sont confrontés à la douleur lors de poussées récurrentes, d’autres quotidiennement. Et certains développent même une douleur chronique à part entière. Dans le livre récemment publié par la Ligue suisse contre le rhumatisme “Rheuma-Schmerzen aktiv lindern”, les personnes concernées apprennent comment cette évolution peut se produire et ce qu’elles peuvent elles-mêmes faire activement pour y remédier. HAUSARZT PRAXIS s’est entretenu avec l’auteur, Dr. phil. Régine Strittmatter.
Dr Strittmatter, pourquoi est-il important de considérer la douleur chronique comme une maladie à part entière et non simplement comme une douleur persistante ?
La douleur aiguë est un signal d’alarme utile, elle fait en sorte que nous agissions sur la cause de la douleur. Les douleurs chroniques n’ont plus cette fonction d’alerte biologiquement utile et ne sont plus nécessairement liées à leur déclencheur initial. Cela nécessite des approches de traitement spécifiques.
Les douleurs chroniques sont “coûteuses” à tous points de vue : elles entraînent des expériences douloureuses pour les personnes concernées et leurs proches, elles sont un facteur de coûts dans notre système de santé, elles ont une influence sur la capacité de travail et ont donc des conséquences économiques coûteuses.
Quel est le plus grand défi pour les personnes souffrant de douleurs chroniques ?
Les douleurs chroniques sont profondes, le corps et le psychisme en souffrent tout autant. Le sentiment d’être à la merci de la douleur, de ne pas en connaître les causes ou de devoir vivre avec elle de manière permanente : Tout cela – en plus de la douleur elle-même – est difficile à supporter et peut conduire à un cercle vicieux de douleur, de pensées dépressives, de tensions et d’encore plus de douleur. La douleur chronique est très souvent associée à des problèmes psychosociaux – en tant que facteur déclenchant ou conséquence. Les problèmes au travail ou dans le couple aggravent encore les conditions de vie des personnes concernées.
Que peuvent faire les personnes concernées pour y remédier activement ?
Les personnes concernées peuvent faire beaucoup. Dans un premier temps, il est important d’acquérir des connaissances sur l’origine et le traitement de la douleur et de connaître les différents points de départ pour la traiter. Celle-ci comprend toujours, outre le traitement médicamenteux de la douleur chronique, d’autres éléments tels que la physiothérapie, l’exercice et les méthodes psychologiques. Parmi ces dernières, on trouve des techniques de relaxation ou des techniques permettant de se distraire mentalement de la douleur, mais aussi la psychothérapie, en particulier si une dépression ou un trouble anxieux est diagnostiqué en même temps.
Quel est le rôle du médecin généraliste ?
Les médecins généralistes jouent un rôle central dans le traitement des personnes souffrant de douleurs chroniques. Ils sont les premiers et les plus importants interlocuteurs et ils accompagnent leurs patients pendant de longues périodes, souvent très difficiles et frustrantes. Ce n’est pas une tâche facile : les patients souhaitent, et c’est compréhensible, se débarrasser rapidement de leur douleur et espèrent qu’elle disparaîtra facilement avec des médicaments ou une opération. C’est précisément lorsque les causes de la douleur ne sont pas (ou plus) claires et qu’il existe de nombreuses contraintes psychosociales qu’il est difficile, mais d’autant plus important, d’expliquer au patient que la disparition de la douleur n’est peut-être pas un objectif réaliste – et de lui donner en même temps l’espoir d’une vie meilleure malgré la douleur.
Qu’aimeriez-vous recommander en particulier à chaque médecin généraliste lorsqu’il s’agit de prendre en charge des patients souffrant de douleurs chroniques ?
Le traitement de la douleur chronique est une tâche interdisciplinaire. Or, sans une coordination systématique des différentes mesures, le risque est grand que le traitement de la douleur ne soit qu’une juxtaposition de différentes mesures thérapeutiques. Une bonne collaboration avec des collègues spécialistes de la physiothérapie et de la psychologie est ce qui aide le plus les patients souffrant de douleurs et soulage également le médecin de famille dans cette tâche exigeante.
Entretien : Dr. med. Sabina M. Ludin