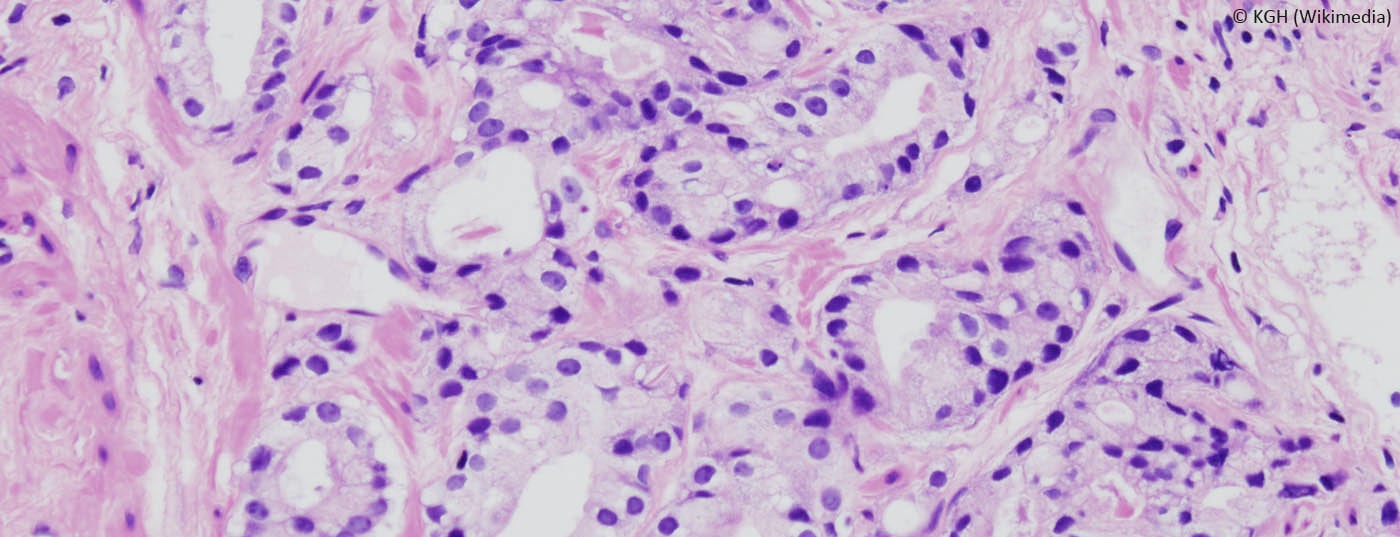Lors du congrès EMUC à Lisbonne, deux événements ont mis en lumière les stratégies de diagnostic et de traitement du cancer de la prostate. Il s’agissait d’une part des avantages et des effets de la surveillance active, et d’autre part de la comparaison entre la déprivation androgénique intermittente et la déprivation androgénique continue. Lors d’une session “pour et contre”, les participants ont discuté de la question de savoir si le principe “moins il y a de médicaments, mieux c’est” s’applique également dans ce cas.
(ag) Le professeur Monique Roobol, MD, Rotterdam, a évoqué les deux visages du cancer de la prostate : d’une part, la maladie peut être indolente, lente et plutôt inoffensive, d’autre part, elle peut être très agressive, douloureuse et mortelle. La forme indolente, en particulier, est fréquente chez les patients âgés. Bien que le test PSA ne soit pas spécifique d’un cancer de la prostate (agressif), les hommes présentant des valeurs hors normes sont souvent soumis à d’autres examens diagnostiques, qui peuvent à leur tour conduire à un surtraitement (“overtreatment”). L’évolution naturelle de la maladie constitue toutefois un continuum de risques qui doit être relevé avec soin et circonspection. Selon les calculs épidémiologiques, il y a un surdiagnostic dans 22 à 42% des cas.
La surveillance active (AS) ne peut pas empêcher le surdiagnostic, mais elle peut réduire les dommages qui y sont liés (en particulier le surtraitement). “Il faut séparer plus strictement le diagnostic du traitement, c’est-à-dire qu’il faut des définitions précises du moment où la situation devient dangereuse et nécessite donc une intervention”. Le SA est donc une solution temporaire mais indispensable pour aborder les problèmes de surdiagnostic et de surtraitement. Bien entendu, les protocoles d’AS, puisqu’ils reposent sur des biopsies transrectales répétées de la prostate, ne sont pas sans risques.
Quels examens font partie de la RO ?
Des études examinent actuellement différents instruments potentiels pour la REL. Les découvertes en matière de génétique et divers biomarqueurs potentiels sont discutés. On se demande par exemple quelle est la valeur prédictive de l’âge, de l’ethnie ou des antécédents familiaux, ou si les variables génétiques (T2-ERG, PCA3, etc.) jouent un rôle significatif. Il en ressort que seuls la biopsie et les dérivés du PSA continuent de prédire le risque de progression de manière cohérente. “Même les outils d’imagerie comme l’IRM/l’échographie ne peuvent pas encore remplacer les biopsies répétées de la prostate”, ajoute-t-elle.
Sécurité de l’AS difficile à définir
Il serait également intéressant de savoir dans quelle mesure la SA affecte concrètement la qualité de vie. Cependant, les données disponibles à ce jour ne sont pas randomisées et présentent souvent un biais de sélection. Ils présentent des niveaux de qualité de vie comparables à ceux obtenus après un traitement radical. Le professeur Robool a souligné l’importance de collecter des données prospectives à long terme sur la SA. “Si l’on considère la longue évolution naturelle d’un cancer de la prostate à un stade précoce, les résultats à moyen terme de la SA deviennent d’autant plus importants. Il ne suffit donc pas de relever uniquement la mortalité comme résultat de sécurité d’une SA”. Grâce à des modèles prédictifs, il serait possible de prédire quels patients réagissent de manière vulnérable sur le plan psychosocial à une SA (avec stress, anxiété et dépression). En dernier ressort, il faut toutefois mieux standardiser le relevé de la qualité de vie en tant qu’outcome important de la SA.
Il est également urgent de disposer de lignes directrices spécifiques basées sur des preuves concernant la SA.
Traitement : déprivation androgénique intermittente ou continue ?
La question de savoir si la déprivation androgénique continue (CAD) ou intermittente (IAD) donne de meilleurs résultats a également été débattue lors du congrès. Maha Hussain, MD, Michigan, a passé en revue la situation des études : “De nombreuses études de phase III comparant l’IAD à la CAO présentent malheureusement des limites pertinentes : Les populations de patients sont souvent très mélangées et les échantillons relativement petits. Les plans de traitement diffèrent et les critères d’évaluation (par exemple le temps jusqu’à la progression) ne sont pas définis de manière uniforme. De plus, la plupart des travaux présentent des suivis trop courts”. Hussain conclut qu’à ce jour, aucune étude randomisée n’a démontré la supériorité de l’IAD en termes de survie globale. La non-infériorité – si tant est qu’elle ait été définie statistiquement – n’a pas pu être démontrée du tout ou, selon l’oratrice, uniquement avec des valeurs limites de HR trop élevées : Alors que SWOG9346 [1] dépassait le seuil de HR fixé à 1,2, NCIC PR7 [2] a certes trouvé une non-infériorité, mais seulement avec un seuil plus élevé de 1,25 (ce qui, selon l’oratrice, doit être remis en question). Concrètement, cela signifierait en effet qu’une augmentation de 25% du risque de mortalité due à l’utilisation de l’IAD au lieu de la CAD est encore tolérable. Les résultats sont également mitigés et incohérents en ce qui concerne le critère d’évaluation “temps jusqu’à la progression”. “Comme les avantages en termes de qualité de vie ne sont pas non plus très convaincants, on peut se demander quelle est la pertinence de la variante intermittente”, a-t-elle expliqué.
Dans l’ensemble, le rôle de la CAO dans le cadre d’un traitement adjuvant est indiscutable. La déprivation androgénique et un traitement local permettent de prolonger de manière décisive la survie de ces patients.
Chez les patients présentant une récidive non métastatique du PSA, les deux approches n’ont jusqu’à présent pas démontré de bénéfice significatif (bien que l’IAD soit discutée comme option).
“En revanche, en cas de métastases, la CAO semble avoir tendance à offrir un avantage en termes de survie. Si l’on utilise tout de même une IAD en raison d’une qualité de vie légèrement meilleure, on ne le fait qu’après avoir informé complètement le patient et en tenant compte du moins bon résultat en termes de survie”, a déclaré Hussain.
Tout est question d’interprétation ?
Cette vision critique a été contredite par le professeur Per-Anders Abrahamsson, MD, Lund. Selon lui, il faut interpréter les données existantes de manière exactement inverse, c’est-à-dire positive : pour certains patients sélectionnés, l’IAD représente une alternative équivalente à la CAO. “Si l’on passe en revue la littérature évoquée par l’oratrice précédente, on ne trouve pas de preuve claire de la supériorité ou de l’infériorité de l’IAD par rapport à la CAD (valable pour la survie [1–3] et le temps jusqu’à la progression [4,5]). L’équivalence des variantes n’est certes pas encore suffisamment prouvée statistiquement, mais elle semble plausible au vu des données disponibles jusqu’à présent, du moins chez les patients sélectionnés”, explique le professeur Abrahamsson. “L’IAD ne sera jamais un traitement envisageable pour tous les patients, certainement pas pour ceux qui ont une charge tumorale élevée. C’est l’une des raisons pour lesquelles les populations très mélangées de nombreuses études sont problématiques”. La variante intermittente est toutefois mieux tolérée et il est possible – mais cela doit encore être démontré par des études – qu’elle empêche certaines complications à long terme de la MA [6]. Même les lignes directrices européennes (EAU) indiquent désormais que le statut de l’IAS ne peut plus être considéré comme purement investigateur. Les deux intervenants se sont accordés sur la nécessité d’intensifier les efforts de recherche si l’on veut parvenir à des conclusions plus concrètes.
Source : 6e réunion pluridisciplinaire européenne sur les cancers urologiques, 13-16 novembre 2014, Lisbonne
Littérature :
- Hussain M, et al : Intermittent versus Continuous Androgen Deprivation in Prostate Cancer. N Engl J Med 2013 ; 368 : 1314-1325.
- Crook JM, et al : Intermittent Androgen Suppression for Rising PSA Level after Radiotherapy. N Engl J Med Sep 6 2012 ; 367(10) : 895-903.
- Mottet N, et al : Intermittent hormonal therapy in the treatment of metastatic prostate cancer : a randomized trial. BJU Int 2012 Nov ; 110(9) : 1262-1269.
- Calais da Silva FE, et al : Intermittent androgen deprivation for locally advanced and metastatic prostate cancer : results from a randomised phase 3 study of the South European Uroncological Group. Eur Urol 2009 Jun ; 55(6) : 1269-1277.
- Salonen AJ, et al : The FinnProstate Study VII : intermittent versus continuous androgen deprivation in patients with advanced prostate cancer. J Urol 2012 Jun ; 187(6) : 2074-2081.
- Sciarra A, et al : Intermittent Androgen-deprivation Therapy in Prostate Cancer : A Critical Review Focused on Phase 3 Trials. Urologie européenne 2013 ; 64(1) : 722-730.
InFo ONKOLOGIE & HÉMATOLOGIE 2014 ; 2(10) : 22-23