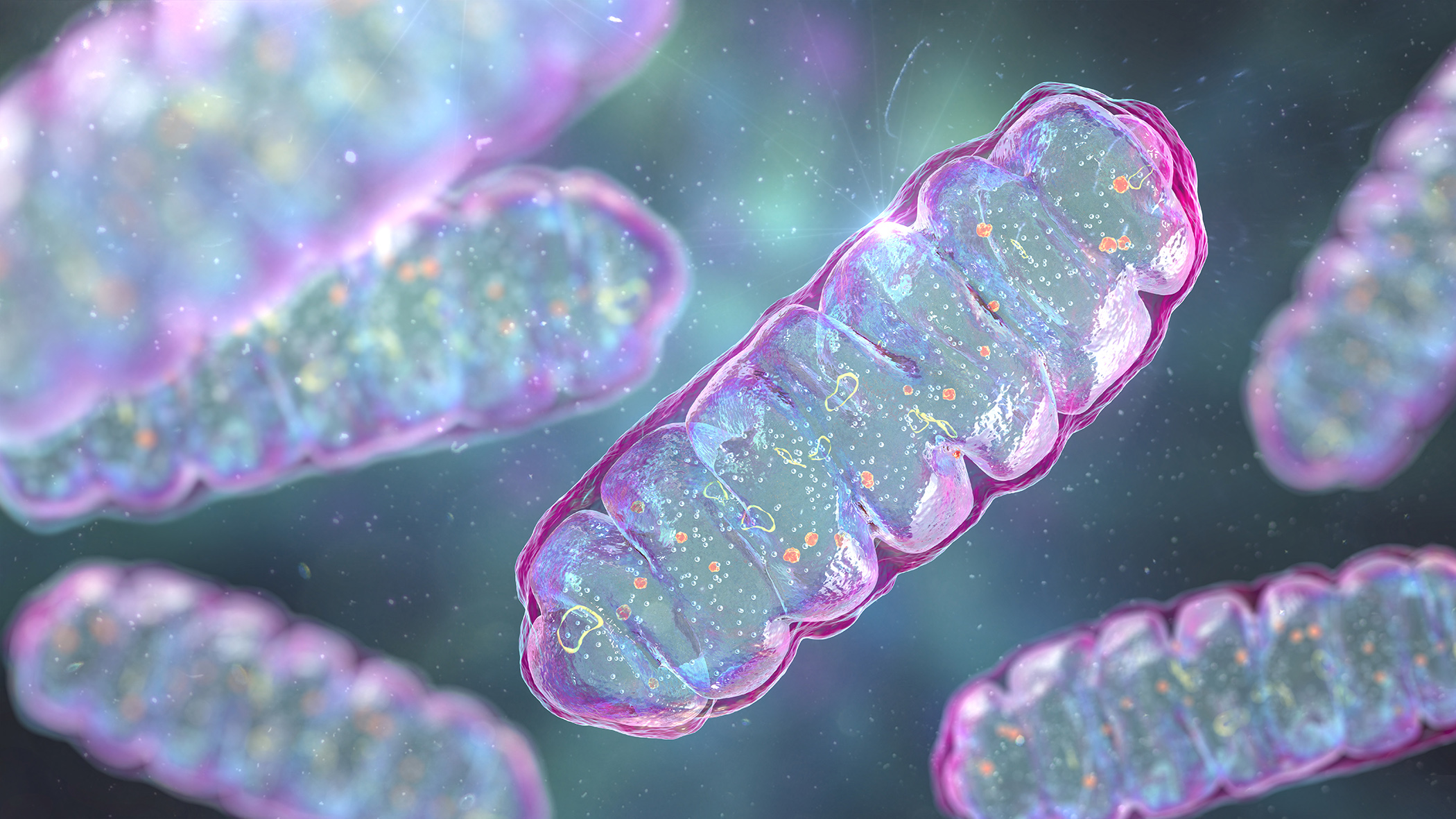La compréhension de la maladie des anévrismes intracrâniens évolue. En ce qui concerne la formation et la croissance ainsi que les mécanismes de déstabilisation, les processus inflammatoires sont actuellement au centre de la recherche clinique. Les dernières découvertes pourraient changer le traitement des anévrismes instables à l’avenir : Des interventions neurochirurgicales et endovasculaires à la thérapie médicamenteuse – avec de l’aspirine ?
On sait que les anévrismes sont causés par des vitesses d’écoulement trop élevées dans les artères. Les anévrismes ne sont pas congénitaux, comme on le croyait autrefois, mais se développent au cours de la vie, généralement après l’âge de 40 ans. Ce sont des modifications de l’hémodynamique dans le cerveau qui provoquent le développement d’un anévrisme, cela a été démontré dans des études animales [1]. La paroi artérielle est alors reconstruite, par les macrophages et l’enzyme cyclooxygénase, COX-2 [2]. Les signes d’instabilité et donc de risque de rupture sont la taille de l’anévrisme et la prise de contraste le long de la paroi de l’anévrisme, indiquant une inflammation. Une forme irrégulière augmente également le risque, quelle que soit sa taille : environ 40% des anévrismes qui se rompent sont de petite taille (<10 mm) [3].
Tous les anévrismes ne deviennent pas instables
Le professeur Juhana Frösen, MD PhD de l’hôpital universitaire de Kuopio en Finlande, a expliqué dans son exposé qu’il était important de comprendre que tous les anévrismes ne se rompent pas réellement. Les mécanismes pathobiologiques qui conduisent à la formation et à la rupture sont différents. Une étude de suivi à vie d’anévrismes à haut risque de rupture qui n’ont pas été traités montre que seulement un tiers d’entre eux se sont rompus [4]. Le fait qu’un anévrisme se forme ne signifie donc pas nécessairement qu’il devienne instable, avec les conséquences connues d’une éventuelle rupture. Au contraire, dit le professeur Frösen, un anévrisme peut aussi rester stable pour le reste de la vie. La raison de cette stabilité est le remodelage adaptatif, c’est-à-dire que la paroi du vaisseau est reconstruite. Elle s’épaissit et un nouveau collagène est produit [5]. La paroi vasculaire réagit ainsi au stress mécanique provoqué par une vitesse d’écoulement élevée et tente de s’adapter aux nouvelles conditions.
Débit élevé associé à l’inflammation
La croissance de l’anévrisme est une conséquence du remodelage adaptatif de la paroi vasculaire [6]. La paroi du vaisseau s’agrandit, sa géométrie change et, par conséquent, les conditions d’écoulement dans le vaisseau. La force motrice de ce processus biomécanique est l’énergie du flux sanguin qui agit sur les parois des vaisseaux. Si l’on supprime le facteur à l’origine de la vitesse d’écoulement élevée, on peut observer une régression de l’anévrisme, même si l’anévrisme lui-même n’est pas traité.
Le professeur Frösen fait également état d’un lien entre les conditions d’écoulement et l’inflammation, qui favorisent le remodelage. En fonction de la vitesse d’écoulement, des forces de frottement trop élevées ou trop faibles entraînent une inflammation de la paroi vasculaire de l’anévrisme. L’inflammation est à son tour liée au remodelage de la paroi vasculaire et à la rupture. La conséquence du remaniement dégénératif ou remodelage est une perte des cellules musculaires lisses, ce qui empêche le remodelage adaptatif. L’inflammation de la paroi de l’anévrisme provoque la destruction de la matrice restante [5,7].
Les médicaments empêchent-ils la croissance de l’anévrisme ?
Une étude en cours au Kuopio University Hospital examine sur des patients si les médicaments peuvent empêcher la croissance de l’anévrisme et donc le remodelage destructeur et la rupture. Les premiers résultats sur l’inhibition pharmaceutique du remodelage destructif lié au flux sont prometteurs : on constate une diminution du risque de formation d’anévrisme, moins de néoformations après le diagnostic initial et un risque plus faible de croissance et de rupture de l’anévrisme. Si les résultats continuent à se confirmer, cette étude pourrait modifier de manière significative la compréhension de la maladie. Jusqu’à présent, les anévrismes sont généralement traités par voie endovasculaire ou neurochirurgicale, la nouvelle perspective étant les médicaments. Selon le professeur Frösen, il existe un besoin de traitement médicamenteux qui empêche le remodelage de se produire, l’anévrisme de se développer et qui réduit ainsi le risque de rupture.
Étude de phase 3 sur l’aspirine
Le professeur David M. Hasan, MD, de l’University of Iowa Hospitals and Clinics, étudie actuellement les possibilités de traitement médicamenteux des anévrismes dans le cadre d’un essai de phase 3 utilisant l’aspirine. Cela repose sur l’hypothèse que l’aspirine atténue le processus inflammatoire dans la paroi de l’anévrisme et diminue le nombre de ruptures d’anévrisme [8]. L’hypothèse est que l’aspirine a le potentiel de réduire le risque d’hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA). Selon le professeur Hasan, une meilleure compréhension de l’anévrisme permettra également de modifier le traitement : Jusqu’à présent, les anévrismes étaient traités sur la base du critère de la taille. La nouveauté réside dans le fait que le traitement doit être adapté à chaque patient, car chaque anévrisme se comporte différemment en fonction du contexte biologique du patient.
Fragmentation de la membrane élastique interne
Pour définir un anévrisme, le professeur Hasan met l’accent sur la modification structurelle de la membrane élastique interne, c’est-à-dire la fragmentation. Jusqu’à présent, on pensait que cette membrane était un tissu dense qui constituait une barrière contre les influences extérieures. Pourtant, une étude [9] a montré que seul l’âge provoque une modification significative de la membrane, appelée fenestration.
Si le pourcentage de fenestration est élevé, la membrane s’affaiblit, les cellules musculaires lisses se dégradent et une protubérance se forme. Si la membrane élastique est intacte, cela ne se produit pas. On ne sait pas encore exactement comment ce processus se déroulera. Le processus de fenestration augmente dans les zones où la vitesse d’écoulement est élevée, c’est-à-dire dans les sections où de fortes forces de frottement s’exercent sur la paroi du vaisseau. C’est ce que le professeur Hasan appelle le “High shear wall stress”, qui marque le début de la maladie avec une inflammation des cellules endothéliales et une fenestration croissante.
L’équilibre des macrophages assure la stabilité
En utilisant de grandes bases de données, le professeur Hasan et son équipe ont étudié les tissus d’anévrismes rompus et non rompus. Ils ont constaté que les anévrismes rompus contenaient davantage de cytokines telles que COX-2, mPGES-1 et COX-1, ainsi que davantage de cellules inflammatoires et de macrophages. On assiste à une invasion de cellules inflammatoires, jusqu’à ce que les mastocytes soient finalement impliqués [10].
Une autre constatation concerne les différents types de macrophages (M1 et M2). Les M1 provoquent des inflammations et produisent des cytokines, tandis que les M2 ont un effet anti-inflammatoire et activent le processus d’auto-guérison. Dans les anévrismes instables, il y a plus de macrophages M1 que de macrophages M2 et on observe plus de mastocytes dans la paroi de l’anévrisme que dans les sections de vaisseaux sains. Ces deux types de cellules interagissent et détruisent les cellules de la paroi de l’anévrisme. Ce sont les cellules inflammatoires ou les messagers (cytokines/chimiokines) qui entraînent des modifications phénotypiques de l’endothélium et des cellules musculaires lisses. Il en résulte un cercle vicieux à rétroaction fermée. L’anévrisme active alors des mécanismes d’autoréparation et tente de s’autoréguler et d’établir un équilibre stable.
Cet état stabilisé peut durer plusieurs années, jusqu’à ce qu’un deuxième événement survienne et fasse basculer cet équilibre. Le professeur Hasan et son équipe veulent maintenant découvrir ce qui déclenche ce deuxième événement. Ce serait une autre réponse importante à la compréhension de la maladie en ce qui concerne l’instabilité des anévrismes.
Littérature :
- Aoki T, Frösen J, et al : Prostaglandin E2-EP2-NF-KB signaling in macrophages as a potential therapeutic target for intracranial aneurysms. Sci. Signal. Feb. 2017 : Vol. 10, Issue 465, DOI : 10.1126/scisignal.aah 6037.
- Ishibashi R, Aoki T, et al : Contribution des mastocytes à la formation de l’anévrisme cérébral. Curr Neurovasc Res. 2010(7) : 113-124.
- Lindgren AE, et al : La forme irrégulière de l’anévrisme intracrânien indique le risque de rupture, quelle que soit sa taille, dans une cohorte basée sur la population. Accident vasculaire cérébral 2016 ; 47(5) : 1219-1226.
- Etminan N, et al : The unruptured intracranial aneurysm treatment score. Neurology 2015. vol. 85 no. 10 ; 881-889.
- Frösen J, et al : Expression du récepteur du facteur de croissance et remodelage des parois de l’anévrisme de l’artère cérébrale sacculaire : implications pour la thérapie biologique de prévention de la rupture. Neurosurgery (en anglais). 2006 ; 58(3) : 534-541.
- Wagenseil J, Mecham RP : Elastine dans la rigidité et l’hypertension des grosses artères. J Cardiovasc Transl Res. 2012 ; 5(3) : 4-73.
- Frösen J, et al : Le remodelage de la paroi de l’anévrisme de l’artère cérébrale sacculaire est associé à la rupture : analyse histologique de 24 cas non rompus et 42 cas rompus. Accident vasculaire cérébral 2004 ; 35(10) : 2287-2293
- Hasan DM, et al : Aspirine as a promising agent for decreasing incidence of cerebral aneurysm breakdown. Accident vasculaire cérébral 2011(42) : 3156-3162.
- Chalouhi N, et al : Review of cerebral aneurysm formation, growth, and rupture. Accident vasculaire cérébral 2013(44) : 3613-3622.
- Hasan D, et al : Macrophage imbalance (M1 vs. M2) and upregulation of mast cells in wall of rocked human cerebral aneurysms : preliminary results. J Neuroinflammation. 2012(9) : 222.
InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2017 ; 15(4) : 32-33