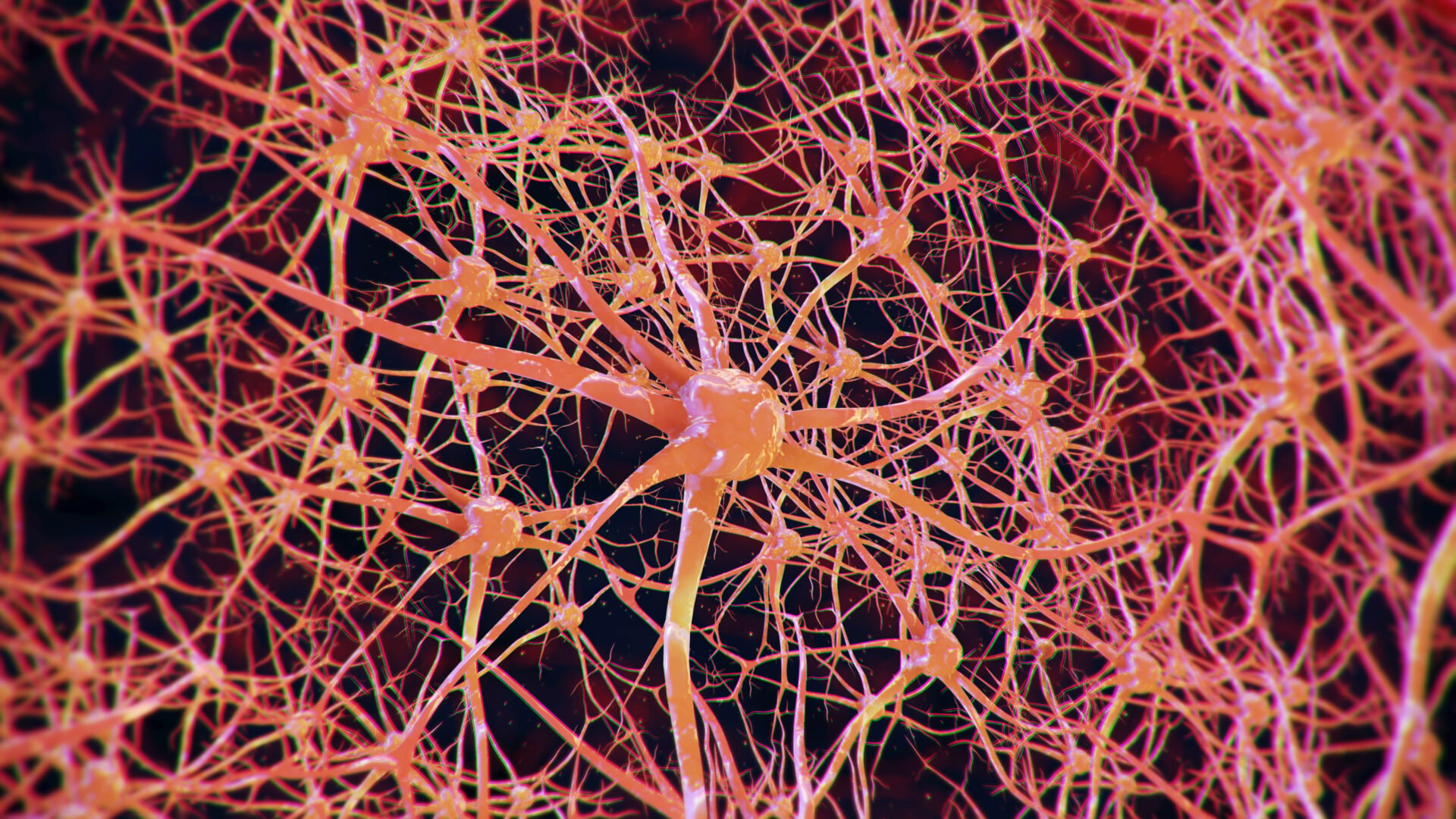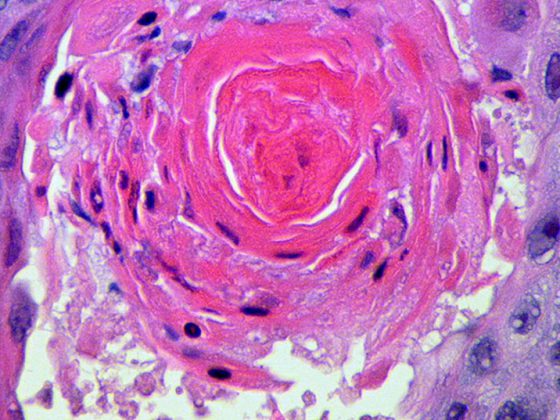Malgré les temps difficiles qui ont prévalu ces dernières années, tant le traitement que le parcours des personnes vivant avec la SEP et affectées par cette maladie n’ont cessé d’évoluer. De nouvelles données sur la prise en charge de la SEP et des maladies apparentées ont donc été présentées lors de la réunion conjointe de l’ECTRIMS et de l’ACTRIMS. La physiopathologie est peu à peu mieux comprise et débouche sur un traitement plus ciblé des personnes concernées.
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie hétérogène dont il est difficile de prédire l’évolution. De nombreux modèles de prédiction de la sclérose en plaques utilisent du sang prélevé en périphérie, qui est certes significatif, mais qui peut ne pas détecter les changements subtils de la maladie dans le SNC, qui sont plus significatifs pour la progression de la maladie. L’hypothèse a été émise qu’en mesurant les protéines synthétisées au niveau intrathécal et impliquées dans l’inflammation, l’activation gliale et les lésions du SNC, il était possible d’établir des modèles prédictifs de l’activité de la maladie. Afin de déterminer la relation entre les protéines intrathécales et l’activité à court terme de la maladie dans la SEP rémittente (RRMS), la synthèse intrathécale de 46 médiateurs de l’inflammation et de 14 marqueurs de lésions du SNC ou d’activation gliale a été mesurée dans des échantillons de sérum et de LCR appariés provenant de 47 patients atteints de SEP ayant subi une ponction lombaire à des fins de diagnostic [1].
Tous les patients ont été suivis pendant 12 mois dans le cadre d’une étude de suivi rétrospective et ont finalement été classés comme actifs (développement d’une activité clinique et/ou radiologique de la maladie au cours de la première année de suivi) ou non actifs (absence d’activité de la maladie). 27 patients atteints de maladies neurologiques non inflammatoires (NIND) ont été inclus comme témoins négatifs. Les données ont été soumises à une analyse d’expression différentielle et à une modélisation de réseau afin de définir la neuroinflammation et les lésions du SNC qui sont pertinentes pour l’activité à court terme de la maladie dans le RRMS. L’analyse de réseau a révélé un lien positif clair entre IgG1 et CXCL10, lié à l’activité de la maladie dans les 12 mois. L’analyse de la survie sans activité de la maladie a montré que les patients sans corrélation IgG1-CXCL10 ont un meilleur taux de survie en cas d’activité de la maladie que les patients sans corrélation significative.
Diagnostic différentiel par IRM
Le diagnostic différentiel entre le syndrome de Susac (SuS), la sclérose en plaques (SEP) et l’angiite primaire du système nerveux central (PACNS) reste difficile à établir en pratique clinique. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est un outil précieux pour le diagnostic de ces maladies, mais son interprétation peut être complexe. C’est pourquoi les patients SuS d’une cohorte latino-américaine ont été comparés aux données de patients atteints de SEP et de PACNS [2]. L’échantillon a été divisé en un groupe de formation et un groupe test. Le groupe de formation a été entraîné avec les variables qui ont montré indépendamment un pouvoir prédictif du résultat “diagnostic des élèves” et un modèle de régression logistique multivarié a été réalisé. Les coefficients obtenus pour chaque variable dans le modèle de régression logistique multivariée ont été arrondis à l’entier le plus proche afin d’attribuer une valeur de score à la présence de chaque caractéristique dans l’IRM.
Ont été inclus 46 patients SuS, 37 patients MS et 19 patients PACNS. L’analyse de régression logistique a montré que les “boules de neige”, les “rayons”, l’implication du corps calleux et les lésions capsulaires internes ressemblant à un collier de perles augmentaient la probabilité de SuS comme diagnostic final, tandis que la présence de doigts de Dawson prédisait négativement le diagnostic. Le score de diagnostic comprenait trois points pour les boules de neige, deux points pour les rayons, un point pour l’atteinte du corps calleux et un point pour l’atteinte de la capsule interne, et cinq points étaient retirés en cas de présence de doigts de Dawson. Le cut-off pour le diagnostic de SuS a été fixé à ≥5 points. Une sensibilité (83%), une spécificité (100%) et une précision (94,7%) élevées ont été trouvées pour distinguer les SuS dans des conditions de MS et de PACNS.
Le traitement de la NMOSD en ligne de mire
La maladie du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) est une maladie auto-immune chronique caractérisée par des crises récurrentes dans le système nerveux central, entraînant des dommages neurologiques permanents et des handicaps cumulatifs qui affectent la qualité de vie liée à la santé. Une comparaison indirecte ajustée (Matching Adjusted Indirect Comparison, MAIC), utilisant des crises évaluées par un comité, a permis de réaliser une comparaison d’étude robuste et rigoureuse entre deux traitements actuels de la NMOSD, l’inébilizumab et le satralizumab, afin d’aider à prendre des décisions thérapeutiques éclairées et fondées sur des preuves [3]. Un MAIC ancré a comparé l’efficacité relative de l’inébilizumab à l’éculizumab et au satralizumab sur la base de données publiées issues d’essais contrôlés randomisés chez des adultes atteints de NMOSD séropositive à l’aquaporine 4 (AQP4+).
Le risque relatif de crise de NMOSD sous inébilizumab par rapport à l’éculizumab et au satralizumab était de 1,51 et 0,49, respectivement. Les années de vie calculées ont montré un avantage pour l’inébilizumab (21,90) par rapport à l’éculizumab (16,02) et au satralizumab (20,79). L’inébilizumab (12,55) a également présenté un avantage en termes d’années de vie corrigées de la qualité par rapport à l’éculizumab (8,23) et au satralizumab (11,34). L’utilisation de l’IAA pour analyser le risque relatif de crise de NMOSD a montré des résultats plus importants pour le traitement par l’inébilizumab que ceux rapportés précédemment. En outre, le traitement par inébilizumab a donné de meilleurs résultats en termes d’années de vie attendues et d’années de vie ajustées en fonction de la qualité, par rapport au satralizumab ou à l’éculizumab. L’efficacité relative et l’arrêt du traitement ont été les facteurs les plus importants pour les résultats.
Différences entre les sexes dans la SEP
Dans la sclérose en plaques (SEP), il existe un fort dimorphisme sexuel qui se reflète dans le modèle expérimental de SEP chez la souris TCR1640 : Les femelles ont une maladie récurrente-rémittente, tandis que les mâles présentent un phénotype progressif de la maladie. Il a récemment été démontré que le sexe des cellules immunitaires transférées par adoption, et non le sexe de la souris receveuse, est le déterminant primaire du phénotype de la maladie dans ce modèle. Pour mieux comprendre les déterminants moléculaires de cette observation spécifique au sexe, il est nécessaire de caractériser les signatures transcriptomiques des cellules immunitaires infiltrantes du système nerveux central (SNC). L’objectif d’une étude était donc d’examiner les signatures génétiques responsables des différences entre les sexes des cellules immunitaires infiltrant le SNC dans le modèle expérimental d’encéphalomyélite auto-immune (EAE) de la SEP [4]. Pour ce faire, un transfert adoptif de cellules immunitaires provenant de cinq souris TCR1640 mâles et de six souris TCR1640 femelles a été réalisé chez des souris SJL/J sauvages. Lors de l’apparition de la maladie, sept jours après le transfert, des cellules immunitaires infiltrant le SNC de souris mâles et femelles ont été isolées et traitées pour l’ARNseq à cellule unique (scRNAseq) avec 10x Genomics et analysées avec Seurat.
Après le prétraitement, 87 121 cellules immunitaires infiltrant le SNC ont été trouvées et, sur la base de la transcriptomique, 18 clusters cellulaires différents ont été identifiés. Le regroupement hiérarchique des échantillons sur la base de la proportion de ces 18 clusters a montré une bonne séparation des hommes et des femmes. Compte tenu du rôle présumé des cellules T dans l’EAE, les cellules T ont été extraites, regroupées à nouveau et six sous-populations de cellules T ont été identifiées à l’aide de ScType. L’analyse en composantes principales (ACP), basée sur la proportion de ces cellules T nouvellement clusterisées, a de nouveau permis d’établir une nette séparation des cellules immunitaires entre les hommes et les femmes. Il est intéressant de noter qu’un nombre significativement plus élevé de cellules T CD8+ infiltrant le SNC a été observé chez les mâles que chez les femelles. En revanche, les femmes présentaient un nombre significativement plus élevé de cellules T CD4+ et de cellules T induites par les régulateurs par rapport aux hommes. Ces résultats indiquent un fort déterminisme lié au sexe dans le transcriptome et l’abondance relative des cellules immunitaires infiltrant le SNC.
Anticorps du LCR en cas de PPMS
On a récemment découvert que les anticorps du LCR de patients atteints de sclérose en plaques primaire progressive (SPP), lorsqu’ils sont injectés à des souris, sont associés aux caractéristiques cliniques et pathologiques de la maladie. Cela n’a pas été observé avec les anticorps du LCR de patients atteints de SEP rémittente ou secondairement progressive. Cependant, la spécificité de ces anticorps associés au PPMS ou leurs mécanismes d’action ne sont pas encore élucidés. Pour ce faire, le LCR de patients atteints de SEP a été prélevé par ponction lombaire et des cellules individuelles ont été isolées par FACS.
Par PCR, les chaînes lourdes et légères de chaque cellule ont été séquencées, puis exprimées et purifiées dans des vecteurs plasmidiques afin de produire des anticorps recombinants. Les anticorps associés à la faiblesse motrice, à la démyélinisation et à l’astrogliose dans des modèles expérimentaux ont été évalués pour leur réactivité à une plate-forme de criblage du protéome humain par micropuces. Toutes les cibles identifiées ont ensuite fait l’objet d’une analyse plus approfondie de leur réactivité par Western Blot et immunohistochimie [5].
Une réactivité a été observée contre TIA1, une protéine de liaison à l’ARN associée aux granules cytotoxiques, AKR7A3, une protéine de la famille de l’aldo-céto-réductase, et LAPTM4A, une protéine lysosomale de la transmembrane 4. Des tests supplémentaires sur ces anticorps pathogènes dans un modèle expérimental de rongeur pourraient permettre de mieux comprendre leur mécanisme d’action.
Inflammation en cas de syndrome prémenstruel
L’inflammation chronique compartimentée dans des niches du système nerveux central telles que les leptoméninges, les espaces périvasculaires et le plexus choroïde joue un rôle clé dans la pathogenèse de la sclérose en plaques progressive (SPP). En particulier, il a été constaté qu’un niveau élevé d’inflammation méningée est associé à un gradient “surface-in” considérable de perte de neurones et d’activation microgliale dans la LGM et la NAGM avec une évolution précoce et sévère de la maladie. L’objectif était de mieux caractériser l’inflammation en établissant des profils génétiques liés à l’immunité des infiltrats méningés en cas de SPM [6].
Des coupes fixées au formol et incluses dans la paraffine (FFPE) de 60 cas de SEP progressive post-mortem et de dix donneurs sains ont été utilisées pour des analyses immunohistochimiques et morphométriques du nombre, du phénotype et de la localisation des cellules immunitaires dans les méninges. Six cas de SEP avec une inflammation méningée prononcée et trois témoins ont été sélectionnés pour utiliser une nouvelle technologie (CARTANA sur un microscope Nikon Ti2-E à résolution de cellule unique) qui permet une analyse de séquençage génétique in situ (ISS) d’un pool sélectionné de 157 gènes liés à l’immunité. Cette technique consiste à séquencer l’ARNm directement dans la région d’intérêt sélectionnée (ROI : infiltrat méningé).
Une analyse détaillée du nombre de cellules méningées a montré une augmentation significative du nombre de cellules B dans 26 des 60 cas de SEP étudiés (43%), caractérisés par le degré le plus élevé d’inflammation méningée. En particulier, le nombre de lymphocytes B était plus élevé que celui des macrophages et des lymphocytes T. L’analyse ISS a révélé une augmentation significative de 85 des 157 gènes étudiés dans les méninges enflammées par la SEP par rapport aux contrôles. L’analyse des voies de signalisation KEGG a révélé que ces gènes étaient principalement associés à l’interaction des protéines virales avec les récepteurs de cytokines/cytokines, à la signalisation des récepteurs de cellules B, à l’expression de PD-L1 et aux voies de contrôle de PD-1, ainsi qu’à la signalisation du TNF. L’analyse de l’ontologie des gènes a montré que la plupart des processus biologiques associés à ces molécules concernent la régulation de la réponse immunitaire de type 2, la régulation de la chimiotaxie des cellules dendritiques, la fusion membranaire impliquée dans la pénétration du virus dans la cellule hôte et la régulation de l’activation et de la polarisation des lymphocytes T. Les résultats de l’analyse de l’ontologie des gènes ont montré que la plupart des processus biologiques associés à ces molécules concernent la régulation de la réponse immunitaire de type 2.
Cela suggère que des réactions immunitaires et inflammatoires hautement spécialisées, impliquant peut-être une immunité antivirale, persistent dans les méninges de la SEP progressive et maintiennent une inflammation chronique intrathécale.
Congrès: 9. Kongress der European und American Committee for Treatment and Research in MS (ECTRIMS-ACTRIMS) 2023
Littérature :
- Welsh N, et al.: Correlation of intrathecal levels of IgG1 and CXCL10 predict disease activity in multiple sclerosis. P004/2117. MSMilan2023 – Paper Poster – Session 1. Multiple Sclerosis Journal 2023.
- Marrodan M, et al.: Diagnostic MRI score to differentiate Susac Syndrome from Multiple Sclerosis and Primary Angiitis of the Central Nervous System. P007/864. MSMilan2023 – Paper Poster – Session 1. Multiple Sclerosis Journal 2023.
- Paul F, et al.: Matching-Adjusted Indirect Comparison of Current Treatments for NMOSD and Evaluation of Long-Term Effectiveness. P011/1038. MSMilan2023 – Paper Poster – Session 1. Multiple Sclerosis Journal 2023.
- Rébillard RM, et al.: Transciptomic signatures of infiltrating immune cells underpinning sex differences in experimental autoimmune encephalomyelitis. P111/1380. MSMilan2023 – Paper Poster – Session 1. Multiple Sclerosis Journal 2023.
- Lin J, et al.: Investigation of cerebrospinal fluid antibody specificity in primary progressive MS. P120/2316. MSMilan2023 – Paper Poster – Session 1. Multiple Sclerosis Journal 2023.
- Mastantuono M, et al.: Combined neuropathology and in situ sequencing characterization of meningeal inflammation in progressive multiple sclerosis. P121/1630. MSMilan2023 – Paper Poster – Session 1. Multiple Sclerosis Journal 2023.
InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2023; 21(6): 34–35