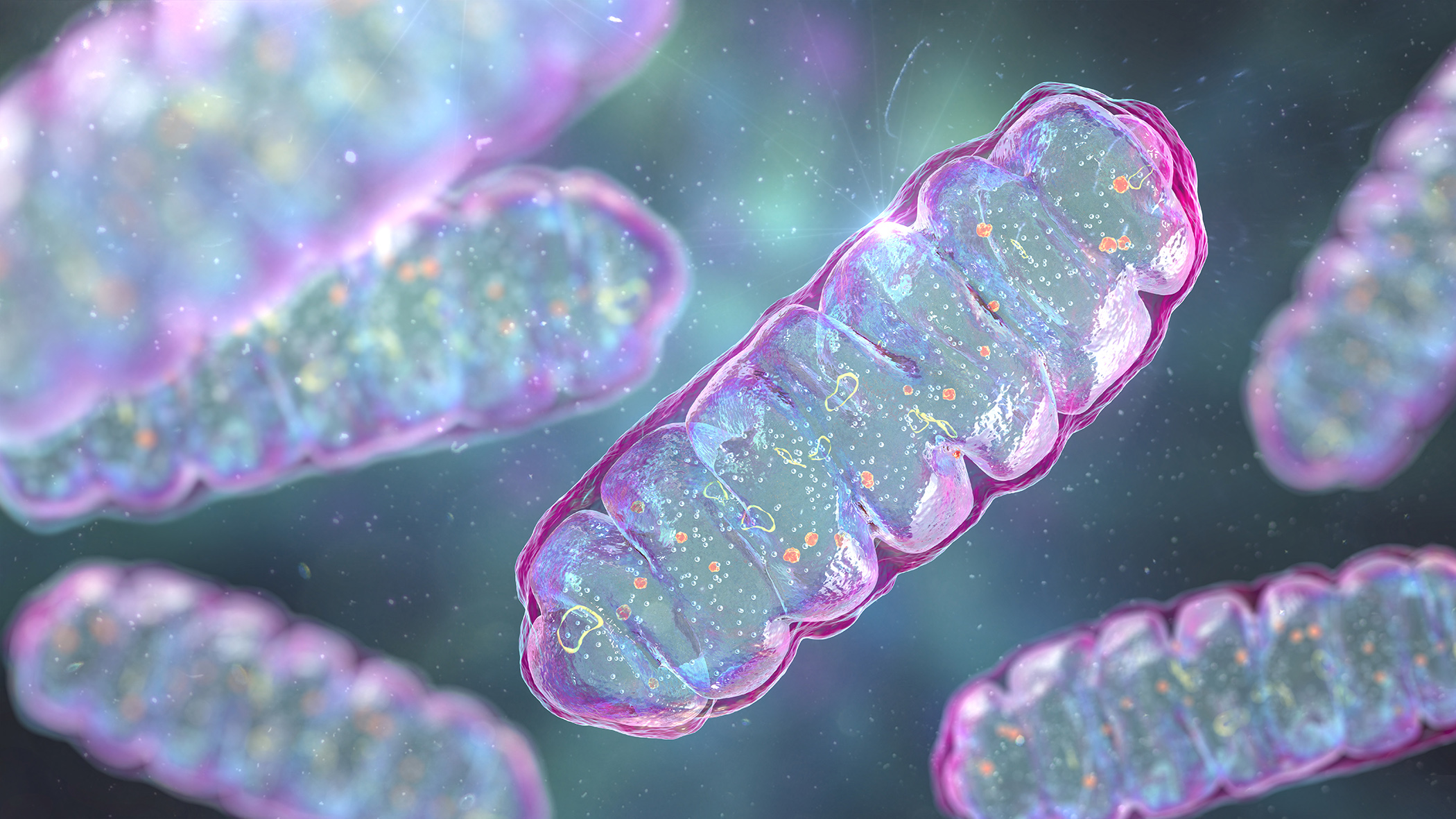En utilisant une molécule du virus VIH, des chercheurs introduisent une protéine antidépressive directement dans les cellules nerveuses. Dans le modèle de souris, l’effet thérapeutique est nettement plus rapide et plus important qu’avec les médicaments actuels.
Les antidépresseurs sont les médicaments psychotropes les plus utilisés. Mais ils n’améliorent souvent les symptômes qu’après des semaines ou des mois, ont des effets secondaires importants et n’agissent pas du tout chez de nombreuses personnes concernées. Aujourd’hui, des scientifiques de l’hôpital universitaire de Fribourg présentent une nouvelle approche thérapeutique dans un modèle de souris qui pourrait résoudre en grande partie ce problème : Ils ont couplé la protéine de signalisation thérapeutiquement active Homer1a à une molécule d’acheminement qui permet également au virus VIH d’entrer dans les cellules. Ainsi, la substance active pénètre dans la cellule nerveuse et peut interférer directement avec les voies de signalisation de la cellule.
“La substance active déploie son effet antidépresseur sans détours et donc nettement plus rapidement et plus fortement que les antidépresseurs classiques”, explique le responsable de l’étude, le Dr Tsvetan Serchov, chef de groupe de recherche dans le service de neurochirurgie stéréotaxique et fonctionnelle de la clinique de neurochirurgie de l’hôpital universitaire de Fribourg. L’étude a été publiée le 13 août 2019 dans la prestigieuse revue Neuron.
Une approche thérapeutique datant des années 1980 pourrait prendre une nouvelle importance
Les chercheurs ont utilisé un processus connu depuis la fin des années 1980, mais jusqu’à présent peu utilisé à des fins thérapeutiques. Ils ont lié une minuscule protéine du virus VIH à la protéine Homer1a, importante pour le traitement de la dépression. La protéine VIH peut facilement traverser la membrane cellulaire en raison de ses propriétés physico-chimiques. Ce faisant, il fait passer la protéine homer thérapeutiquement active à travers la barrière hémato-encéphalique et dans la cellule.
Après avoir administré la double molécule dans le sang des souris, les scientifiques ont constaté que l’effet antidépresseur ne mettait qu’une heure environ à se manifester. Ces dernières années, les chercheurs fribourgeois avaient identifié la protéine Homer1a comme un médiateur cellulaire important dans le traitement de la dépression. “Nous avons pu montrer dans des études précédentes que non seulement les médicaments, mais même l’effet antidépresseur de la privation de sommeil entraînaient l’activation des protéines homer”, explique Serchov.
Dans l’étude actuelle, qui a été réalisée en étroite collaboration avec des médecins et des scientifiques de la clinique de psychiatrie et de psychothérapie de l’hôpital universitaire de Fribourg, les chercheurs ont également décrypté la manière dont les protéines Homère déploient leur effet antidépresseur. Ils activent des protéines de surface appelées récepteurs AMPA, ce qui rend la cellule plus réactive aux stimuli. Cela facilite l’adaptation et l’apprentissage. Si les protéines Homère et AMPA sont moins produites, comme c’est le cas dans le cerveau des personnes souffrant de dépression sévère, ces processus sont plus difficiles pour les personnes concernées.
Utilisation envisageable comme spray nasal
“L’approche thérapeutique s’est avérée très efficace en laboratoire et dans les modèles animaux. D’autres études doivent maintenant être menées, sur les éventuels effets secondaires, le métabolisme de la substance active et l’utilisation psychiatrique concrète”, explique Serchov. “A long terme, on peut imaginer que la substance active soit également utilisée sous forme de spray nasal. Cela lui permettrait d’atteindre directement la bonne région du cerveau, le cortex préfrontal”.
Source : Enhanced mGlu5 signaling in excitatory neurons promotes rapid antidepressant effects via AMPA receptor activation DOI : 10.1016/j.neuron.2019.07.011
www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(19)30637-3
Clinique universitaire de Fribourg (D)
InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2019 ; 17(5) : 31