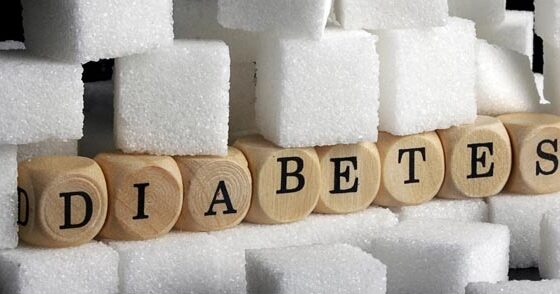Les maladies rénales sont difficiles à diagnostiquer car elles ne présentent pas de symptôme clinique typique. En général, une telle maladie ne peut être identifiée que par l’analyse d’un modèle de différents signes subjectifs et objectivement détectables. Il s’agit notamment de symptômes non spécifiques et courants tels que l’hypertension ou l’intolérance à la performance du patient.
Pourquoi est-il important de diagnostiquer une maladie rénale à un stade précoce ? Il existe pour cela des arguments très différents, qui sont pertinents pour le patient à des degrés divers.
Tout commence par le fait que l’altération de la fonction rénale est une maladie indicatrice d’un risque cardiovasculaire accru. Il faut donc tout faire pour contrôler ou minimiser les autres facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Bien entendu, une fonction rénale réduite s’accompagne d’une modification de la pharmacocinétique de nombreuses substances et doit donc être prise en compte lors de toute intervention médicamenteuse. Les fonctions endocrines des reins concernent de manière décisive l’équilibre du calcium et du phosphate, la formation du sang et la pression artérielle, mais aussi de nombreuses autres boucles de régulation. Bien qu’une évaluation et un ajustement minutieux du traitement médicamenteux soient régulièrement nécessaires chez les patients dont la fonction rénale est altérée, le médecin généraliste peut longtemps assumer des fonctions de contrôle importantes. A partir d’une atteinte chronique de la fonction rénale CKD 4 et moins, correspondant à un taux de filtration glomérulaire <30 ml/min/1,73 m2, il convient d’assurer un lien fixe avec un néphrologue.
Une maladie rénale peut apparaître de manière primaire sans cause sous-jacente. Dans ce cas, en fonction de la maladie sous-jacente, le néphrologue doit vérifier, outre le traitement de soutien, si un traitement spécifique doit être mis en place.
Les modifications rénales qui ont une cause secondaire sont particulièrement importantes. Il peut s’agir d’une maladie systémique, d’une tumeur maligne ou d’une infection dont la première manifestation ou la manifestation d’organe se situe dans le rein. Le rein offre donc une fenêtre pour la détection d’autres maladies. Nous en avons un exemple dans notre consultation. Un homme est envoyé pour un examen de protéinurie avec une fonction rénale peu altérée. Une biopsie rénale révèle une glomérulonéphrite membraneuse. L’une des causes de cette maladie est une affection maligne qui se présente sous la forme d’un petit carcinome in situ de l’œsophage. Celui-ci peut être réséqué de manière curative et la fonction rénale se normalise ensuite, la protéinurie n’est plus détectable.
Le traitement de substitution rénale affecte fortement la qualité de vie des patients et constitue également une option thérapeutique coûteuse. C’est pourquoi, outre le traitement des dégradations de la fonction rénale déjà survenues, il est nécessaire de suivre de près les populations à risque et d’éviter les situations ou les facteurs de risque d’atteinte rénale.
Les groupes à risque se définissent comme des personnes ou des groupes de personnes qui ont souvent besoin de dialyse, c’est-à-dire qui ont une réserve fonctionnelle insuffisante pour le reste de leur vie. Il s’agit de patients nés avec une réserve de néphrons déjà réduite et reconnaissables à leur poids de naissance diminué. Si les femmes ont souffert d’une maladie hypertensive pendant leur grossesse, par exemple une pré-éclampsie, le risque de développer une maladie rénale nécessitant une dialyse est multiplié. Les diabétiques ont deux fois plus de sténoses de l’artère rénale que les non-diabétiques, avec des conséquences fonctionnelles parfois importantes. Outre sa fonction d’indicateur de lésion, la protéinurie est également un bon paramètre d’évolution. Très tôt, des études ont montré que les patients présentant une protéinurie importante présentaient un déclin plus rapide de la fonction rénale. Comme dans d’autres études, il était frappant de constater que la pression artérielle jouait un rôle important. Et en effet, le niveau de pression artérielle est le facteur de progression le plus pertinent. Bien que l’on ne sache pas encore à quel point la pression artérielle doit être réduite, des valeurs inférieures à 140 mmHg pour la systolique et 90 mmHg pour la diastolique sont certainement souhaitables. Après qu’une forte réduction de la pression artérielle a été plutôt contre-productive dans le cas de diverses autres maladies, il faut éviter une réduction rapide et agressive de la pression artérielle vers des valeurs cibles encore plus basses. Cependant, sur la base de plusieurs petites études, rien ne s’oppose à une réduction contrôlée et prudente de la pression artérielle en dessous de 130/80 mmHg, voire plus bas, si le patient et, le cas échéant, les zones vasculaires déjà compromises comme le SNC, le cœur et même les reins restent sous surveillance. Même si une réduction adéquate de la pression artérielle est souvent difficile à obtenir, le jeu en vaut la chandelle pour le patient, même si cela permet de repousser d’un an seulement le traitement par dialyse. Une partie de ces 80 000 francs peut être avantageusement investie par le médecin généraliste dans la réduction du risque cardiovasculaire et de la mortalité qui résulte d’un bon contrôle de la pression artérielle.
Pour des raisons de systématique, les articles suivants sont divisés en un chapitre sur les maladies glomérulaires et un autre sur les maladies tubulo-interstitielles. Il ne s’agit pas d’une présentation exhaustive de toutes les maladies rénales possibles, mais d’exposer les principes de base et les différences entre les maladies de ces deux structures importantes du néphron.
Un troisième article est consacré à une maladie rénale très différente mais très fréquente, les calculs rénaux. 5 à 10 % de la population ont un calcul rénal une fois dans leur vie, et environ 50 % d’entre eux subissent une récidive. Cela montre l’importance d’une évaluation ciblée et d’une prophylaxie efficace des récidives. Andreas Pasch décrit de manière très pratique quels patients souffrant de calculs rénaux doivent être examinés plus avant, quand et sous quelle forme, et quelles recommandations doivent leur être faites.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Cordialement, votre
Prof. Markus Georg Mohaupt, docteur en médecine