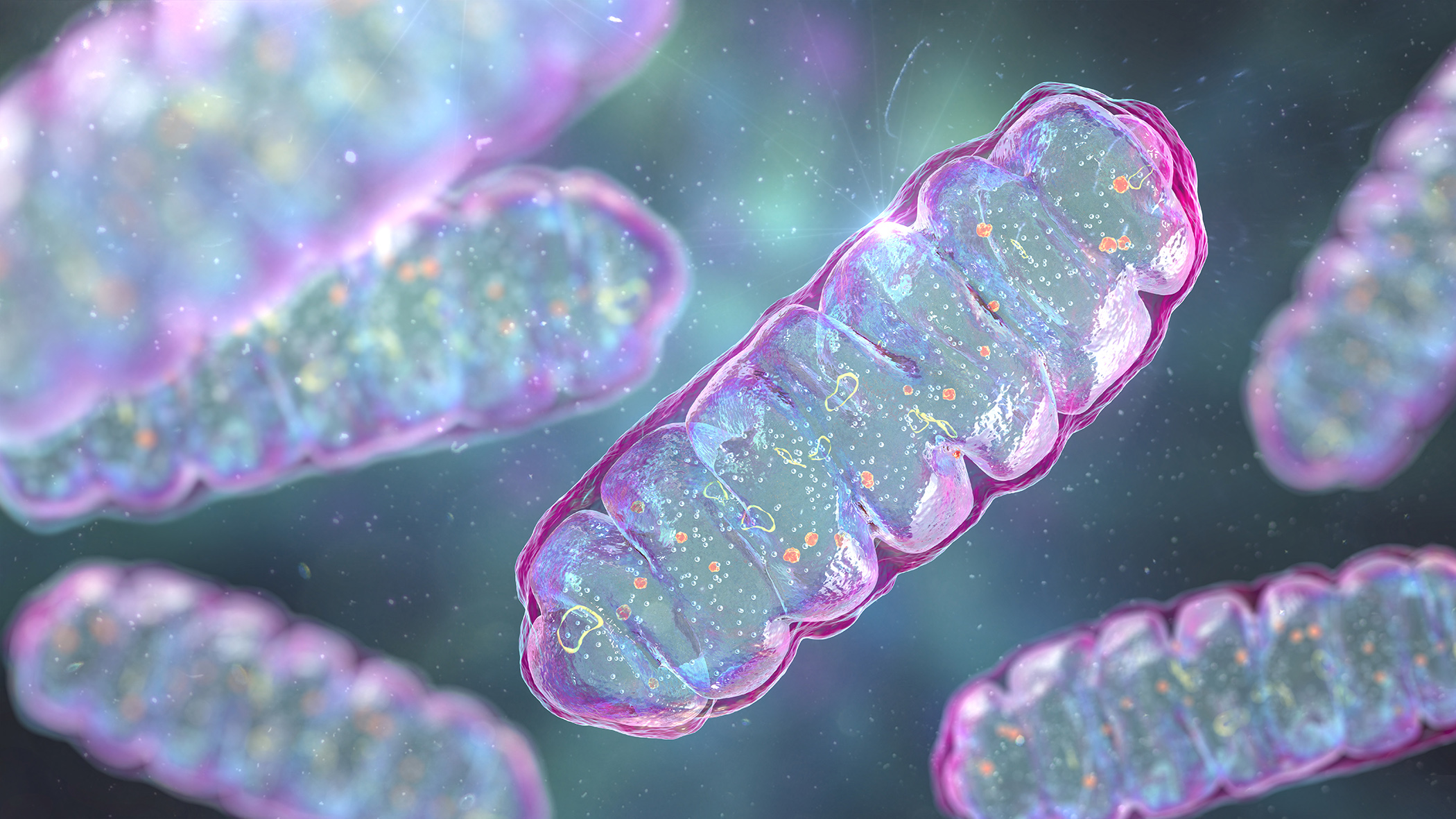Le développement de médicaments biologiques très efficaces a été précédé par des efforts de recherche pendant plusieurs décennies. Les progrès réalisés dans le domaine de l’analyse immunopathogénique et de la génétique moléculaire ont largement contribué à la création de ces médicaments systémiques innovants. La conférence mémorielle de Guenter Goerz de la réunion annuelle de l’Association pour la recherche en dermatologie de cette année était consacrée à ce sujet et couvrait les grandes étapes de la recherche sur le psoriasis jusqu’aux médicaments biologiques disponibles aujourd’hui.
Les preuves cliniques et expérimentales ont permis d’établir que le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau génétiquement prédisposée et à médiation immunitaire. (Fig. 1). Wolf-Henning Boehncke, médecin-chef du service de dermatologie des Hôpitaux Universitaires de Genève [1]. Le traitement réussi de patients atteints de psoriasis par la ciclosporine, un immunosuppresseur qui inhibe la prolifération des lymphocytes T et la production de cytokines, a été la première preuve clinique d’un rôle possible des lymphocytes T dans la pathogenèse du psoriasis [2,3]. D’autres médicaments ciblant les cellules T, tels que les anticorps monoclonaux anti-CD4 et l’antigène 4 associé aux lymphocytes T cytotoxiques (CTLA4), ont également montré une efficacité thérapeutique significative dans le traitement du psoriasis [4–6]. Une étude in vitro antérieure a montré que les lymphocytes T CD4+ activés provenant de lésions psoriasiques peuvent augmenter la prolifération des kératinocytes via la sécrétion d’interféron-γ(IFN-γ)8 , et l’établissement d’un modèle de transplantation xénogénique chez la souris confirme en outre l’importance des lymphocytes T dans le psoriasis [4–6].
Découverte d’auto-antigènes liés au psoriasis
La découverte que le psoriasis est une maladie auto-immune médiée par les cellules T soulève la question importante de savoir comment les cellules T pathogènes sont activées au cours de la maladie. Pendant longtemps, on a supposé que le peptide antimicrobien LL37, qui est surexprimé dans la peau psoriasique, jouait un rôle dans ce processus. Les chercheurs n’ont toutefois réussi à en apporter la preuve empirique qu’il y a quelques années. Dans un article publié en 2014 dans Nature Communication Lande et al. ont rapporté qu’une surexpression chronique de LL37 provoquait une activation prolongée de ces récepteurs médiée par les acides nucléiques, ce qui se traduisait par une maturation des cellules dendritiques (DC) [7]. Depuis lors, trois autres auto-antigènes liés au psoriasis ont été découverts en plus de LL-37 : la cathélicidine, ADAMTSL5, PLA2G4D et la kératine-17. Chez de nombreux patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, on a constaté la présence de cellules T autoréactives contre ces auto-antigènes [8].
| “Cellules T de la mémoire résidant dans les tissus”. Actuellement, la recherche sur le psoriasis se concentre sur les cellules T à mémoire CD8+ (Tissue-resident memory T cells, TRMs) qui résident dans la peau. Il s’agit d’une population spécifique de cellules T à mémoire dans l’épiderme et le derme, qui maintient une mémoire immunologique pendant des années et contribue aux lésions typiques [25]. Même dans les zones de la peau qui n’ont jamais été touchées par des lésions, les patients atteints de psoriasis présentent un nombre plus élevé de cellules TRM que les personnes en bonne santé [25]. Une hypothèse qui fait l’objet d’études empiriques récentes est qu’en réduisant l’accumulation de cellules TRM dans la peau, l’évolution à long terme de la maladie psoriasique peut être influencée positivement [27]. |
Les lymphocytes T comme déclencheurs du psoriasis
Le rôle important des lymphocytes T a été démontré dans le cadre d’un modèle de transplantation xénogénique [9,10]. L’observation que les greffes de peau non lésionnelle de patients atteints de psoriasis ont entraîné le développement spontané du phénotype de la peau lésionnelle chez des souris immunodéficientes a été considérée comme une preuve de la présence de “cellules T de la mémoire résidant dans les tissus” (TRM) [11]. En plus des anticorps anti-CD4 et de l’immunoglobuline de l’antigène 4 associée aux lymphocytes T, deux agents inhibant les fonctions des cellules T ont été développés, l’efalizumab et l’alefacept [2]. L’efalizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui se lie à la sous-unité CD11a de l’antigène LFA-1 (Lymphocyte Function-associated antigen-1), qui se trouve à la surface des lymphocytes. L’efalizumab a été approuvé en Suisse et dans l’UE en 2004. Cependant, ce médicament biologique n’est plus commercialisé depuis quelques années en raison d’une mise en garde émise par la FDA concernant les risques d’infection tels que la septicémie bactérienne, la méningite virale, les maladies fongiques invasives et la leucoencéphalopathie multifolaque progressive [2]. L’alefacept est une protéine de fusion recombinante composée de parties de la molécule de signalisation LFA3 de cellules présentatrices d’antigènes et de l’anticorps IgG1 [2]. L’alefacept empêche le LFA3 de se lier aux cellules T-mémoires activées, qui sont impliquées dans le développement du psoriasis. L’alefacept a été approuvé aux États-Unis en 2003, mais n’est plus commercialisé depuis 2011. Dans l’UE, le médicament biologique n’a pas reçu d’autorisation de mise sur le marché à ce jour.
Importance physiopathologique de l’axe IL-23/Th17
Le fait que l’axe interleukine (IL)-23/T-cellule auxiliaire (Th)17 joue un rôle important dans la physiopathologie du psoriasis et de l’arthrite psoriasique est une découverte essentielle [14]. Mais au départ, on pensait que le psoriasis impliquait une réponse Th1, alimentée par les cytokines IFNγ et IL-12 [15]. Cependant, l’absence d’efficacité des traitements anti-IFNγ dans le traitement du psoriasis [16] s’y opposait. Lorsqu’une augmentation de l’expression de p40 a été découverte dans les lésions de psoriasis, cela a conduit à la conclusion initiale que l’expression d’IL-12 est augmentée dans le psoriasis [17]. Cependant, lorsqu’il a été démontré par la suite que la sous-unité p40 de l’IL-12 se trouvait également dans l’IL-23 [18], le Dr Lee et ses collègues ont pu montrer que l’expression accrue de p40 dans la peau psoriasique était due à l’IL-23 et non à l’IL-12 [17,19]. Comme l’IL-23 est impliquée dans l’axe Th17, tandis que l’IL-12 stimule le développement des cellules Th1, l’axe immunitaire IL-23/Th17 a ensuite été considéré comme central dans la pathogenèse du psoriasis [18,20]. Parallèlement, l’IL-23, le facteur de nécrose tumorale (TNF)-α et l’IL-17 ont été reconnus comme des cytokines pathogènes importantes dans le psoriasis. L’IL-23 régule le maintien des cellules Th17, tandis que l’IL-17 et le TNF-α médiatisent les fonctions effectrices des cellules immunitaires innées et adaptatives.
| La prédisposition : La génétique moléculaire fait la lumière sur la maladie Le psoriasis est une maladie multifactorielle dans laquelle le déterminisme génétique semble jouer un rôle important. Des études d’association pangénomiques ont permis d’identifier 36 loci de susceptibilité [12,13]. Le locus PSORS1 dans la région d’histocompatibilité sur le chromosome 6p21 semble avoir une importance particulière. C’est là que se trouve l’allèle HLA-Cw*0602, qui présente la plus forte association avec le psoriasis. Les progrès réalisés dans les technologies de génétique moléculaire et les méthodes d’analyse statistique ont permis d’identifier des voies biologiques pertinentes pour le psoriasis, telles que la barrière épidermique, les mécanismes associés à NFκB et les réponses immunitaires médiées par Th17 [2]. |
Des produits biologiques très efficaces – une réalisation moderne
La première génération de produits biologiques pour le traitement du psoriasis, qui ciblaient les cytokines, se concentrait sur le TNF-α [21]. Or, les inhibiteurs du TNF-α sont connus pour être des facteurs de risque d’infections graves des voies respiratoires inférieures ou d’infections de la peau et des tissus mous. Un autre inhibiteur d’interleukine, l’ustekinumab, a été mis sur le marché en 2009 (UE) et 2010 (CH). L’ustékinumab cible la sous-unité protéique p40 commune à l’IL-12 et à l’IL-23 et bloque la signalisation de leurs récepteurs respectifs. Dans l’étude ACCEPT publiée en 2010, l’ustékinumab s’est révélé supérieur à l’étanercept, un inhibiteur du TNF-α. Les taux de réponse PASI75 et PASI90 à la semaine 12 étaient respectivement de 73% et 44% pour l’ustékinumab, contre 56% et 23% pour l’étanercept. [29]. En revanche, dans les études comparant l’ustékinumab aux inhibiteurs de l’IL-17, le sécukinumab, le brodalumab et l’ixekizumab, l’inhibiteur de l’IL-12/23 a montré une efficacité thérapeutique significativement inférieure. [21]. L’approbation des inhibiteurs de l’IL-17 a été suivie par celle des inhibiteurs de l’IL-23, le guselkumab, le risankizumab et le tildrakizumab. Dans l’étude CLEAR publiée en 2017, le sécukinumab a été soumis à une comparaison tête-bêche avec l’ustékinumab [22]. Sur un échantillon de 676 sujets randomisés, l’inhibiteur de l’IL-17A s’est révélé significativement supérieur à l’ustékinumab à la semaine 52 en termes de taux de réponse PASI-90 (76% vs 61%) et d’IGA 0/1** (80% vs 65%) (p<0,0001 dans les deux cas). Un essai en tête-à-tête sur le sécukinumab (n=514) vs. le guselkumab (n=534) était l’étude ECLIPSE publiée en 2019 [23]. Sous traitement par l’inhibiteur de l’IL23p19, une proportion significativement plus élevée a obtenu une réponse PASI90 à la semaine 48 par rapport au sécukinumab (84% vs 70% ; p<0,0001). Dans les études comparant indirectement le tildrakizumab et le guselkumab, aucune des deux substances ne s’est révélée supérieure ou inférieure [30]. Une comparaison tête-bêche entre le bimekizumab (n=373) et le sécukinumab (n=370) a également été publiée en 2021 [24]. Le bimekizumab (double inhibition de l’IL17A et de l’IL17F) ne s’est pas révélé supérieur ou inférieur au sécukinumab (anti-IL17A).
** IGA= Investigator’s Global Assessment (0=sans parution, 1=presque sans parution)
Congrès : ADF Annual Meeting
Littérature :
- “Psoriasis – mirror image trends in cutaneous biology”, Guenter Goerz Memorial Lecture, Prof. Dr med. W.-H. Boehncke, 49th ADF Annual Meeting, Innsbruck, 22-25.02.2023.
- Cai Y, Fleming C, Yan J : Nouvelles perspectives sur les cellules T dans la pathogenèse du psoriasis. Cell Mol Immunol 2012 ; 9(4) : 302-309.
- Mueller W, Herrmann B : Cyclosporine A pour le psoriasis. N Engl J Med 1979 ; 301 : 555.
- Nicolas JF, et al : CD4 antibody treatment of severe psoriasis. Lancet 1991 ; 338 : 321.
- Prinz J, et al : Chimaeric CD4 monoclonal antibody in treatment of generalised pustular psoriasis. Lancet 1991 ; 338 : 320-321.
- Abrams JR, et al : Le blocage de la costimulation des lymphocytes T par l’antigène cytotoxique T lymphocyte-associated 4-immunoglobulin (CTLA4Ig) inverse la pathologie cellulaire des plaques psoriasiques, y compris l’activation des kératinocytes, des cellules dendritiques et des cellules endothéliales. J Exp Med 2000 ; 192 : 681-694.
- Lande R, et al : Le peptide antimicrobien LL37 est un auto-antigène des cellules T dans le psoriasis. Nat Commun 2014 ; 5 : 5621.
- Ten Bergen LL, et al : Connaissances actuelles sur les auto-antigènes et les auto-antibodies dans le psoriasis. Scand J Immunol 2020 ; 92(4) : e12945.
- Boehncke WH, et al : Tirer la gâchette sur le psoriasis. Nature 1996 ; 379 : 777.
- Boehncke WH, Brembilla NC : Autoreactive T-Lymphocytes in Inflammatory Skin Dis-eases. Front Immunol 2019 ; 10 : 1198.
- Boyman O, et al : Le développement spontané du psoriasis dans un nouveau modèle animal montre un rôle essentiel pour les cellules T résidentes et le facteur de nécrose tumorale-alpha. J Exp Med 2004 ; 199 : 731-736.
- Clop A, et al : An in-depth characterization of the major psoriasis susceptibility locus identi-fies candidate susceptibility allles within an HLA-C enhancer element. PLoS One 2013 ; 8(8) : e71690.
- Capon F, et al : Psoriasis et autres dermatoses à traits complexes : des loci aux voies fonctionnelles. J Invest Dermatol 2012 ; 132(3 Pt 2) : 915-922.
- Girolomoni G, et al : Le rôle de l’IL-23 et de l’axe immunitaire IL-23/TH 17 dans la pathogenèse et le traitement du psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017 ; 31(10) : 1616-1626.
- Schlaak JF, et al : Les cellules T impliquées dans le psoriasis vulgaire appartiennent au sous-ensemble Th1. J Invest Dermatol 1994 ; 102 : 145-149.
- Harden JL, et al : Humanized anti-IFN-gamma (HuZAF) dans le traitement du psoriasis. J Allergy Clin Immunol 2015 ; 135 : 553-556.
- Yawalkar N, et al : Expression of interleukin-12 is increased in psoriatic skin. J Invest Dermatol 1998 ; 111 : 1053-1057.
- Oppmann B, et al : Novel p19 protein engages IL-12p40 to form a cytokine, IL-23, with biological activities similar as well as distinct from IL-12. Immunity 2000 ; 13 : 715- 725.
- Lee E, et al. : Expression accrue de l’interleukine 23 p19 et p40 dans la peau lésionnelle de patients atteints de psoriasis vulgaire. J Exp Med 2004 ; 199 : 125-130.
- Aggarwal S, et al : L’interleukine-23 promeut un état distinct d’activation des cellules T CD4 caractérisé par la production d’interleukine-17. J Biol Chem 2003 ; 278 : 1910- 1914.
- Ten Bergen LL, et al : The TNF/IL-23/IL-17 axis-Head-to-head trials comparing different biologics in psoriasis treatment. Scand J Immunol 2020 Oct ; 92(4) : e12946.
- Blauvelt A, et al : Le sécukinumab est supérieur à l’ustekinumab dans le nettoyage de la peau des sujets atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère jusqu’à 1 an : résultats de l’étude CLEAR. J Am Acad Dermatol 2017 ; 76(1) : 60-69.e9.
- Reich K, et al : Guselkumab versus secukinumab pour le traitement du psoriasis modéré à sévère (ECLIPSE) : Résultats d’un essai contrôlé randomisé de phase 3. Lancet 2019 ; 394(10201) : 831-839.
- Reich K, et al : Bimekizumab versus secukinumab dans le psoriasis en plaques. N Engl J Med 2021 ; 385(2) : 142-152.
- Clark RA: Resident memory T cells in human health and disease. Sci Transl Med 2015 ; 7(269) : 269rv1
- Gallais Sérézal I, et al : A skewed pool of resident T cells triggers psoriasis-associated tissue responses in never-lesional skin from patients with psoriasis. J Allergy Clin Immunol 2019 ; 143 : 1444-1454.
- Eyerich K, et al : Le blocage de l’IL-23 par le guselkumab modifie potentiellement la pathogenèse du psoriasis : rationnel et protocole d’étude d’une étude de phase 3b, randomisée, en double aveugle, multicentrique chez des participants atteints de psoriasis de type plaque modéré à sévere (GUIDE). BMJ Open 2021 ; 11(9):e049822
- Hu P, et al : Le rôle des cellules T auxiliaires dans le psoriasis. Front Immunol 2021 Dec 15 ; 12 : 788940. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.788940/full,(dernière consultation 17.05.2023)
- Griffiths CE, et al : Groupe d’étude ACCEPT. N Engl J Med 2010 ; 362(2) : 118-128.
- Ghazawi FM, et al : Front Med (Lausanne) 2021 ; Aug 10 ; 8:702776. fmed.2021.702776.
DERMATOLOGIE PRAXIS 2023 ; 33(3) : 14-15 (publié le 8.6.23, ahead of print)