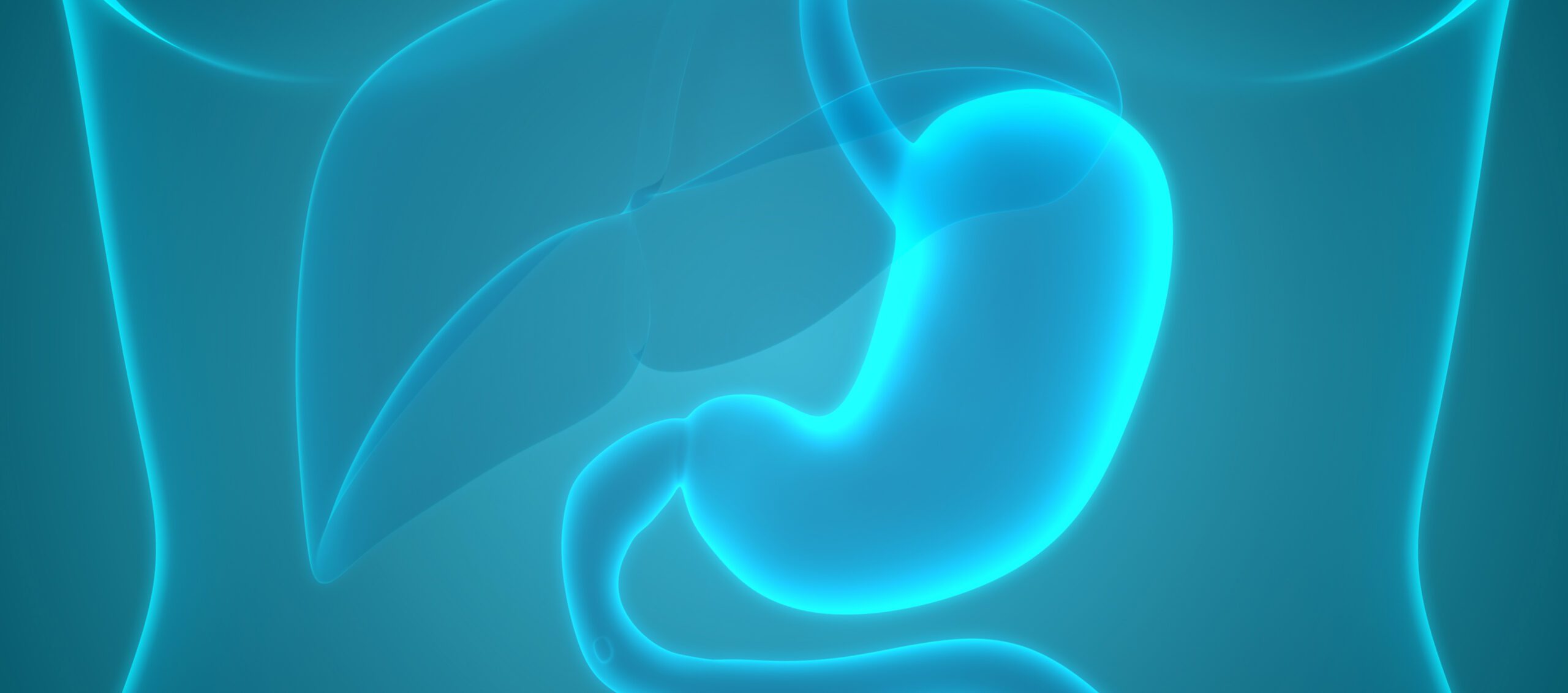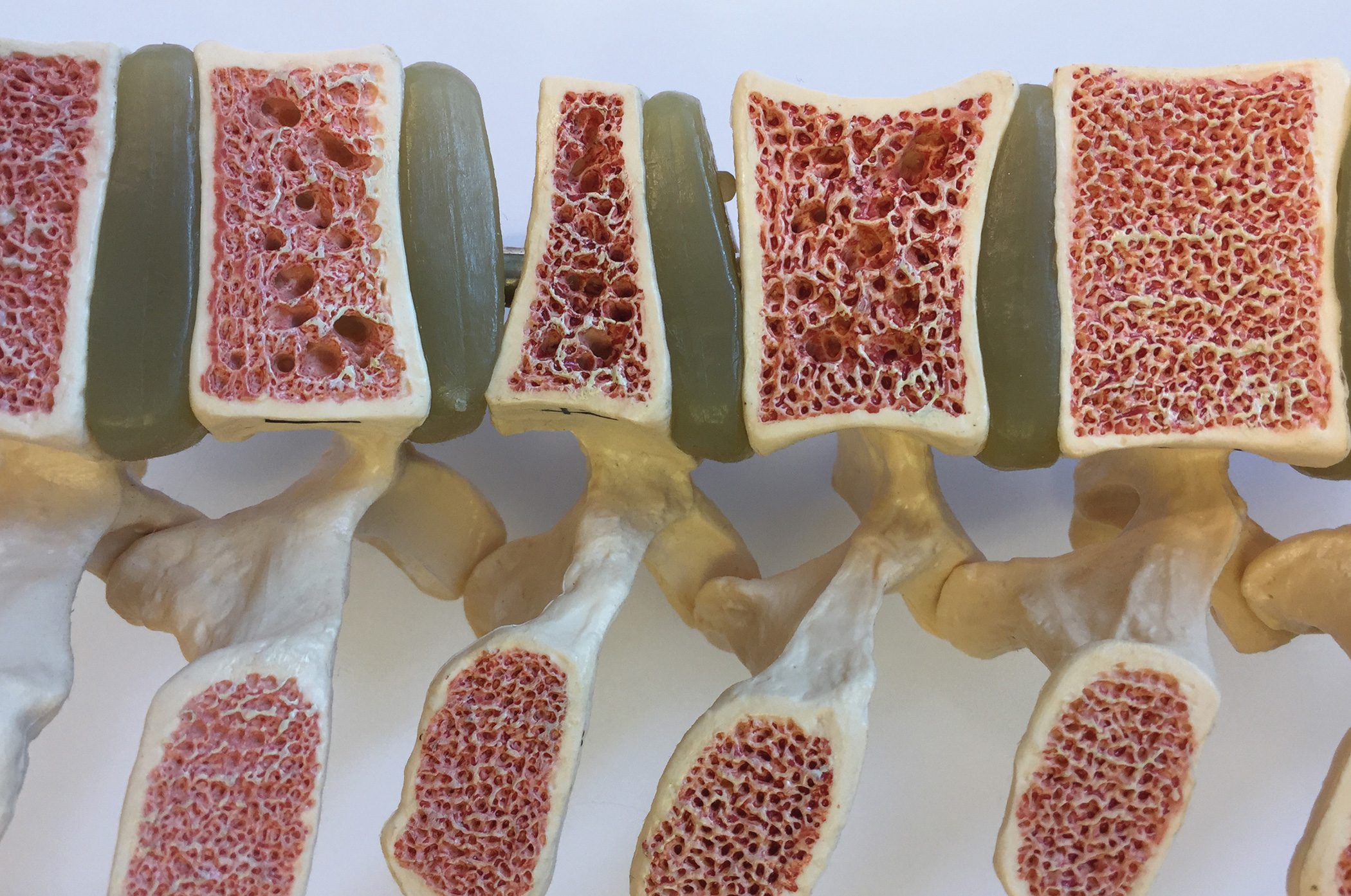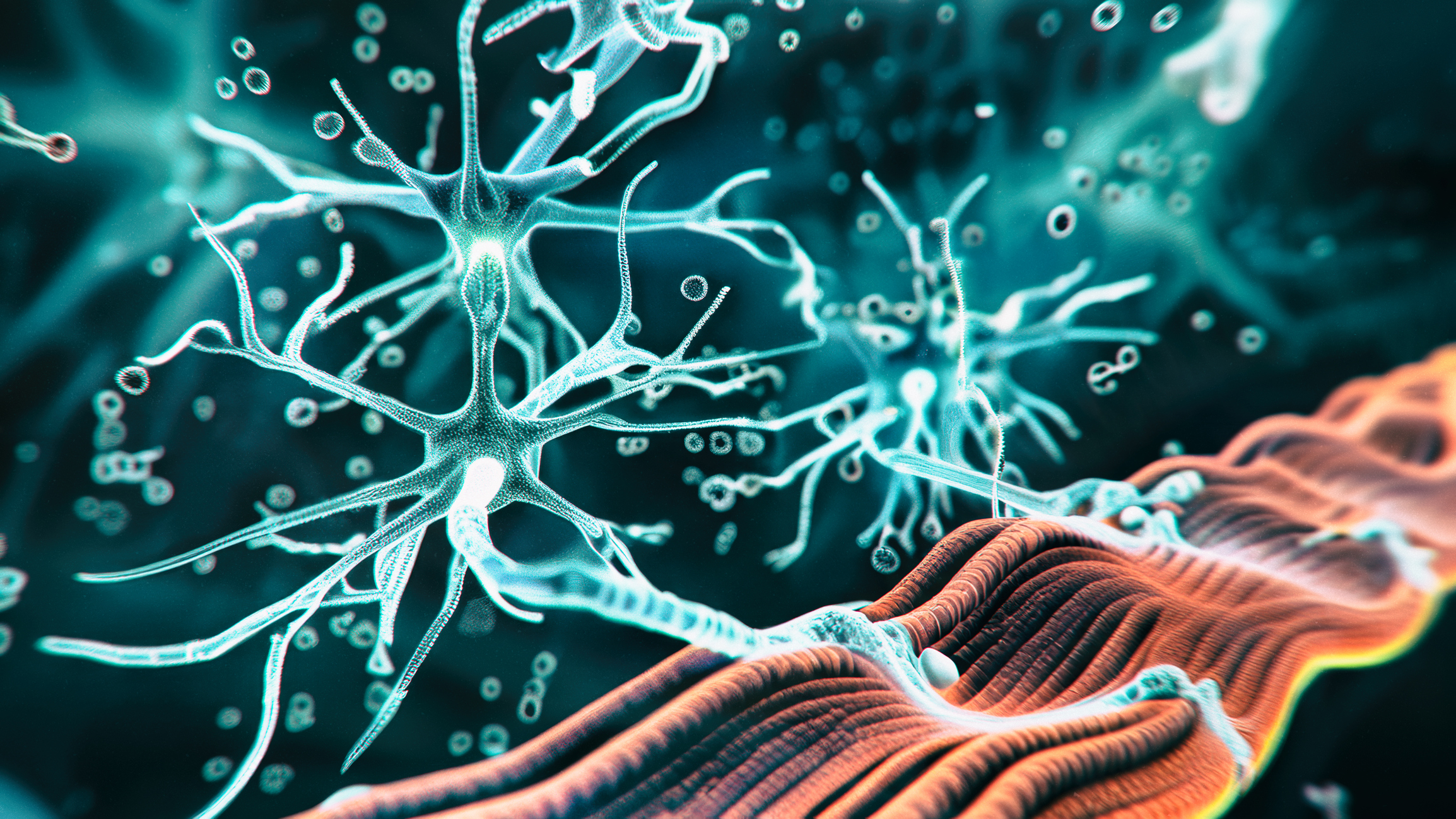Les données de l’étude EMPA-KIDNEY, lancée par le professeur Christoph Wanner de l’hôpital universitaire de Würzburg en collaboration avec l’université d’Oxford, élargissent le spectre de l’administration d’inhibiteurs de SGLT2 en cas de maladie rénale chronique, indépendamment du statut du diabète, de l’albuminurie ou de la fonction rénale.
La présentation des résultats n’a certes pas été un coup de tonnerre : en effet, l’utilité clinique des deux inhibiteurs du SGLT2, la dapagliflozine et la canagliflozine, dans le traitement des maladies rénales chroniques a déjà été prouvée dans des études antérieures. Les inhibiteurs de SGLT2 inhibent le transporteur rénal de glucose dépendant du sodium SGLT-2 (Sodium dependent glucose co-transporter 2) et entraînent une augmentation de l’excrétion de sucre dans l’urine. Cela fait baisser le taux de glycémie et peut entraîner une légère diminution du poids et de la pression artérielle. En même temps, les reins et la circulation sanguine sont soulagés. L’efficacité de la substance active empagliflozine a toutefois créé la surprise, même chez le professeur Dr Christoph Wanner. Le chef du service de néphrologie de l’hôpital universitaire de Würzburg a été l’un des premiers à publier le potentiel des inhibiteurs de SGLT2 dans le traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires et rénales dès 2015 dans l’étude EMPA-REG OUTCOME. Il a eu l’idée de l’étude EMPA-KIDNEY, dont les résultats ont été publiés dans le New England Journal of Medicine parallèlement à la Kidney Week de l’ASN.
Réduction du risque de 28% par rapport au placebo
L’équipe de l’étude, dirigée par l’Université d’Oxford en coopération avec la médecine universitaire de Würzburg, avait prévu au début des recherches une réduction du risque de 18 pour cent. Le risque comprenait une combinaison des critères d’évaluation primaires que sont le décès dû à une maladie cardiaque et l’insuffisance rénale, c’est-à-dire la nécessité d’une dialyse ou d’une transplantation rénale ou une baisse de la performance de la fonction rénale, appelée débit de filtration glomérulaire (DFG) de 40 pour cent ou plus. “Mais le fait que l’administration d’empagliflozine permette d’obtenir une réduction du risque de 28% par rapport à un placebo, et ce dans une large population de patients souffrant d’une maladie rénale chronique, est sensationnel”, commente Christoph Wanner. “Nous avons pu observer les effets positifs sur la protection cardiaque et rénale indépendamment du statut du diabète ou de la quantité d’albumine dans l’urine”. L’empagliflozine a également montré un résultat significatif en termes de taux d’hospitalisation. Le nombre d’hospitalisations a diminué de 14 %, quel que soit le motif d’hospitalisation. “J’ai également été positivement surpris de constater que l’empagliflozine continue d’agir même à un débit de filtration glomérulaire (DFG) de 20 millilitres par minute”.
L’empagliflozine adaptée à différents profils de maladie
Cela signifie que l’empagfliflozine peut être utilisée en cas de maladie rénale chronique sans diabète et sans albuminurie, ou en cas d’insuffisance cardiaque concomitante et même en cas de faible fonction rénale. Selon Wanner, cela facilitera considérablement la pratique de prescription des médecins libéraux. Selon Wanner, il est toutefois important de poser un diagnostic et donc d’évaluer le risque de maladies cardiaques et rénales, idéalement selon le schéma ABCDE : A signifie albuminurie, une excrétion élevée d’albumine dans les urines indique très tôt une atteinte rénale, bien avant que les effets de l’insuffisance rénale ne se fassent même sentir. Chez une personne en bonne santé, la concentration d’albumine dans l’urine est inférieure à 30 milligrammes. B correspond à la pression artérielle, C au cholestérol, D au diabète et E au statut eGFR. Le e signifie estimated, estimé en anglais. Le taux de filtration glomérulaire est estimé en fonction de la créatinine sérique, de l’âge, du sexe et de la couleur de peau. La valeur normale de l’urine primaire filtrée à partir du sang est de 90 à 130 millilitres par minute.
Une méta-analyse confirme les résultats de l’étude EMPA-KIDNEY
Les résultats de l’étude EMPA-KIDNEY ont également été intégrés et confirmés dans une méta-analyse de 13 études SGLT2 portant sur un total de 90.309 personnes diabétiques et 15.605 personnes non diabétiques. Dans l’analyse qui vient d’être publiée dans la prestigieuse revue The Lancet , plusieurs responsables d’essais cliniques, appelés investigateurs principaux, ont spécifiquement étudié l’influence du diabète en ce qui concerne l’effet des inhibiteurs de SGLT2 sur les valeurs rénales et les maladies cardiovasculaires. Christoph Wanner, qui a participé à la fois au comité d’écriture et au consortium dit SMART-c de la méta-analyse, résume : “Les données soutiennent l’utilisation des inhibiteurs de SGLT2 pour réduire le risque de progression des maladies rénales et des lésions rénales aiguës, indépendamment du risque de diabète”.
Publication originale :
Impact du diabète sur les effets des inhibiteurs du co-transporteur 2 du glucose sodique sur les résultats rénaux : méta-analyse collaborative de grands essais contrôlés par placebo. The Lancet, VOLUME 400, ISSUE 10365, P1788-1801, NOVEMBRE 19 ; DOI : https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02074-8