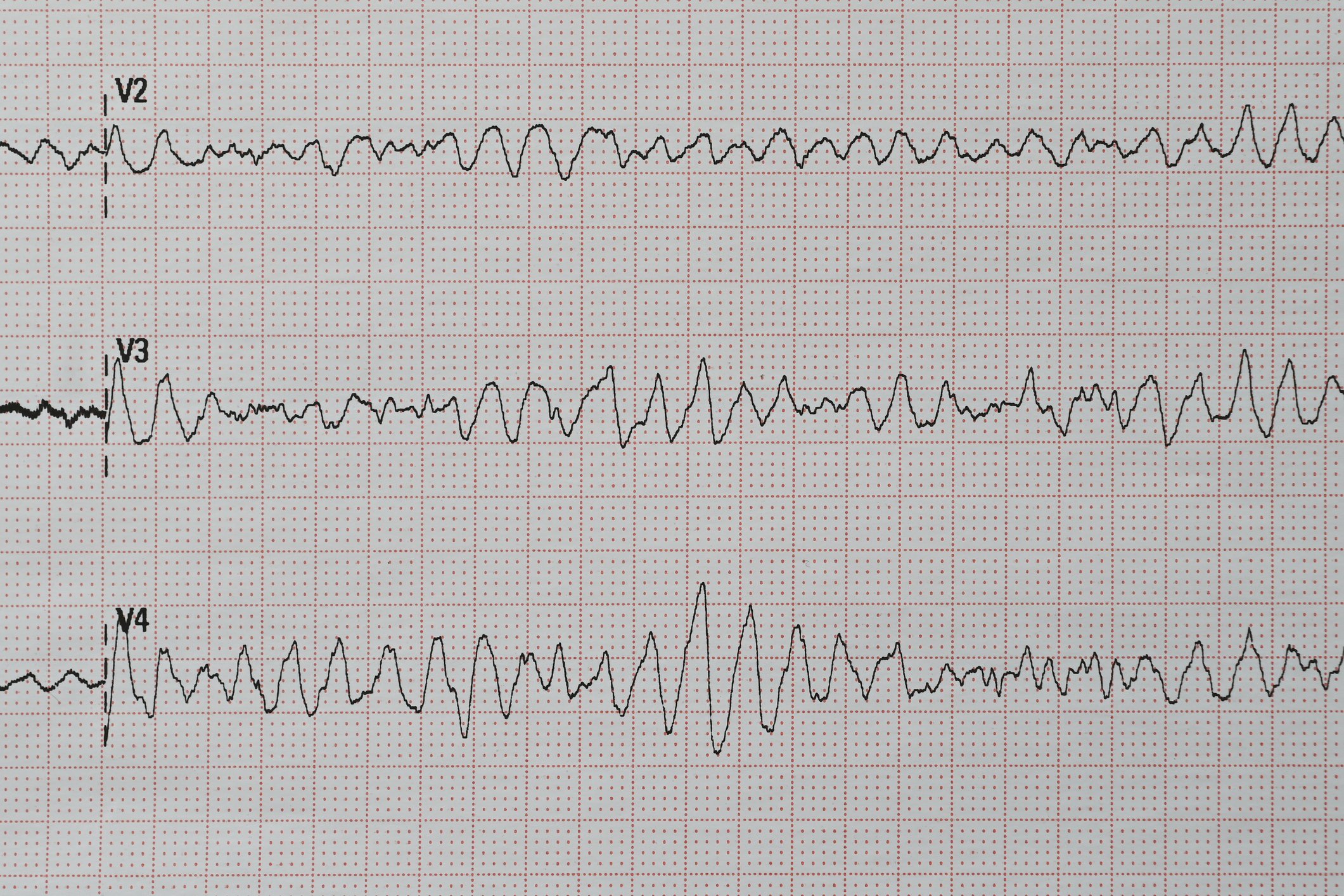Le dernier numéro de l’InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE vous offre un aperçu large et informatif sur le thème du “trouble bipolaire” : il traite de l’épidémiologie, de la mortalité et de l’incidence familiale, des défis du diagnostic et du traitement stratifié.
Le trouble bipolaire se caractérise par une fluctuation anormale de l’humeur et se manifeste par des épisodes maniaques, hypomaniaques et dépressifs. Les premières manifestations apparaissent généralement dès l’adolescence ou au début de l’âge adulte.
Prof. Dr méd. Martin Preisig, Dr méd. Dans leur article, Sylfa Fassassi et le Dr Caroline Vandeleur, Prilly, illustrent à l’aide d’études récentes que l’évolution d’un trouble bipolaire est malheureusement généralement défavorable : Le taux de mortalité augmente en particulier lorsque d’autres comorbidités somatiques et psychiatriques, comme les troubles anxieux ou de la personnalité, s’y ajoutent. Outre les suicides, le risque de rémission incomplète et de récidive est également très élevé – à chaque nouvel épisode, les chances de rémission complète sont de moins en moins probables. Un cercle vicieux donc, qu’il convient de briser. Les auteurs abordent également les aspects épidémiologiques et les cas familiaux : Le risque de trouble bipolaire I est trois fois plus élevé pour les membres d’une famille ayant déjà connu de tels cas que pour les membres de familles saines.
Les personnes bipolaires abordent principalement la symptomatologie dépressive lors de leur visite chez le médecin, non seulement parce qu’elles passent généralement plus de temps dans les états dépressifs, mais aussi parce qu’elles considèrent les périodes (hypo)maniaques comme plus positives et que leurs conséquences sociales sont moins importantes. Dans ce cas, le risque est de poser un faux diagnostic de dépression unipolaire et donc d’appliquer un traitement trop unilatéral. Dans son article, le Dr Philipp Eich, de Liestal, met logiquement en garde contre une anamnèse imprécise et revient sur les principales bases d’un diagnostic et d’un traitement complets et adaptés à chaque patient. Il aborde notamment le point de vue du médecin généraliste, qui a un rôle important à jouer dans l’anamnèse, le traitement et le suivi à long terme.
Afin de lutter contre les phases d’ajustement thérapeutique difficiles, non uniformément réglementées et souvent longues, selon le principe de l’essai et de l’erreur, il convient de stratifier les patients bipolaires et les phases de traitement, en s’aidant à l’avenir de biomarqueurs et aujourd’hui de l’anamnèse et de la clinique (ce n’est pas sans raison que l’anamnèse est considérée comme le plus puissant prédicteur actuellement disponible du succès thérapeutique). Dans mon article, je donne un aperçu de ce champ de recherche important et prometteur.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous salue cordialement.
Prof. Dr. med. Gregor Hasler
InFo Neurologie & Psychiatrie 2014 ; 12(5) : 1