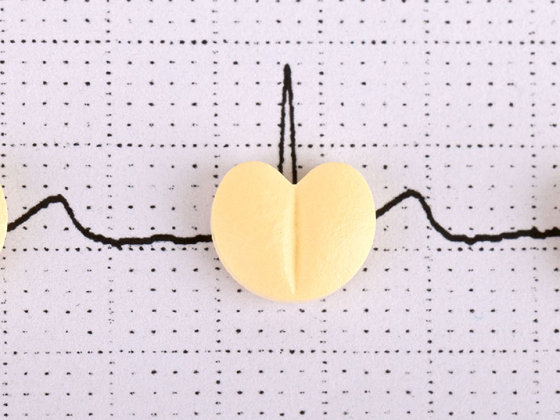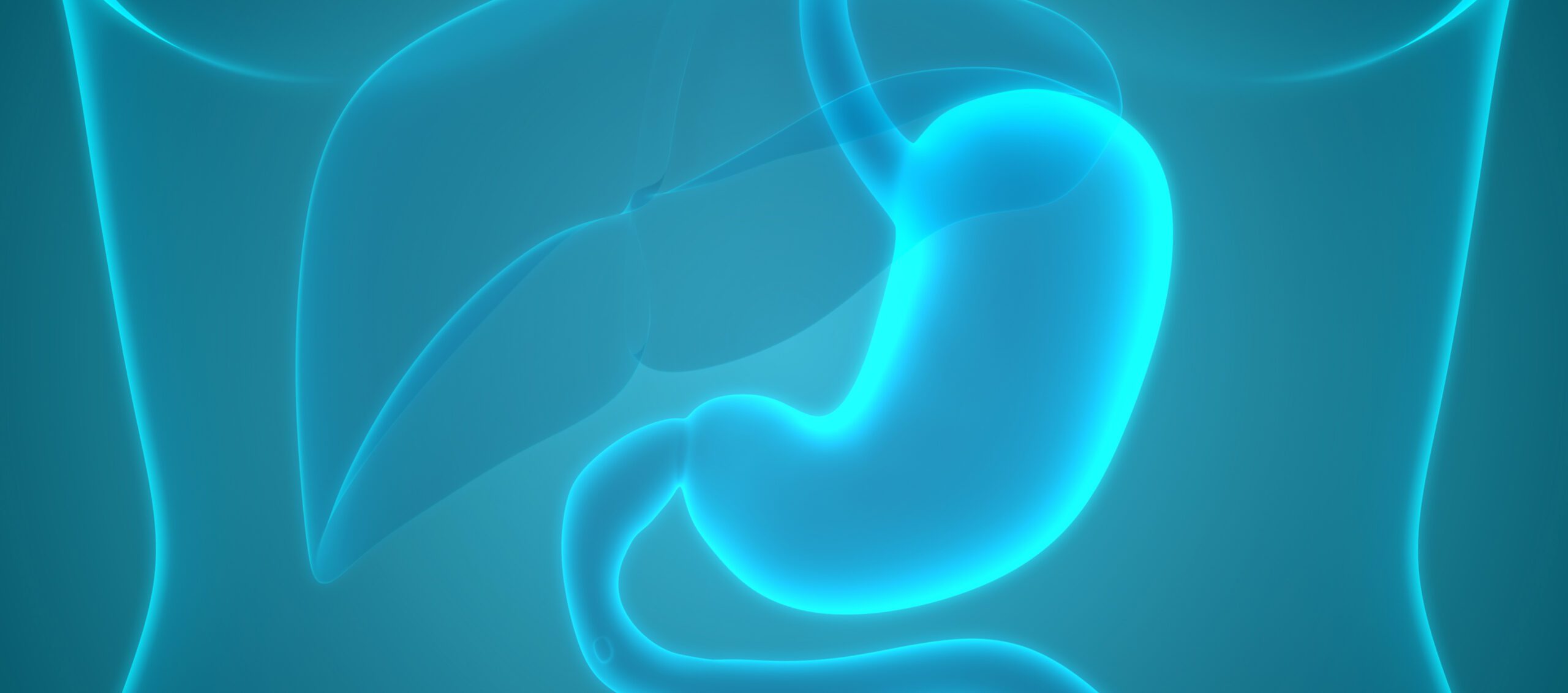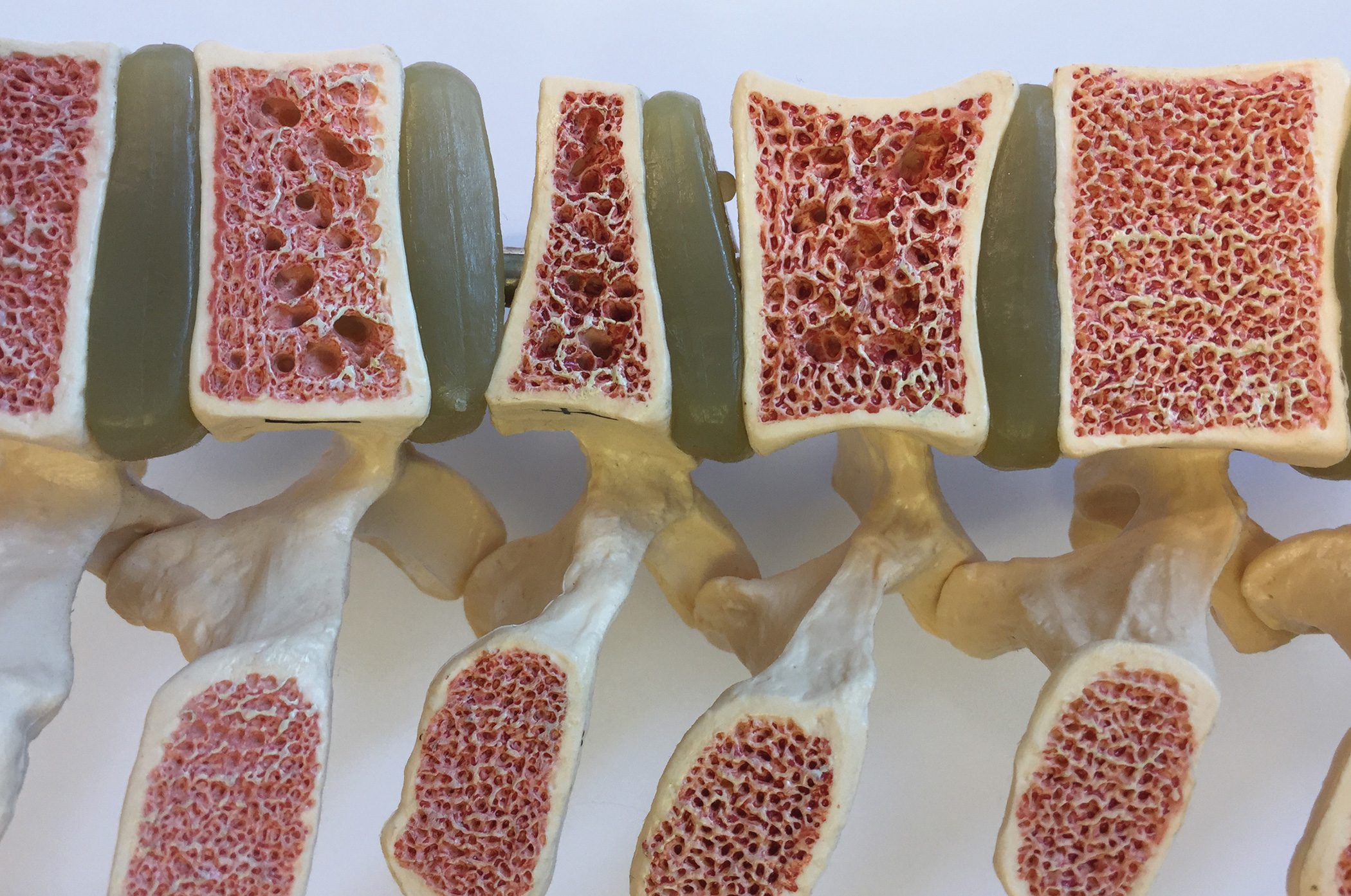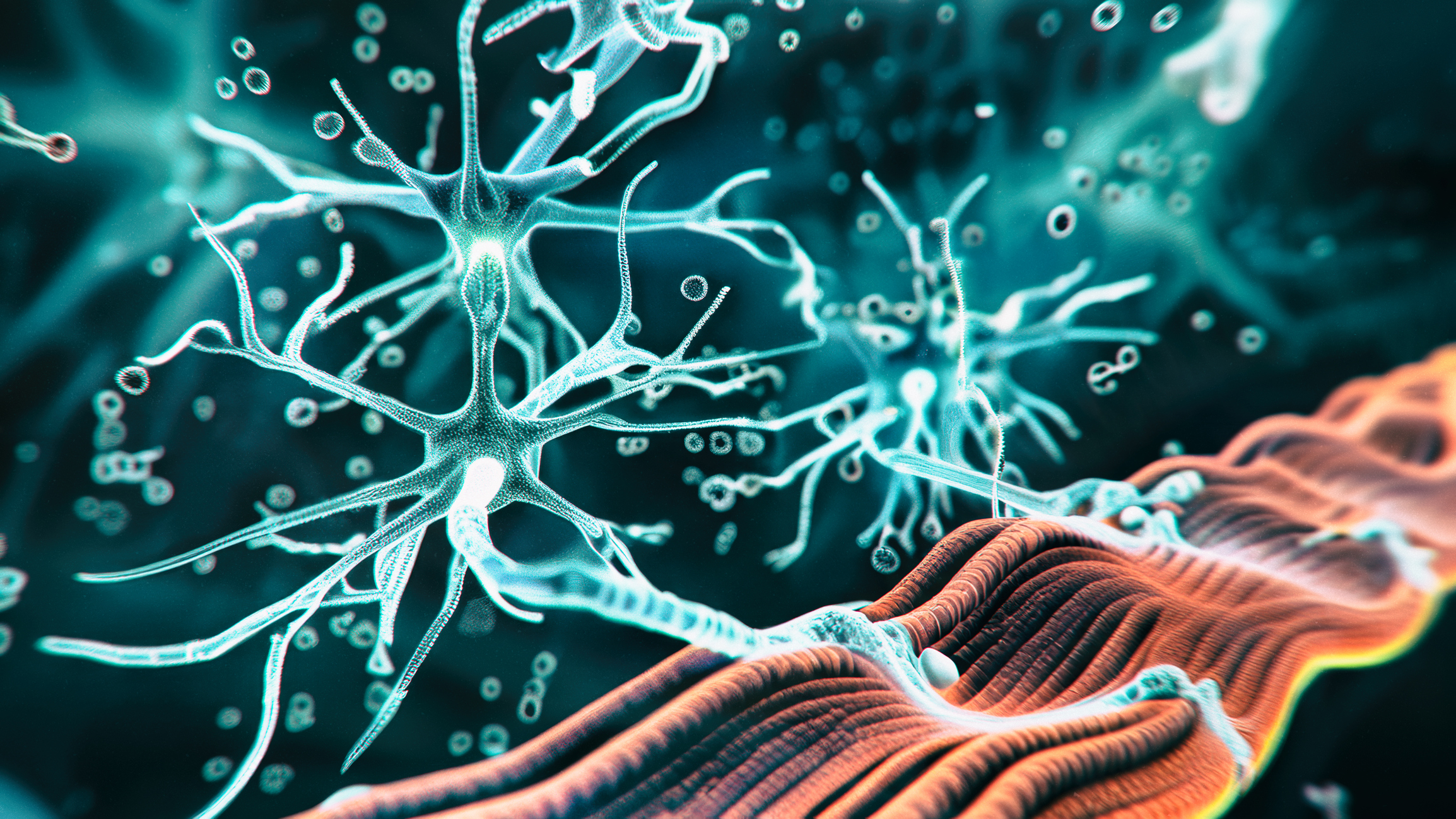Une médecine centrée sur le patient, qui respecte et intègre les préférences, les valeurs ou les besoins individuels, a pris de l’importance dans les soins aux patients ces dernières années. Dans le cadre des soins cliniques, il est donc important de permettre à nos patients de participer aux décisions concernant leurs traitements, ou du moins de les impliquer dans le processus décisionnel.
Une médecine centrée sur le patient*, qui respecte et intègre les préférences, les valeurs ou les besoins individuels [1–3], a pris de l’importance dans les soins aux patients ces dernières années. Dans le cadre des soins cliniques, il est donc important de permettre à nos patients* de participer aux décisions concernant leurs traitements, ou du moins de les impliquer dans la prise de décision [3].
Au cours d’une hospitalisation, les visites quotidiennes des unités de soins constituent le fondement d’une médecine centrée sur le patient. De nombreuses études soulignent l’importance des visites et montrent qu’elles peuvent contribuer à une meilleure qualité des soins, à la sécurité des patients et à l’amélioration des résultats des patients [4–6]. En tant que réunion entre les patients*, les médecins et les infirmières, ils offrent à l’équipe soignante l’occasion d’établir une relation avec le patient*, de l’informer sur sa maladie, de discuter d’un traitement en cours ou d’évaluer ensemble les étapes diagnostiques ultérieures [5,7].
Les décisions importantes concernant le traitement d’un patient sont souvent prises dans le cadre des visites du médecin-chef. Lors d’une visite du médecin-chef, les médecins assistants présentent généralement le dossier médical de leurs patients à l’équipe soignante présente. La présentation peut se faire soit directement au lit du patient, soit à l’avance devant la porte. Les deux modes sont des pratiques courantes dans les soins cliniques.
La discussion interdisciplinaire des antécédents médicaux directement au chevet du patient permet à ce dernier* de participer activement à son traitement. En outre, la discussion de cas permet au patient d’avoir un aperçu de son dossier médical. Cependant, ces discussions, du moins du côté des médecins, sont généralement de nature académique et contiennent des termes médicaux qui ne sont généralement pas familiers aux patients. Cela peut conduire les patients à ne pas comprendre correctement les choses, voire à les mal interpréter. La complexité et le volume des informations médicales, ainsi que l’échange d’informations sensibles au chevet du patient, peuvent également être source de confusion, d’inconfort et de malentendus, et potentiellement nuire aux connaissances des patients [8–10]. Les connaissances et la compréhension des patients sont à leur tour considérées comme des prédicteurs importants de la réussite de l’adhésion au traitement [11–13].
Si la présentation du cas et les discussions académiques n’ont pas lieu directement au chevet du patient, un résumé “convivial” peut être expliqué ensuite au patient pour l’informer de ce qui a été discuté. Cependant, les inconvénients potentiels de ce type de visites sont que les patients peuvent être moins impliqués, que les prises de décision sont moins transparentes et que l’équipe soignante passe moins de temps avec le patient.
Jusqu’à présent, peu d’études ont examiné si, pendant la visite, la présentation du patient directement au chevet du patient avait un effet positif ou négatif sur les critères d’évaluation centrés sur le patient, tels que la compréhension, la satisfaction ou la qualité perçue des soins.
Une méta-analyse de 2019, incluant cinq études randomisées, n’a pas montré de différence en termes de satisfaction ou de connaissance des patients [14]. Une revue systématique américaine est parvenue à une conclusion similaire en comparant les présentations au lit avec d’autres types de présentations de patients dans les services de médecine interne, de chirurgie et de soins intensifs, et n’a pu démontrer aucun effet sur les critères d’évaluation centrés sur le patient [15].
Cependant, les études incluses dans les deux travaux étaient de qualité faible à modérée, présentaient une hétérogénéité marquée en termes de critères d’évaluation rapportés et ne recrutaient que de petites populations de patients. Comme les preuves actuelles ne permettent pas de faire des recommandations, la question s’est posée dans la pratique clinique de savoir s’il est utile de discuter de toutes les considérations diagnostiques ou des aspects thérapeutiques directement au chevet du patient pendant les visites ou si cette approche risque de semer la confusion, voire la méfiance chez nos patients.
L’absence de données probantes a conduit les hôpitaux à varier le lieu de présentation des patients pendant la visite en fonction des préférences des personnes impliquées [16–18].
Présentation de cas au lit du patient versus à la porte – une étude multicentrique randomisée et sa pertinence clinique
L’étude BEDSIDE-OUTSIDE, une étude multicentrique randomisée menée en Suisse, s’est penchée sur l’influence de la manière dont les patients sont présentés (au lit du patient ou devant la chambre du patient) sur la compréhension des patients et sur la qualité perçue des soins [19].
L’étude BEDSIDE-OUTSIDE a été menée dans trois hôpitaux universitaires suisses et ses résultats ont été publiés dans la revue Annals of Internal Medicine [19]. Pour cette étude, les patients consécutifs ont été inclus à leur entrée à l’hôpital et ont eu leur première visite de chef de service. Les patients présentant des troubles cognitifs, une surdité, des difficultés à comprendre la ou les langues locales et les patients précédemment inclus dans l’étude ou n’ayant pas donné leur consentement ont été exclus. Les patients* ont ensuite été randomisés de manière aléatoire dans le groupe “bedside” (présentation du patient au lit) ou dans le groupe “outside” (présentation du patient en dehors de la chambre du patient).
Dans le groupe de chevet, les présentations de cas et ou les discussions académiques se déroulaient devant la porte, directement au chevet du patient, sans discussion préalable. Dans le groupe Outside, les présentations de cas de patients et les réunions se déroulaient principalement dans le couloir, sans la présence du patient*. Ensuite, l’équipe soignante entrait dans la pièce et donnait aux patients* un bref résumé de la situation médicale, puis effectuait le reste de la visite au lit du patient.
L’étude BEDSIDE-OUTSIDE est la première grande étude multicentrique randomisée à démontrer que les visites au chevet du patient n’ont pas d’impact négatif sur les connaissances de nos patients. Les patients du groupe au chevet avaient des connaissances subjectives similaires à celles des patients randomisés dans le groupe à l’extérieur (moyenne, ± SD) (79,5 ± 21,6 vs 79,4 ± 19,8, différence ajustée 0,09 (IC 95% -2,58 à 2,76 ; p=0,95) (tableau 1). Les connaissances objectives évaluées par l’équipe d’étude n’étaient pas non plus différentes.
En ce qui concerne l’efficacité en termes de temps, les présentations de patients au lit se sont avérées plus efficaces en termes de temps que les présentations de patients hors de la chambre (moyenne, ± ET) (11,9 ± 4,9 vs 14,1 ± 5,7 minutes, différence ajustée -2,3 minutes (IC à 95% -3,0 à -1,6 ; p<0,001). Les visites au lit étaient donc en moyenne 2,3 minutes plus courtes, ce qui peut être tout à fait pertinent pour la durée totale de la visite.
Néanmoins, le contact direct médecin-patient était plus long dans le groupe Bedside. De plus, les patients du groupe bedside ont estimé que leur médecin traitant consacrait environ 15 minutes de plus par jour à leur traitement. Même si la différence semble minime à première vue, ce résultat peut avoir des effets socio-économiques importants. Si l’on considère qu’une équipe de soins visite 20 patients*, la différence de temps entre les visites au chevet du patient et les visites à l’extérieur peut s’élever à environ 45 minutes. La mission principale d’un traitement hospitalier est d’apporter les meilleurs soins possibles aux patients. Mais en période de DRG et de pandémie, les ressources sont souvent limitées et la charge de travail élevée. Les visites au chevet du patient semblent ici représenter une possibilité de gagner du temps sans que cela ait un impact négatif sur les connaissances de nos patients*.
En contrepartie, les patients randomisés dans le groupe de chevet étaient significativement plus nombreux à déclarer être confus par les termes médicaux (ratio de risque ajusté 7,58 (3,67-11,49) ; p<0,001) ou même à être déstabilisés par la discussion académique (ratio de risque ajusté 2,89 (0,30-5,49) ; p=0,029). Ces résultats sont cohérents avec ceux d’une étude américaine de 1997 publiée dans le New England Journal of Medicine [20]. Lehmann et al. ont découvert qu’il semble y avoir une association entre le niveau d’éducation des patients et leur confusion ou leur incertitude. Les patients ayant un faible niveau de littératie en santé ont notamment du mal à comprendre les termes médicaux ou les contextes. Une enquête suisse menée en 2019-2021 a montré qu’environ la moitié de la population avait un faible niveau de compétences en matière de santé. Les discussions académiques sur l’utilisation de la terminologie médicale lors des visites au chevet des patients pourraient justement créer de la confusion et de l’incertitude chez ces patients. Par exemple, le Royal College of General Practitioners britannique a demandé il y a quelques années que les médecins* veillent à parler lentement et à éviter les termes médicaux [21]. Des termes tels que “chronique” ou “résultats positifs” ne sont pas familiers pour de nombreux patients et leur signification n’est donc pas claire. Le manque de compréhension de sa propre maladie et de son traitement peut à son tour conduire les patients* à se rendre plus souvent à l’hôpital en urgence ou à souffrir de graves problèmes de santé [22]. Il est donc élémentaire que nous veillions à nous exprimer de manière conviviale pour le patient et à éviter les termes techniques, en particulier lors des visites au chevet du patient.
Une communication centrée sur le patient peut permettre une meilleure compréhension de l’état de santé du patient et faciliter ainsi son implication dans la prise de décision lors des visites.
Une analyse secondaire de l’essai BEDSIDE-OUTSIDE a montré qu’environ 80% des patients* souhaitent être impliqués dans les décisions médicales ou même décider eux-mêmes [23]. La préférence des patients à être impliqués ou non dans les décisions était un prédicteur important de la qualité perçue du traitement dans l’étude. Ainsi, les patients qui souhaitent prendre des décisions de manière autonome étaient significativement plus insatisfaits de leur séjour à l’hôpital et avaient moins confiance dans les médecins et le personnel soignant qui les soignaient. Il est donc préférable, surtout pour les décisions importantes, d’élaborer et de prendre en compte la préférence des patients.
En outre, l’étude BEDSIDE-OUTSIDE a révélé que les sujets sensibles tels que les comorbidités psychiatriques, le manque d’adhésion au traitement ou les incertitudes médicales étaient significativement moins abordés lors des visites au chevet du patient (odds ratio ajusté 0,72 (0,54-0,97) ; p=0,033). On pourrait supposer que lors des visites au chevet du patient, les sujets délicats n’étaient pas abordés devant les autres patients* pour des raisons de confidentialité. Toutefois, l’étude a révélé que l’équipe soignante n’abordait pas non plus les aspects délicats lors des débriefings qui suivaient la visite et les occultait donc complètement. Des études plus anciennes montrent cependant que des sujets délicats comme l’état psychique ou le vécu subjectif de la maladie sont tout à fait considérés par les patients* comme des thèmes prioritaires d’une visite et devraient donc être abordés [24].
Dans une autre analyse secondaire de l’essai BEDSIDE-OUTSIDE, les auteurs* ont examiné la communication interprofessionnelle pendant les entretiens de visite ainsi que la préférence des médecins et des infirmières en ce qui concerne le type de présentations faites aux patients [25]. Il est apparu que les infirmières préféraient les visites au chevet, car elles se sentaient plus intégrées et valorisées et avaient l’impression de pouvoir mieux faire part de leurs propres préoccupations. L’une des raisons pourrait être que les visites hors site sont plus académiques et mettent davantage l’accent sur l’enseignement aux internes que sur les aspects pratiques des soins aux patients. Cela peut conduire à ce que les infirmières soient moins impliquées ici, alors qu’au chevet du patient, elles sont plus impliquées dans les discussions centrées sur le patient.
Les médecins, quant à eux, préféraient les visites à l’extérieur, car ils se sentaient moins mal à l’aise pour discuter de sujets délicats. Les techniques de communication qui facilitent l’évocation de sujets délicats pourraient donc augmenter l’assurance dans la gestion de ces sujets et donc la satisfaction des médecins lors des visites de Bedside.
Comment optimiser la communication ?
Au préalable, il a également été discuté au niveau médico-politique que les lacunes en matière de compétences de communication du côté des médecins* étaient principalement dues à un “déficit d’études, trop somatiques, orientées vers les faits et les performances” [26].
Dans de nombreux pays européens, le cursus de “médecine humaine” a été réformé ces dernières années dans le cadre du processus de Bologne. La faculté de médecine de l’université de Bâle a profité du passage à une structure bachelor/master pour mettre en place un curriculum longitudinal “compétences sociales et communicatives” [27]. De la première année de licence à la première année de master, les compétences en communication sont enseignées longitudinalement en lien avec le contenu clinique. Il s’agit notamment de techniques centrées sur le patient (ouvrant l’espace) telles que le WWSZ (attendre, répéter, refléter, résumer) ou la prise en compte des émotions à l’aide du modèle NURSE (Naming emotion, Understanding, Respecting, Supporting, Exploring), ainsi que de techniques centrées sur le médecin telles que la structuration explicite de l’entretien. En outre, les techniques de communication “Prise de décision partagée”, “Entretien motivationnel” et “Annoncer une mauvaise nouvelle” sont enseignées dans des cours magistraux et mises en pratique dans des ateliers. L’objectif du programme est de faire en sorte que les patients ne soient pas seulement considérés comme des “cas de maladie” somatiques, mais que les étudiants comprennent également la signification de la maladie pour l’individu et apprennent à aborder les questions et les aspects émotionnels. De nombreuses études dans le domaine de la formation des étudiants montrent qu’il est possible d’enseigner des compétences de communication et d’améliorer les aptitudes des futurs médecins [28].
L’importance de la communication dans le domaine médical a été soulignée dans un rapport de référence sur la communication dans le système de santé britannique, soutenu par la Fondation Marie Curie [29]. Le rapport indique qu’un déficit de communication dans le secteur de la santé a un impact négatif sur la qualité des soins médicaux et les résultats des patients. En outre, les auteurs ont constaté que le manque de compétences en communication entraîne un gaspillage de ressources, dont les auteurs estiment le préjudice à 1 milliard de livres par an au Royaume-Uni. De plus, les compétences en communication sont capables non seulement d’augmenter la satisfaction de nos patients, mais aussi de réduire le taux d’épuisement professionnel du personnel médical.
Les compétences en communication sont considérées par de nombreuses sociétés de discipline médicale comme une compétence clé du médecin, ce qui a conduit à ce que les universités médicales suisses incluent désormais des cours sur les compétences en communication dans leur catalogue de matières obligatoires. Les médecins en formation postgraduée en hématologie/oncologie doivent suivre une formation en communication de plusieurs jours pour obtenir leur titre de spécialiste, car la communication et la prise en compte des besoins psychosociaux des patients sont considérées comme des éléments fondamentaux d’une prise en charge de haute qualité des patients atteints de cancer [30]. En revanche, la formation continue des autres employés du secteur de la santé est souvent moins clairement décrite.
Des formations régulières en communication pour l’ensemble du personnel médical, reprenant des exemples typiques de la vie clinique quotidienne (comme par exemple les discussions pendant une visite), pourraient contribuer de manière importante à réduire les malentendus et à augmenter la satisfaction des patients. Il est nécessaire de disposer de plus de preuves dans les domaines cliniquement importants et exigeants en termes de communication, afin de pouvoir les intégrer dans l’enseignement et la formation continue. En ce qui concerne la communication des visites, l’accent devrait être mis sur une communication plus centrée sur le patient pendant les visites, afin d’éviter la confusion et l’incertitude et de permettre aux patients de parler de sujets et de questions qui les concernent. Du côté de l’équipe soignante, il s’agit également d’élaborer des techniques qui facilitent, en particulier pendant les visites au chevet du patient, l’approche professionnelle de sujets délicats sans déstabiliser ou brusquer les patients.
Messages Take-Home
- Les visites sont un fondement élémentaire des soins centrés sur le patient.
- Les présentations de patients au chevet du patient sont plus efficaces en termes de temps, mais peuvent provoquer davantage de confusion et d’incertitude.
- La formation aux compétences de communication peut contribuer à améliorer les soins aux patients et constitue donc une compétence médicale de base qui peut être apprise.
Littérature :
- Daschle T, Domenici P, Frist W, et al.: Prescription for patient-centered care and cost containment. N Engl J Med 2013; 369(5): 471–474; doi: 10.1056/NEJMsb1306639.
- Stewart M: Towards a global definition of patient centred care. BMJ 2001; 322(7284): 444–445; doi: 10.1136/bmj.322.7284.444.
- Bardes CL: Defining «patient-centered medicine». N Engl J Med 2012; 366(9): 782–783; doi: 10.1056/NEJMp1200070.
- Zwarenstein M, Goldman J, Reeves S: Interprofessional collaboration: effects of practice-based interventions on professional practice and healthcare outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2009; 3: CD000072; doi: 10.1002/14651858.CD000072.pub2.
- O’Mahony S, Mazur E, Charney P, et al.: Use of multidisciplinary rounds to simultaneously improve quality outcomes, enhance resident education, and shorten length of stay. J Gen Intern Med 2007; 22(8): 1073–1079M; doi: 10.1007/s11606-007-0225-1.
- Pucher PH, Aggarwal R, Darzi A: Surgical ward round quality and impact on variable patient outcomes. Ann Surg 2014; 259(2): 222-226; doi: 10.1097/SLA.0000000000000376.
- Royal College of Physicians RCoN. Ward rounds in medicine: principles for best practice. 2015 (London: RCP, 2012.).
- Chapple A, Campion P, May C: Clinical terminology: anxiety and confusion amongst families undergoing genetic counseling. Patient education and counseling 1997; 32(1–2): 81–91.
- Hadlow J, Pitts M: The understanding of common health terms by doctors, nurses and patients. Soc Sci Med 1991; 32(2): 193–196.
- Chapman K, Abraham C, Jenkins V, et al.: Lay understanding of terms used in cancer consultations. Psycho-oncology 2003; 12(6): 557–566; doi: 10.1002/pon.673.
- DiMatteo MR, Giordani PJ, Lepper HS, et al.: Patient adherence and medical treatment outcomes: a meta-analysis. Med Care 2002; 40(9): 794–811; doi: 10.1097/00005650-200209000-00009.
- Conn VS, Ruppar TM, Enriquez M, et al.: Patient-Centered Outcomes of Medication Adherence Interventions: Systematic Review and Meta-Analysis. Value Health 2016; 19(2): 277–285; doi: 10.1016/j.jval.2015.12.001.
- Clarke C, Friedman SM, Shi K, et al.: Emergency department discharge instructions comprehension and compliance study. CJEM 2005; 7(1): 5–11; doi: 10.1017/s1481803500012860.
- Gamp M, Becker C, Tondorf T, et al.: Effect of Bedside vs. Non-bedside Patient Case Presentation During Ward Rounds: a Systematic Review and Meta-analysis. J Gen Intern Med 2019; 34(3): 447–457; doi: 10.1007/s11606-018-4714-1.
- Ratelle JT, Sawatsky AP, Kashiwagi DT, et al.: Implementing bedside rounds to improve patient-centred outcomes: a systematic review. BMJ Qual Saf 2019; 28(4): 317–326; doi: 10.1136/bmjqs-2017-007778.
- Gonzalo JD, Chuang CH, Huang G, et al.: The return of bedside rounds: an educational intervention. J Gen Intern Med 2010; 25(8): 792-798; doi: 10.1007/s11606-010-1344-7.
- Stickrath C, Noble M, Prochazka A, et al.: Attending rounds in the current era: what is and is not happening. JAMA Intern Med 2013; 173(12): 1084–1089; doi: 10.1001/jamainternmed.2013.6041.
- Peters M, Ten Cate O: Bedside teaching in medical education: a literature review. Perspect Med Educ 2014; 3(2): 76–88; doi: 10.1007/s40037-013-0083-y.
- Becker C, Gamp M, Schuetz P, et al.: Effect of Bedside Compared With Outside the Room Patient Case Presentation on Patients’ Knowledge About Their Medical Care: A Randomized, Controlled, Multicenter Trial. Ann Intern Med 2021; 174(9): 1282–1292; doi: 10.7326/M21-0909.
- Lehmann LS, Brancati FL, Chen MC, et al.: The effect of bedside case presentations on patients’ perceptions of their medical care. N Engl J Med 1997; 336(16): 1150–1155; doi: 10.1056/NEJM199704173361606.
- Rimmer A: Doctors must avoid jargon when talking to patients, royal college says. BMJ 2014; 348: g4131.
- Berkman ND, Sheridan SL, Donahue KE, et al.: Low health literacy and health outcomes: an updated systematic review. Ann Intern Med 2011; 155(2): 97-107; doi: 10.7326/0003-4819-155-2-201107190-00005.
- Becker C, Gross S, Gamp M, et al.: Patients’ Preference for Participation in Medical Decision-Making: Secondary Analysis of the BEDSIDE-OUTSIDE Trial. J Gen Intern Med 2022; doi: 10.1007/s11606-022-07775-z.
- Köhle K, Raspe H: Das Gespräch während der ärztlichen Visite. München-Wien-Baltimore: Urban & Schwarzenberg 1982.
- Gross S, Beck K, Becker C, et al.: Perception of physicians and nursing staff members regarding outside versus bedside ward rounds: ancillary analysis of the randomised BEDSIDE-OUTSIDE trial. Swiss Med Wkly 2022; 152: w30112; doi: 10.4414/smw.2022.w30112.
- Geisler L: Kommunikation bei der Patientenvisite – Ausdruck unserer ethischen Werthaltung 2003 [Available from: www.linus-geisler.de/vortraege/0314patientenvisite.html, accessed October 5, 2022].
- Kiessling C, Langewitz W: The longitudinal curriculum «social and communicative competencies» within Bologna-reformed undergraduate medical education in Basel. GMS Z Med Ausbild 2013; 30(3): Doc31; doi: 10.3205/zma000874.
- Smith S, Hanson JL, Tewksbury LR, et al.: Teaching patient communication skills to medical students: a review of randomized controlled trials. Eval Health Prof 2007; 30(1): 3–21; doi: 10.1177/0163278706297333.
- McDonald A: A long and winding road: improving communication with patients in the NHS. London, 2016.
- Adler NE, Page AEK, eds. Cancer Care for the Whole Patient: Meeting Psychosocial Health Needs. Washington (DC) 2008.
DERMATOLOGIE PRAXIS 2023; 33(5): 14–18