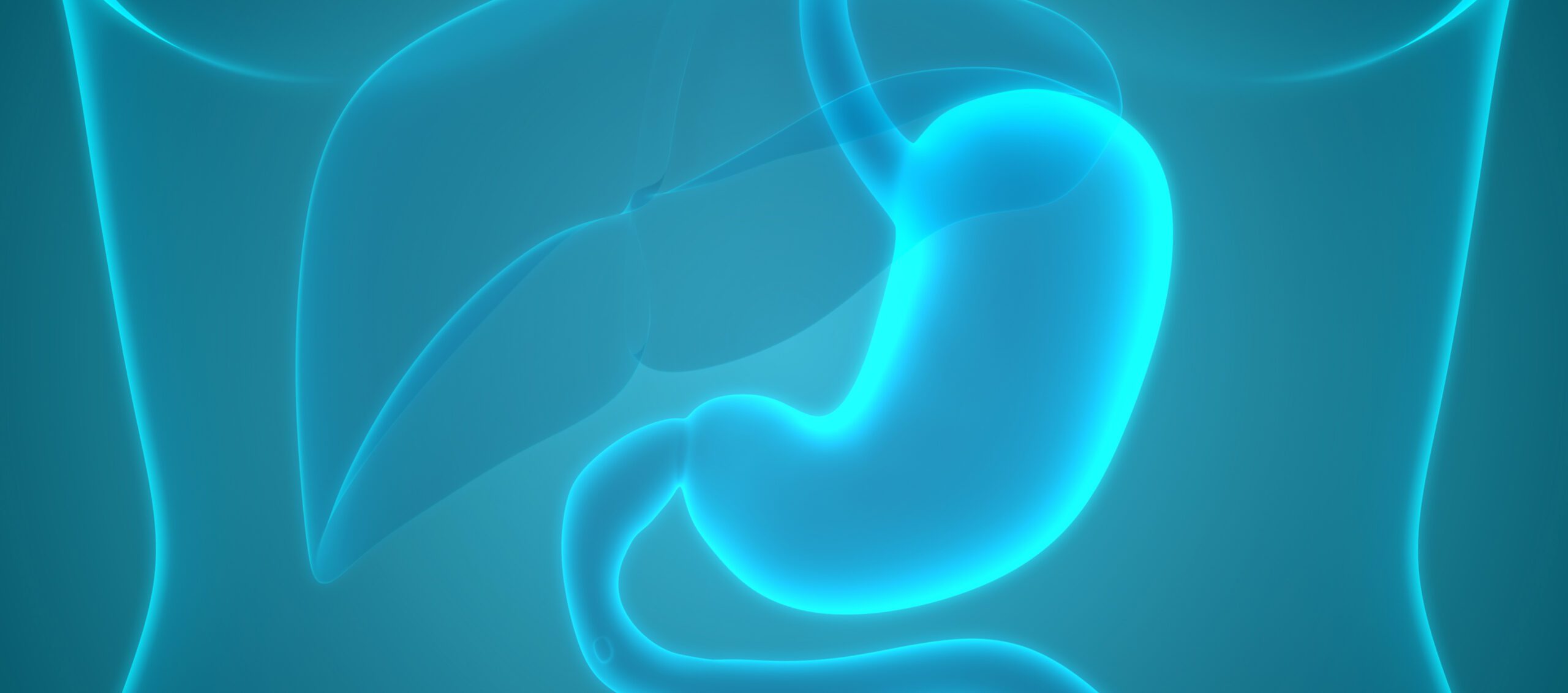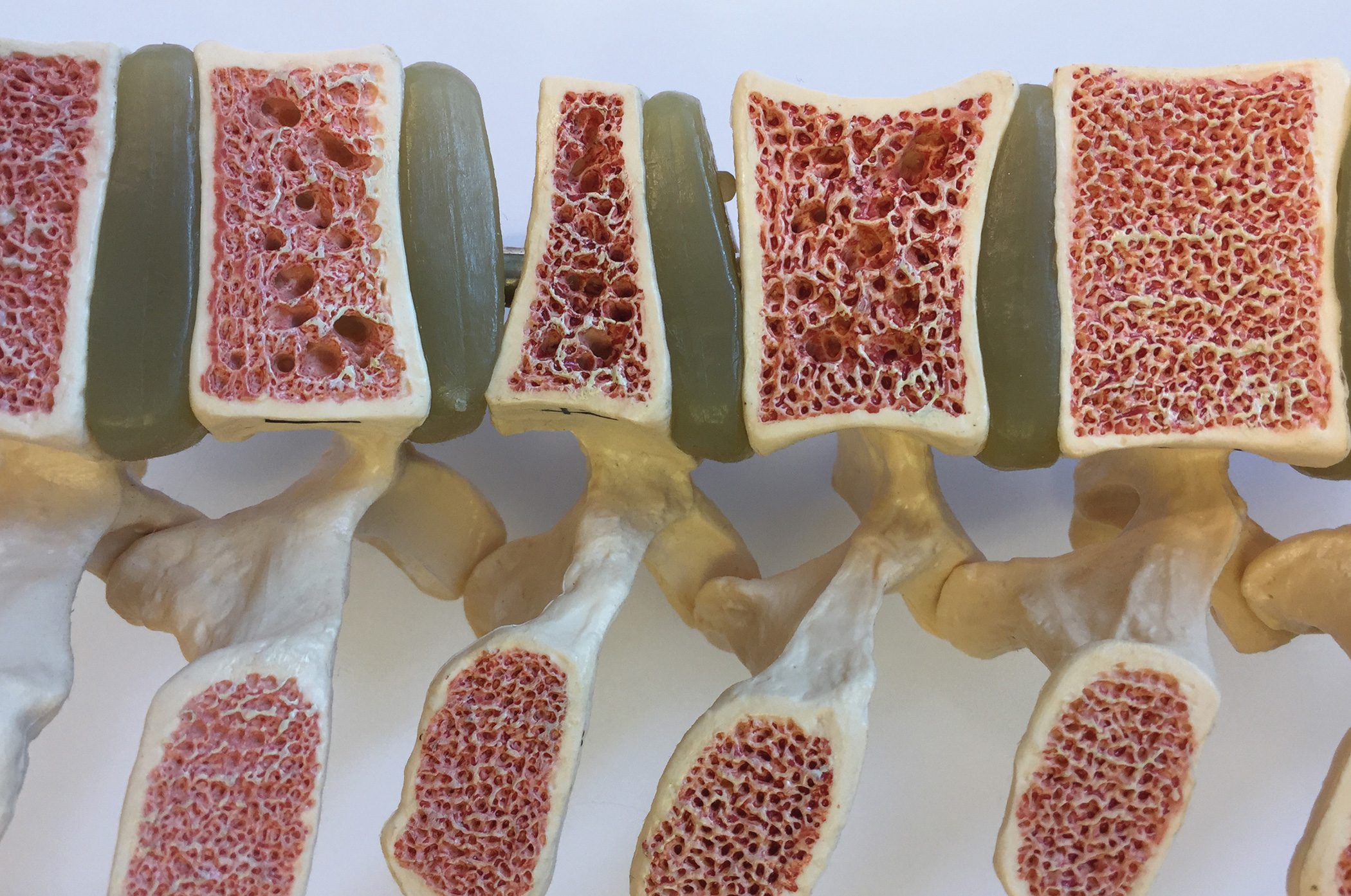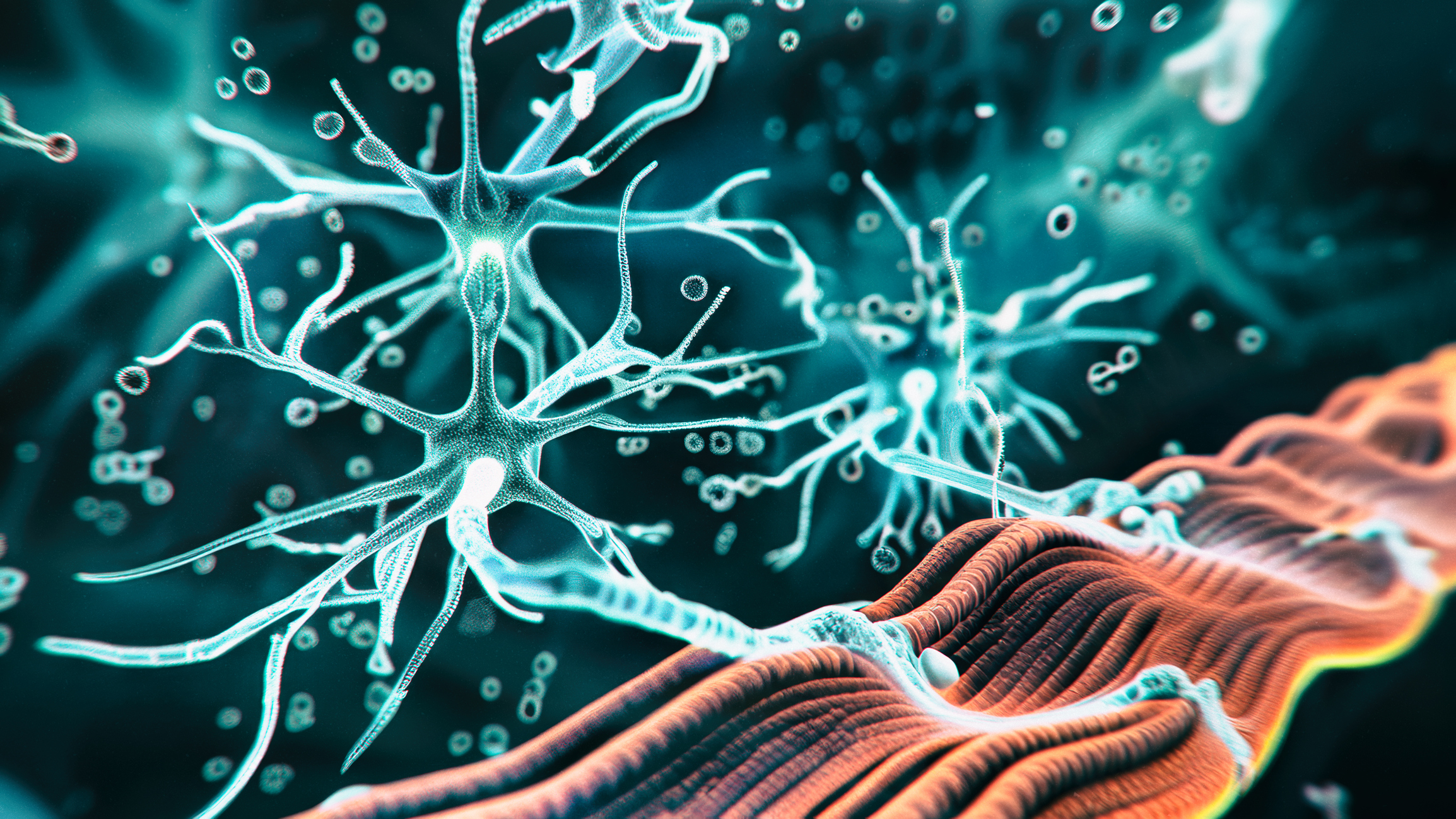L’infection locale est l’une des causes les plus fréquentes de retard de cicatrisation. Le score TILI permet d’estimer s’il y a une infection locale de la plaie et le score WAR permet d’identifier les patients présentant un risque accru d’infection. La formation d’un biofilm sur les plaies chroniques est un facteur critique, car elle limite l’efficacité des antimicrobiens. Les infections cutanées bactériennes graves, telles que l’érysipèle, font également partie des situations cliniques particulières.
Les infections locales des plaies peuvent être lourdes de conséquences – outre la stagnation de la cicatrisation, la menace d’une évolution vers des infections systémiques, voire une septicémie, représente des complications potentiellement mortelles [1,2]. Les infections locales des plaies doivent donc être diagnostiquées le plus tôt possible et traitées de manière adéquate. Le professeur Ewa K. Stürmer, responsable de la chirurgie au Comprehensive Wound Center (CWC) de l’hôpital universitaire de Hambourg-Eppendorf, a expliqué ce qu’il faut prendre en compte dans le cadre des recommandations actuelles des experts et de l’intendance antimicrobienne [3].
Pour les plaies chroniques, les antibiotiques locaux sont à éviter
Les principales espèces bactériennes présentes sur les plaies difficiles à cicatriser sont le Staphylococcus aureus, y compris sa variante résistante à la méthicilline (SARM), ainsi que le Pseudomonas aeruginosa et les entérobactéries [4,5]. Contrairement aux antibiotiques locaux tels que l’acide fusidique ou la gentamicine, qui sont obsolètes dans le traitement des plaies chroniques, les antiseptiques agissent de manière non spécifique contre de nombreux agents pathogènes microbiens différents, car ils ont un large spectre d’action [3]. En outre, les antiseptiques n’entraînent pas de résistance connue des bactéries. “Les antibiotiques n’ont généralement qu’une seule voie métabolique à laquelle ils s’adressent”, a expliqué le professeur Stürmer [3]. Par conséquent, le risque de développement de résistances serait plus élevé.
Pour aider à déterminer dans quels cas les antiseptiques sont indiqués dans les plaies chroniques, l’Index thérapeutique des infections locales (TILI-Score 2.0), développé en 2019 par un groupe d’experts de l’ICW, offre une aide [6,7]. Par conséquent, un traitement antiseptique de la plaie n’est indiqué qu’en présence d’au moins 5 des 6 signes classiques d’inflammation mentionnés ci-dessous (pris séparément, ces signes cliniques ne prouvent pas l’infection) [6,7]:
- érythème périlésionnel
- Surchauffe
- Oedème, durcissement ou gonflement
- douleur spontanée ou douleur à la pression
- Stagnation de la cicatrisation
- augmentation et/ou changement de la couleur ou de l’odeur de l’exsudat
Il existe cependant des aspects isolés qui justifient un traitement antiseptique des plaies [2]. Il s’agit notamment de la détection de micro-organismes potentiellement pathogènes, de la plaie septique chirurgicale et du pus libre. Pour savoir quand une solution de NaCl stérile est suffisante au lieu d’un antiseptique, l’intervenante se réfère au score WAR (“Wound-at-risk”), qui permet d’identifier les patients à risque. Le score WAR permet de déterminer le risque d’infection en fonction de différents facteurs endogènes et exogènes. Il s’agit d’un outil pratique et peu chronophage pour la pratique clinique quotidienne [8,9]. Chez les patients à risque, il peut être utile d’appliquer un traitement antimicrobien des plaies à un stade précoce, voire à long terme si nécessaire. Lors de l’évaluation de l’état de la plaie, il faut toujours prendre en compte les éventuelles pathologies associées des patients.
Adapter le traitement antiseptique des plaies à l’indication
Les substances présentant une bonne efficacité antiseptique et une faible cytotoxicité qui conviennent à une utilisation sur les plaies chroniques sont le dihydrochlorure d’octénidine ou le polyhexanide. L’octénidine (avec ou sans phénoxyéthanol) est efficace contre les bactéries, y compris le SARM ( Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline), ainsi que contre les champignons et les virus, et peut être utilisée sur les plaies contaminées et traumatiques [17]. L’association d’octénidine et de phénoxyéthanol entraîne une augmentation synergique de l’efficacité. Le polihexanide est également indiqué pour les plaies infectées chroniques [17]. Le large spectre d’activité est dirigé contre les bactéries (y compris le SARM) et les champignons de différents types. Pour les plaies principalement infectées par P. aeruginosa , des produits combinés avec des iodophores peuvent apporter un soulagement et l’hypochlorite de sodium est bien adapté au rinçage des cavités des plaies aiguës et chroniques contaminées par des bactéries.
Détection de la tolérance aux antiseptiques par la colonisation de biofilms
Un biofilm se forme lorsque la colonisation bactérienne se développe dans la plaie, passant de colonies à des associations de bactéries, dans lesquelles les bactéries mûrissent et se propagent [3,10]. Les bactéries pathogènes s’entourent d’une matrice de biofilm, la substance extrapolymérique (EPS), qui sert de barrière de protection physique et biochimique [11–13]. Beaucoup de leurs composants peuvent interagir chimiquement directement avec les substances antiseptiques et antibiotiques et les neutraliser, ce qui entraîne la perte de leur efficacité [14]. Dans ce contexte, on parle également de tolérance du biofilm aux agents antimicrobiens (à distinguer de la “résistance”, car les agents antimicrobiens n’ont pas perdu leur efficacité contre les souches bactériennes individuelles, mais échouent seulement à cause des structures et des mécanismes du biofilm) [3,4]. L’une des stratégies les plus efficaces contre le biofilm est le débridement chirurgical ou à vif [4].
Dans quels cas une antibiothérapie systémique est-elle nécessaire ?
Dans le traitement des infections locales des plaies, il est important de ne pas négliger une infection systémique ou un début de sepsis [2,15]. Certains signes systémiques d’infection constituent l’indication d’une administration séquentielle d’antibiotiques par voie systémique en cas de plaies difficiles à cicatriser. Il s’agit notamment de : Leucocytose, augmentation de la protéine C-réactive, éventuellement fièvre et frissons, associés à des signes locaux d’infection tels que rougeur, gonflement, échauffement, douleur croissante et limitation des mouvements du membre concerné [4,16]. En cas de suspicion de sepsis (critères du “quick Sepsis-related Organ Failure Asessment”, qSOFA-Score), l’administration d’antibiotiques par voie systémique est indiquée et les soins intensifs doivent également être envisagés [15].
Parmi les infections de la peau et des tissus mous majoritairement causées par des streptocoques, on trouve notamment l’impétigo contagiosa, une infection cutanée superficielle qui survient principalement chez les enfants. Dans le cas d’un phlegmon, les couches profondes de la peau et les tissus sous-jacents sont également touchés. L’érysipèle doit être distingué du phlegmon cutané, qui implique l’hypoderme et éventuellement les parties molles et les muscles voisins. La fasciite nécrosante est l’une des infections bactériennes les plus graves des tissus mous. On distingue les trois sous-types suivants : Type I) infection mixte aérobie-anaérobie à streptocoques, staphylocoques, anaérobies, entérobactéries et pseudomonas ; type II) streptocoques hémolytiques du groupe A ou S. aureus produisant des toxines ; type III) survenant typiquement après la consommation de fruits de mer ou à la suite de plaies contaminées par l’eau, les agents pathogènes sont des espèces Vibrio. Le “Laboratory risk indicator for necrotizing fasciitis” (LRINEC), par exemple, est un système de scoring disponible.
Congrès : Congrès sur les plaies de Nuremberg
Littérature :
- Stürmer EK, Dissemond J: Evidenz in der lokalen Therapie chronischer Wunden: Was ist gesichert? Phlébologie 2022 ; 51 : 79-87.
- Dissemond J : Diagnostic et traitement des infections locales des plaies. Z Gerontol Geriatr 2023 ; 56(1) : 48-52.
- “L’intendance antimicrobienne – êtes-vous encore tolérants ou déjà résistants ?”, Univ-Prof. E. K. Stürmer, Session principale 5, Infectiologie : biofilm, agents pathogènes multirésistants, Congrès sur les plaies de Nuremberg, 23-24.11.2023.
- Stürmer EK, Matthias A : Plaies chroniques et difficiles à guérir : Vers la cicatrisation grâce à des concepts complexes. SUPPLEMENT : Perspectives de la dermatologie. Dtsch Arztebl 2023 ; 120(27-28) : [16]; DOI : 10.3238/PersDerma.2023.07.10.02
- Jockenhofer F, et al : Bacteriological pathogen spectrum of chronic leg ulcers : Results of a multicenter trial in dermatologic wound care centers differentiated by regions. JDDG 2013 ; 11 : 1057-1066.
- Dissemond J, et al. : Validation du score TILI (index thérapeutique pour les infections locales) pour le diagnostic des infections locales des plaies : résultats d’une analyse rétrospective européenne. J Wound Care 2020 ; 29 : 726-734.
- Dissemond J, et al. : Index thérapeutique des infections locales : TILI-Score version 2.0. Gestion des plaies 2021 ; 15 : 123-126.
- Dissemond J, et al. : La check-list “plaie à risque d’infection” en complément du score W.A.R. (Wounds At Risk) Gestion des plaies 2011 ; 5(Suppl. 2) : 19-20.
- Dissemond J, et al. : Classification des plaies à risque (score W.A.R.) et leur traitement antimicrobien au polihexanide – Une recommandation d’expert orientée vers la pratique. Skin Pharmacol Physiol 2011 ; 24 : 245-255.
- Percival SL, McCarty SM, Lipsky B : Biofilms and Wounds : An Overview of the Evidence. In : Advances in wound care 2015 ; 4 (7) : 373-381.
- Vuong C, et al : Un rôle crucial pour la modification des exopolysaccharides dans la formation de biofilms bactériens, l’invasion immunitaire, et la virulence. J Biol Chem 2004 ; 279 : 54881-54886.
- Cowan T : Les biofilms et leur gestion : du concept à la réalité clinique. J Wound Care 2011 ; 20 : 220 : 2-6.
- Thurlow LR, et al : Les biofilms de Staphylococcus aureus préviennent la phagocytose des macrophages et atténuent l’inflammation in vivo. J Immunol 2011 ; 186 : 6585-6596.
- Flemming HC, Wingender J : La matrice du biofilm. Nat Rev Microbiol 2010 ; 8 : 623-633.
- Singer M, et al : The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3) JAMA 2016 ; 315 : 801-810.
- Bodmann KF, et al : Traitement parentéral initial calculé des maladies bactériennes chez les adultes – Mise à jour 2018. Registre AWMF n° 082-006.
- “Produits pour le traitement antiseptique et le nettoyage des plaies, Rapport sur les risques d’approvisionnement en produits pour le traitement antiseptique et le nettoyage des plaies”, octobre 2022, www.bwl.admin.ch,(dernière consultation 18.12.2023).
DERMATOLOGIE PRAXIS 2024 ; 34(1) : 44-45 (publié le 25.2.24, ahead of print)